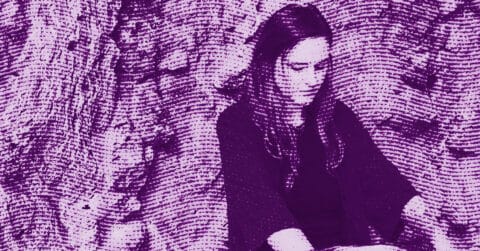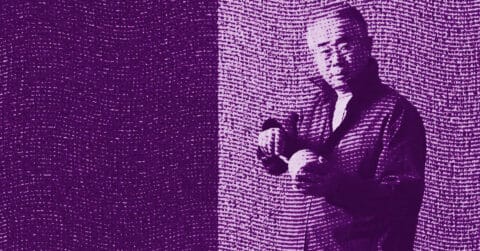Écoutez-moi bien, bande de snobs : pendant que vous vous extasiez devant les dernières installations conceptuelles où trois pommes de terre dialoguent avec un néon clignotant, un homme peint. Il peint vraiment, avec de l’huile, de la toile, du temps et du silence. Bilal Hamdad, né à Sidi Bel Abbès en 1987, ne vous demande ni votre bénédiction ni votre indulgence. Il se contente de capturer ce Paris que vous traversez sans le voir, ces visages que vous croisez sans les regarder, ces instants que vous effacez sitôt vécus. Son pinceau n’est pas un outil de reproduction mais un scalpel qui dissèque l’invisible présent de nos métropoles.
La peinture d’Hamdad dérange parce qu’elle refuse les facilités du discours convenu. On voudrait l’enfermer dans la cage commode de “l’hyperréalisme”, cette catégorie fourre-tout qui dispense de penser. Il est bien plus que cela. Regardez vraiment ses toiles : les corps se dissolvent dans l’ombre, les visages deviennent spectres derrière les vitres, la matière picturale pulse et vibre loin de toute imitation servile. Hamdad ne copie pas le réel, il le recompose à partir de dizaines de photographies pour en extraire une vérité que l’oeil pressé ne saurait percevoir. Ses grandes compositions, deux mètres, parfois davantage, nous obligent à ralentir, à demeurer, à accepter l’inconfort de la contemplation.
L’herméneutique urbaine
La démarche d’Hamdad trouve un écho singulier dans la pensée du sociologue allemand Siegfried Kracauer, figure intellectuelle majeure de la République de Weimar. Kracauer développa ce qu’il nomma une herméneutique de la surface, méthode d’analyse qui considère que “le lieu qu’une époque occupe dans le processus historique se détermine de manière plus pertinente à partir de l’analyse de ses manifestations discrètes de surface, qu’à partir des jugements qu’elle porte sur elle-même” [1]. Cette approche, radicalement opposée aux grandes synthèses théoriques abstraites, privilégie l’observation minutieuse des détails apparemment insignifiants de la vie urbaine. Le cinéma, l’architecture, les déplacements dans le métro, les attitudes corporelles : tout devient matériau de compréhension sociologique.
Hamdad procède exactement ainsi. Ses peintures ne cherchent pas à illustrer des concepts préétablis sur la solitude ou l’aliénation contemporaine. L’artiste lui-même le précise : il ne définit jamais un sujet avant de commencer une toile, il part d’une envie de peindre plutôt que d’un discours. Ses toiles constituent une archive visuelle des manifestations de surface de notre époque : le masque sanitaire, le téléphone portable, le pictogramme wifi, le vendeur de maïs à la sauvette devant Barbès-Rochechouart. Ces éléments ne sont pas des symboles ajoutés artificiellement mais les traces authentiques d’un moment historique précis. Comme Kracauer scrutait les halls d’hôtel berlinois ou les spectacles de variétés pour y déceler les structures profondes de la modernité capitaliste, Hamdad ausculte les quais de métro et les sorties d’escalator pour y révéler les configurations contemporaines de l’existence urbaine.
La station Arts et Métiers dans Le Mirage, avec ses parois de cuivre évoquant le Nautilus, devient ainsi plus qu’un simple décor. Elle incarne ces non-lieux théorisés par l’anthropologue Marc Augé, espaces interchangeables de la surmodernité où l’individu reste anonyme. Mais Hamdad va plus loin : par le jeu des reflets sur les surfaces métalliques, il multiplie les angles de vision, dévoilant ce que l’observation directe dissimule. La passante se révèle de profil, masquée, absorbée par son écran. Cette démultiplication du visible par le visible même constitue une mise en abîme de la méthode sociologique de Kracauer. Les surfaces réfléchissantes ne mentent pas ; elles exposent ce que le regard habitué ne prend plus la peine de noter.
La méthode d’Hamdad partage avec celle de Kracauer une attention obsessionnelle aux rythmes et aux gestes du quotidien métropolitain. Dans Escale II ou L’Attente, les personnages sont saisis dans ces moments de suspension temporelle caractéristiques de l’expérience urbaine : on attend, on transit, on existe dans l’entre-deux. Ces instants creux, que la philosophie classique jugerait indignes d’attention, deviennent chez Hamdad des révélateurs sociaux de première importance. Ils exposent les rapports de l’individu à l’espace public, les stratégies de retrait ou de présence, les micro-comportements qui structurent la vie collective sans jamais faire l’objet d’une conscience explicite.
Rive droite, cette vaste fresque de la sortie du métro Barbès-Rochechouart, pousse cette logique à son paroxysme. Hamdad y déploie un véritable échantillonnage sociologique de la métropole contemporaine : le vendeur africain, les passants pressés, les agents en gilet jaune, le couple qui se tient par la main. Chaque détail compte, chaque présence parle. La plaque commémorative évoquant l’attentat du colonel Fabien contre l’occupant nazi demeure souillée de graffitis, comme si la mémoire collective avait abdiqué devant l’urgence du présent. Cette juxtaposition du mémoriel et de l’actuel, de l’historique et du banal, constitue précisément ce que Kracauer appelait l’analyse des “manifestations discrètes de surface”. L’époque se révèle dans ce qu’elle néglige autant que dans ce qu’elle célèbre.
La poétique du fugitif
L’oeuvre d’Hamdad convoque également, par une nécessité interne plutôt que par coquetterie culturelle, l’univers poétique de Charles Baudelaire. Le poète des Fleurs du mal fut le premier à théoriser la modernité comme expérience du transitoire, du fugitif, du contingent. Son sonnet “À une passante”, souvent cité à propos d’Hamdad, condense cette esthétique de l’instant : “Un éclair… puis la nuit ! Fugitive beauté / Dont le regard m’a fait soudainement renaître / Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?” [2]. Cette rencontre avortée, cette présence qui surgit et s’évanouit, structure aussi bien la poésie baudelairienne que la peinture d’Hamdad.
Le Mirage en constitue l’exemple le plus saisissant. La femme de dos dans le métro, révélée par ses reflets, incarne parfaitement cette “fugitive beauté” baudelairienne. Elle n’existe pour le spectateur que dans cet instant suspendu, ce court-circuit temporel où le visible se dédouble et se dérobe simultanément. On ne la reverra plus, jamais, et pourtant elle demeure fixée sur la toile, éternisée dans sa fuite même. Cette dialectique baudelairienne du fugitif et de l’éternel traverse toute l’oeuvre d’Hamdad. Ses personnages sont toujours en transit, jamais vraiment là, déjà ailleurs dans leur tête ou sur leur écran. Ils habitent ce temps spécifiquement moderne que Baudelaire fut le premier à nommer : un présent sans épaisseur, écartelé entre la remémoration et l’anticipation.
La notion baudelairienne du “peintre de la vie moderne” éclaire également la démarche d’Hamdad. Baudelaire célébrait Constantin Guys pour sa capacité à saisir “l’éphémère, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable”. Hamdad procède exactement ainsi dans ses grandes compositions urbaines. Il capte l’éphémère, ce passant, cette lumière, ce geste, mais le charge d’une densité picturale qui le fait basculer dans une temporalité autre, celle de l’oeuvre d’art. Les tentes Quechua des sans-abri, les gilets bleus du Samu social, les uniformes de police : autant de détails contingents qui, sous le pinceau d’Hamdad, acquièrent une gravité quasi archéologique. Ces objets témoignent, ils constituent les fossiles encore chauds d’une époque qui se regarde sans se comprendre.
La mélancolie de Baudelaire imprègne également les toiles d’Hamdad, cette “mélancolie glorieuse” que le poète associait à la modernité. Patrick Modiano, dont une citation ouvre le catalogue de l’exposition Solitudes croisées, prolonge cet affect baudelairien dans le Paris contemporain : “Il existait à Paris des zones intermédiaires, des no man’s land où l’on était à la lisière de tout, en transit, ou même en suspens” [3]. Ces zones, Hamdad les peint inlassablement. Ce sont ses territoires d’élection : les parkings, les couloirs de métro, les trottoirs déserts de Saint-Rémy-de-Provence. Des espaces de passage qui deviennent, sous son regard, des lieux d’une étrange poésie urbaine, à la fois familiers et inquiétants.
La foule solitaire, thème central de la modernité baudelairienne, trouve chez Hamdad une traduction picturale saisissante. Dans Rive droite, chaque personnage est seul dans la foule, enfermé dans sa bulle perceptive. Ils se côtoient sans se voir, se frôlent sans se toucher vraiment. Cette proximité sans contact, cette coprésence sans relation, définit l’expérience métropolitaine depuis Baudelaire. Hamdad n’y ajoute aucun pathos superflu, aucun commentaire moral. Il montre, simplement, et ce montrer suffit à révéler l’architecture affective de notre temps. Les visages baissés, les regards détournés, l’absorption dans les écrans : autant de stratégies de retrait qui transforment l’espace public en archipel de solitudes juxtaposées.
La peinture comme acte politique
Il serait commode mais faux de réduire l’oeuvre d’Hamdad à un constat désabusé sur l’aliénation contemporaine. Sa peinture porte une charge politique qui ne dit pas son nom, qui refuse le militantisme tapageur pour lui préférer l’efficacité discrète du montrer. Quand Hamdad peint les tentes des migrants dans des architectures désaffectées, quand il représente les SDF recroquevillés dans leurs sacs de couchage, quand il saisit les travailleurs précaires et les vendeurs à la sauvette, il accomplit un geste politique majeur : il rend visible ce que la société préfère ne pas voir. Comme l’écrit Virginie Despentes dans une citation rapportée par le catalogue, nous sommes “vaccinés comme beaucoup de citadins, habitués à la misère des autres, mais toujours un peu honteux de détourner la tête”. La peinture d’Hamdad nous empêche de détourner la tête.
Cette dimension politique s’inscrit dans une filiation revendiquée avec Gustave Courbet. Rive droite reprend explicitement la structure de L’Atelier du peintre, transposant l’allégorie réaliste du XIXe siècle dans le Paris cosmopolite du XXIe. Comme Courbet montrait “la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu”, Hamdad déploie une cartographie sociale de la métropole contemporaine. Le nu de Courbet devient une affiche publicitaire, le paysage champêtre devient un plan de métro, mais le principe demeure : la peinture comme lieu de rassemblement symbolique de toutes les strates sociales. Hamdad actualise ainsi le projet réaliste Courbet, montrant que la grande peinture peut encore dire le monde sans recourir aux facilités de l’abstraction ou aux pirouettes conceptuelles.
Les choix formels d’Hamdad participent également de cette posture politique. Ses grands formats, il utilise volontairement les dimensions de la peinture d’histoire, affirment l’importance de ses sujets. Un SDF, une sortie de métro, un vendeur de maïs méritent ces deux mètres de toile que l’académisme réservait aux héros et aux dieux. Ce geste d’échelle constitue en soi un acte de résistance contre la hiérarchie des sujets qui perdure secrètement dans le monde de l’art. Hamdad proclame par ses formats que ces existences anonymes possèdent une dignité picturale équivalente à celle des puissants. Il y a là quelque chose de profondément démocratique, au sens le plus noble du terme.
La peinture comme exercice du regard
L’oeuvre de Bilal Hamdad s’impose aujourd’hui comme l’une des plus nécessaires de la scène artistique française. Non par virtuosité technique, bien que celle-ci soit indéniable, ni par originalité formelle, bien qu’elle existe. Elle s’impose parce qu’elle accomplit ce que seule la peinture peut accomplir : elle nous apprend à regarder ce que nous voyons. Entre Kracauer et Baudelaire, entre sociologie de la surface et poétique du fugitif, Hamdad construit une archéologie visuelle du présent. Ses toiles fonctionnent comme des ralentisseurs temporels, des obstacles salutaires opposés à la vitesse qui nous aveugle.
Son exposition muséale intitulée “Paname”, organisée avec le soutien de la galerie Templon, actuellement à voir au Petit Palais et jusqu’au 8 février 2026 marque une reconnaissance institutionnelle méritée. Face aux Courbet et aux Lhermitte, ses toiles ne font pas pâle figure. Elles dialoguent d’égal à égal avec les maîtres, prouvant que la grande peinture figurative n’est pas morte, qu’elle n’est pas même malade. Elle exige simplement des peintres capables de la porter, des artistes qui acceptent la lenteur du médium, l’exigence du regard, le refus des raccourcis conceptuels. Hamdad est de ceux-là. Il peint parce qu’il ne peut pas ne pas peindre, parce que la peinture demeure l’outil le plus précis pour saisir les nuances infinies du visible.
Au-delà des étiquettes commodes, hyperréalisme, réalisme social, peinture urbaine, l’oeuvre d’Hamdad pose une question simple mais vertigineuse : que voyons-nous quand nous regardons ? Ses toiles suggèrent que nous ne voyons presque rien, que notre regard glisse sur les surfaces sans jamais s’y arrêter vraiment. Le peintre, lui, regarde. Il regarde avec obstination, avec méthode, avec amour aussi. Il regarde cette ville que nous habitons sans y être, ces visages que nous croisons sans les rencontrer, ces instants que nous vivons sans les vivre vraiment. Et en nous montrant le résultat de ce regard patient, il nous offre la possibilité de voir enfin, peut-être, un peu de ce qui constitue notre condition contemporaine.
L’avenir dira si Hamdad rejoint le panthéon des grands peintres de la modernité urbaine, aux côtés d’un Hopper ou d’un Hammershøi. Pour l’heure, il peint. Il peint ce Paris de 2025, cette métropole saturée et solitaire, violente et fragile, cosmopolite et ségrégée. Il peint sans nostalgie pour un passé mythifié, sans cynisme face au présent, sans illusion sur l’avenir. Il peint parce que peindre, aujourd’hui, constitue en soi un acte de résistance contre l’empire des images jetables et des discours creux. Dans un monde qui privilégie la vitesse et l’oubli, Hamdad choisit la lenteur et la mémoire. Son pinceau grave dans la matière picturale des fragments d’existence qui, sans lui, se seraient dissous dans le flux indifférencié du temps. C’est cela, peut-être, le geste essentiel de l’art : arracher à l’oubli quelques éclats de vérité, et les offrir à ceux qui acceptent encore de regarder vraiment.
- Siegfried Kracauer, cité dans le catalogue de l’exposition Solitudes croisées, 2022, texte d’Hélianthe Bourdeaux-Maurin
- Charles Baudelaire, “À une passante”, Les Fleurs du mal, 1857
- Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, cité dans le catalogue de l’exposition Solitudes croisées, 2022