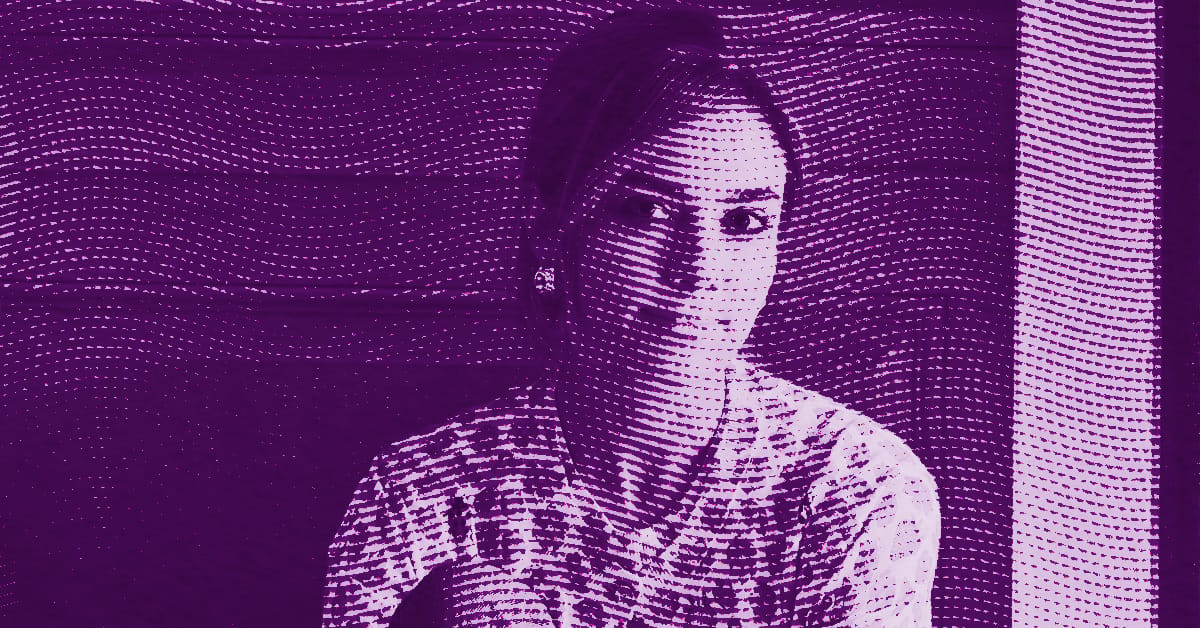Écoutez-moi bien, bande de snobs. Pendant que vous vous extasiez devant les mêmes peintres conceptuels qui recyclent l’ennui depuis quarante ans, une jeune femme de Calgary a compris quelque chose d’essentiel sur notre époque : la beauté ne pardonne rien. Anna Weyant, née en 1995, peint des jeunes femmes qui ressemblent à des poupées de porcelaine prises dans des situations d’une banalité inquiétante. Et ce faisant, elle réveille des fantômes que nous préférerions laisser dormir.
Son parcours semble tracé au cordeau : Rhode Island School of Design, puis l’Académie des Beaux-Arts de Chine à Hangzhou, avant de s’installer à New York où elle devient assistante d’atelier tout en développant sa propre pratique. Rien de spectaculaire, sauf que dès sa première exposition personnelle en 2019 chez 56 Henry, galerie du Lower East Side, les collectionneurs se précipitent. Trois ans plus tard, elle rejoint Gagosian, devenant la plus jeune artiste représentée par cette galerie légendaire. L’une de ses toiles, Falling Woman, atteint 1,5 million d’euros aux enchères chez Sotheby’s en 2022. Le marché a parlé, mais ce qui m’intéresse, c’est ce que ses peintures murmurent.
Le corps qui dérange
Anna Weyant travaille au coeur même de ce que Julia Kristeva a nommé l’abjection dans son ouvrage fondamental Powers of Horror: An Essay on Abjection publié en 1980 [1]. L’abject, selon Kristeva, n’est ni sujet ni objet, mais cette zone trouble où les frontières s’effondrent, où le familier devient monstrueux. Regardez Two Eileens (2022) : deux versions de la même jeune femme, l’une souriante, l’autre pensive, vêtues d’une nuisette froissée, pressées l’une contre l’autre sur un fond noir comme du goudron. Ce dédoublement n’est pas simplement narratif ou surréaliste. Il matérialise la rupture selon Kristéva entre le moi et l’autre, cette séparation primitive que nous établissons pour construire notre identité.
Kristeva écrit que l’abject marque le moment où nous nous sommes séparés de la mère, où nous avons commencé à reconnaître une frontière entre le moi et l’autre. Chez Weyant, cette séparation n’a jamais vraiment eu lieu. Ses jeunes femmes semblent piégées dans cet état pré-objectal, cet espace archaïque où l’identité reste fluide et dangereusement instable. Dans Falling Woman (2020), la protagoniste bascule en arrière dans un escalier, la bouche grande ouverte, les seins proéminents. Est-elle en train de tomber, de rire, de hurler ou de jouir? L’image refuse de se figer dans une seule interprétation. Elle oscille entre le comique et le tragique, entre la violence subie et la liberté choisie.
Cette ambiguïté n’est pas un défaut mais la signature même de l’abject tel que Kristeva le conçoit. L’abject, écrit-elle, est avant tout ambiguïté. Il ne rompt pas radicalement avec ce qui menace le sujet, mais reconnaît un danger perpétuel. Les personnages de Weyant vivent dans cet état de menace permanente et douce. Elles ne sont jamais en sécurité, mais elles ne s’enfuient pas non plus. Elles demeurent, suspendues dans des intérieurs domestiques qui ressemblent à des prisons dorées.
Prenez Lily (2021), cette nature morte qui juxtapose un lys blanc et un revolver enveloppé d’un ruban doré. L’objet abject par excellence, l’instrument de mort, se pare des attributs de la séduction. Il devient cadeau, offrande, promesse. Kristeva insiste sur le fait que l’abject nous attire autant qu’il nous repousse. Le revolver de Weyant, enrubanné comme un présent d’anniversaire, incarne parfaitement cette fascination répulsive. Il transforme la violence en ornement, la mort en nature morte.
La palette de Weyant renforce cette sensation d’abjection domestique. Ses verts sombres, ses roses poussiéreux, ses noirs profonds évoquent les tons sépia des photographies anciennes, mais aussi cette teinte particulière de la chair malade, du corps qui commence à se décomposer. Kristeva associe l’abject à la matérialité de la mort, à cette confrontation traumatique avec notre propre finitude. Le cadavre, écrit-elle, vu sans Dieu et en dehors de la science, représente l’abjection suprême. C’est la mort infectant la vie.
Les jeunes femmes de Weyant possèdent précisément cette qualité cadavérique. Leur peau semble en porcelaine, lisse et froide comme celle de poupées qui auraient trop vécu. Elles sont belles à la manière dont les natures mortes hollandaises du XVIIe siècle sont belles, avec cette beauté qui sent déjà la putréfaction. Dans Venus (2022), deux images de la joueuse de tennis Venus Williams se font face, rendues dans des bruns profonds. L’une regarde vers nous, l’autre se détourne. Le dédoublement crée un malaise, une sensation d’inquiétante étrangeté.
Cette étrangeté surgit précisément parce que Weyant refuse de laisser ses sujets se reposer dans la pure objectivation. Ils résistent à devenir de simples objets de désir ou de contemplation esthétique. Kristeva note que l’abjet résiste à l’assimilation, qu’il demeure irréductible au symbolique. Les personnages de Weyant habitent cet espace de résistance. Ils nous regardent sans nous voir vraiment, perdus dans leurs propres pensées, leurs propres drames miniatures.
L’artiste a déclaré dans une interview : “Je pense que nous sommes plus sensibles, ou plus protecteurs, envers les parties de nous-mêmes que nous essayons de cacher, les endroits où nous ressentons de la honte, peut-être dans la rage, le deuil, la perte de contrôle. Il y a une intimité, une tendresse ou une délicatesse, là où nous sommes les plus monstrueux” [2]. Cette phrase résume parfaitement le projet à l’oeuvre dans sa peinture. La monstruosité n’est pas extérieure, spectaculaire, gothique au sens traditionnel. Elle est intime, domestique et cachée dans les replis de la normalité.
Emma (2022) illustre cette monstruosité douce. Une jeune femme vêtue d’une combinaison noire est assise tandis qu’une autre figure à moitié visible lui caresse les cheveux. La femme assise n’a qu’un oeil. Cette mutilation, pourtant, ne produit pas l’horreur attendue. L’étreinte suggère plutôt un amour sororal, une tendresse qui admet et embrasse le défaut. Kristeva écrirait peut-être que cette image refuse la phobie, cette réaction primitive face à l’abject, pour proposer à la place une acceptation presque sereine de l’incomplet.
Les natures mortes de Weyant fonctionnent selon la même logique. It Must Have Been Love (2022) présente deux vases de fleurs sur une table à manger, vus sous des angles différents. Les fleurs, coupées de leurs racines, sont déjà mortes mais pas encore fanées. Elles occupent cet espace liminal, ce seuil entre la vie et la mort que Kristeva identifie comme le territoire privilégié de l’abject. La nature morte, nature morte en français, still life en anglais, porte en elle cette contradiction. Elle arrête la vie pour mieux la contempler, créant un instant de beauté pétrifié.
Weyant pousse cette logique plus loin encore dans certaines oeuvres où elle décapite littéralement les fleurs ou les montre en train de mourir. L’artiste transforme la nature morte en scène de crime botanique. La violence devient formelle, esthétique, presque abstraite. Mais elle demeure violence. Kristeva observe que les sociétés primitives ont marqué une zone précise de leur culture pour la retirer du monde menaçant des animaux ou de l’animalité, imaginés comme représentants du sexe et du meurtre. Weyant ramène ces éléments refoulés dans l’espace domestique le plus civilisé qui soit : la salle à manger, le salon, la chambre.
Son utilisation du clair-obscur rappelle les maîtres hollandais du XVIIe siècle, Rembrandt, Frans Hals et Judith Leyster, mais le sens a changé. Chez les Hollandais, la lumière venait souvent de Dieu, elle révélait la vérité divine dans le monde matériel. Chez Weyant, la lumière isole les sujets dans des vides noirs, les coupe de tout contexte rassurant. C’est une lumière théâtrale, cinématographique même, qui dramatise sans expliquer. Elle crée du mystère plutôt que de la clarté.
Cette approche théâtrale renforce l’effet d’abjection. Kristeva parle de l’abject comme de ce qui perturbe l’identité, le système, l’ordre. Ce qui ne respecte pas les frontières, les positions, les règles. Les peintures de Weyant dérangent précisément parce qu’elles refusent de se conformer aux attentes. Elles ressemblent à de la peinture figurative classique, elles empruntent les codes de la beauté conventionnelle, mais elles laissent filtrer quelque chose d’incorrect, de déplacé, de vaguement nauséeux. Le revolver avec son ruban. La jeune femme qui tombe. Les doubles qui ne devraient pas exister.
L’artiste crée ce que nous pourrions appeler une “abjection de classe moyenne”. Pas de sang qui gicle, pas de monstres qui rugissent. Juste des jeunes femmes bien habillées dans des intérieurs bien tenus, et pourtant quelque chose ne va pas. Cette approche est infiniment plus perturbante que l’horreur explicite. Elle suggère que l’abject ne se cache pas dans les marges de la société mais au centre même de nos vies quotidiennes. Dans nos maisons, nos relations, nos corps.
Kristeva associe l’abject à la jouissance autant qu’à la peur. Les peintures de Weyant jouent constamment avec cette frontière entre plaisir et déplaisir, entre attraction et répulsion. Head (2020), ce gros plan sur une poitrine courbée suggérant une fellation, illustre parfaitement cette ambivalence. L’image est à la fois érotique et gênante, séduisante et légèrement absurde. Elle réduit le corps féminin à un fragment, mais ce fragment résiste à l’objectivation totale par son étrangeté même.
Le gothique féminin
L’autre tradition qui hante le travail d’Anna Weyant est celle du gothique féminin, ce sous-genre littéraire qui émerge au XVIIIe siècle avec Ann Radcliffe, Clara Reeve et Mary Wollstonecraft. Ces autrices ont utilisé le cadre du roman gothique, avec ses châteaux inquiétants, ses passages secrets, ses héroïnes persécutées, pour explorer la condition féminine dans une société patriarcale oppressive. Weyant transpose cette tradition dans l’Amérique contemporaine de la classe moyenne, remplaçant les châteaux par des maisons de banlieue et les tyrans aristocratiques par les conventions sociales insidieuses.
L’artiste a mentionné sa fascination pour les livres illustrés de Madeline, ces histoires d’une petite orpheline française dans un pensionnat parisien. Les livres de Ludwig Bemelmans, publiés à partir de 1939, présentent un monde superficiellement charmant mais fondamentalement sombre. Madeline vit sans parents, subit une opération de l’appendicite, brave les dangers avec une insouciance inquiétante. Weyant possédait les poupées Madeline enfant et a basé sa première série de peintures sur ces figurines. Elle s’est demandé : que se passerait-il si ces poupées grandissaient un peu, si elles entraient dans l’adolescence avec toute sa confusion et ses traumatismes ?
Cette question la place directement dans la lignée du gothique féminin. Comme l’ont observé de nombreux critiques littéraires, le gothique féminin se concentre sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte, sur ce moment périlleux où la jeune fille doit négocier son entrée dans un monde dominé par les hommes. Les héroïnes de Radcliffe, de Charlotte Brontë et d’Emily Brontë naviguent dans des espaces domestiques qui deviennent des prisons, des lieux de danger plutôt que de sécurité. Les personnages de Weyant occupent des espaces similaires.
Girl Crying at a Party capture parfaitement ce sentiment d’aliénation sociale que le gothique féminin a toujours exploré. L’héroïne gothique traditionnelle se sent toujours légèrement déphasée, jamais tout à fait à sa place dans les structures sociales qui l’entourent. Elle observe le monde avec un mélange de fascination et d’horreur. Les jeunes femmes de Weyant portent ce même regard. Elles sont présentes physiquement mais absentes mentalement, perdues dans leurs propres rêveries ou cauchemars.
L’artiste a déclaré être obsédée par la période de l’adolescence, par cette phase dramatique et traumatisante entre l’enfance et l’âge adulte [3]. Le gothique féminin a toujours privilégié cette liminalité. Jane Eyre de Charlotte Brontë commence comme une orpheline maltraitée et termine comme une femme mariée, mais le coeur du roman se situe dans cette zone intermédiaire d’incertitude et de transformation. Catherine de Wuthering Heights d’Emily Brontë oscille entre deux identités, incapable de choisir entre nature et culture, sauvagerie et civilisation.
Weyant peint des héroïnes gothiques post-modernes qui ont intériorisé ces conflits. Elles ne fuient pas des châteaux hantés mais leurs propres attentes et leurs propres désirs. Loose Screw (2020) montre une figure féminine en silhouette, la bouche grande ouverte dans ce qui pourrait être un cri ou un rire. Le titre suggère que quelque chose ne tourne pas rond, que la machine de la féminité normative a un défaut de fabrication.
Le gothique féminin a toujours utilisé le surnaturel comme métaphore des contraintes imposées aux femmes. Les fantômes représentent les voix réprimées, les doubles symbolisent les identités fragmentées, les châteaux incarnent les structures patriarcales. Weyant n’a pas besoin de fantômes littéraux parce que ses personnages sont déjà spectraux. Leur peau de porcelaine, leurs poses figées, leur regard absent en font des créatures à mi-chemin entre vie et mort.
Cette qualité spectrale est renforcée par sa technique. Weyant peint en couches minces et lisses, créant des surfaces presque trop parfaites. Ses personnages semblent vernis, scellés sous une couche de protection transparente. Cette technique rappelle celle des peintres de miniatures victoriennes qui peignaient des portraits de personnes récemment décédées, transformant les morts en objets précieux à conserver. Les jeunes femmes de Weyant ont cette même qualité préservée, comme si elles avaient été taxidermisées au moment de leur plus grande beauté.
Le motif de la poupée traverse toute son oeuvre et constitue un lien direct avec la tradition gothique. Les poupées dans la littérature gothique sont toujours inquiétantes. Elles représentent l’humanité vidée de son contenu, la forme sans l’essence. Freud a analysé la poupée comme exemple d’Unheimlich, cette inquiétante étrangeté qui surgit quand le familier devient soudain menaçant. Une poupée ressemble à un humain mais n’en est pas un. Elle habite cet espace trouble entre animé et inanimé.
Weyant a travaillé littéralement avec des poupées, les photographiant et les peignant. Mais même ses modèles vivants prennent des qualités de poupées. Leurs visages ronds, leurs yeux grands, leurs poses statiques évoquent des figurines plutôt que des personnes. On comprends que l’artiste est attirée par ces caractéristiques, la rondeur, l’immobilité, la perfection artificielle. Elle crée ainsi des héroïnes gothiques qui sont leurs propres prisons. Elles ne sont pas emprisonnées dans des châteaux mais dans leurs propres corps, dans les conventions de la beauté féminine.
Summertime (2021) présente une femme dont la tête et le torse reposent sur une table à côté d’un vase de fleurs. La composition suggère qu’elle fait elle-même partie de la nature morte, qu’elle est devenue un objet décoratif au même titre que les fleurs. Cette objectivation est une préoccupation centrale du gothique féminin depuis ses origines. Les héroïnes de Radcliffe risquent constamment d’être transformées en objets : mariées de force, emprisonnées ou assassinées pour leur héritage.
Weyant actualise ces dangers pour l’ère Instagram. Ses jeunes femmes ne sont pas menacées par des barons cupides mais par la pression de se présenter comme des images parfaites. Elles doivent se transformer en poupées, en objets de contemplation. Le danger vient de l’intérieur autant que de l’extérieur. Bite (2020) montre une jeune femme en lunettes de soleil qui mord ce qui semble être le bras d’un homme. C’est un moment de rébellion, une héroïne gothique qui attaque plutôt que de fuir.
Cette dimension de résistance distingue le gothique féminin du gothique masculin. Chez Matthew Lewis ou Horace Walpole, les héroïnes sont souvent purement victimes. Chez Radcliffe et ses héritières, elles déploient des stratégies de survie, parfois subtiles, parfois dramatiques. Les personnages de Weyant résistent aussi, mais de manière oblique. Elles refusent de sourire pour la caméra, elles regardent ailleurs, elles tombent dans les escaliers en tenant leur champagne.
Le gothique féminin explore également la sexualité d’une manière que le roman réaliste ne pouvait pas à l’époque. Le voile du surnaturel permettait d’aborder des désirs et des peurs autrement indicibles. Weyant utilise le voile de l’étrangeté formelle pour un effet similaire. Eileen (2022) montre une jeune femme levant les bras derrière sa tête, faisant remonter sa tunique blanche pour révéler sa culotte. Le geste est à la fois innocent et sexuellement chargé, spontané et posé.
L’artiste a parlé de son intérêt pour Playboy vintage, pas pour son contenu érotique explicite mais pour son esthétique synthétique et son ambiance sombre. Elle aime les grands cheveux blonds et les “vraiment gros seins bulbeux” mais les traite avec une ironie qui les empêche de devenir purement objectifiants. Ses femmes ne posent pas pour le plaisir masculin. Elles sont prises dans leurs propres mondes intérieurs, indifférentes au regard du spectateur.
Cette indifférence est importante. Les héroïnes gothiques de Radcliffe sont constamment surveillées, observées et épiées. Elles ne trouvent la liberté que dans les moments où elles échappent à la surveillance. Les personnages de Weyant semblent avoir internalisé cette surveillance, nous les voyons, mais elles ne nous voient pas. Elles sont à la fois exposées et retirées, visibles et inaccessibles. Cette tension crée un malaise productif. Nous sommes voyeurs d’une intimité qui nous exclut.
House Exterior (2023) présente une maison en bois de trois étages, apparemment vide, éclairée d’une manière claustrophobe qui génère une forte tension psychologique. L’image évoque immédiatement la maison de Norman Bates dans Psycho d’Alfred Hitchcock ou la demeure des soeurs Blackwood dans We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Weyant confirme ces références, citant Jackson et Hitchcock comme influences. La maison gothique est un personnage à part entière, un espace qui contient et exprime les traumatismes de ses habitants.
Le titre de sa première exposition personnelle, “Welcome to the Dollhouse”, référençait à la fois ses peintures de maisons de poupées et le film de Todd Solondz sur les cruautés de l’adolescence. L’exposition présentait des intérieurs miniatures habités par de jeunes femmes en détresse. La maison de poupées fonctionne comme version domestiquée du château gothique, un espace clos, contrôlé, où les drames se jouent à échelle réduite. Comme l’a observé la critique littéraire Susan Stewart, la maison de poupées est la plus accomplie des miniatures, représentant à petite échelle l’articulation de la tension entre sphères intérieure et extérieure, entre extériorité et intériorité.
Weyant transforme ses toiles en maisons de poupées psychologiques. Ses fonds noirs éliminent tout contexte extérieur, créant des espaces purement intérieurs où les personnages flottent dans leurs propres mondes. Cette suppression du contexte social est typique du gothique féminin. La société normale disparaît, laissant l’héroïne seule avec ses tourmenteurs ou ses propres démons intérieurs. Sophie (2022) montre une jeune femme debout et souriante dans l’obscurité. Son expression joviale contraste si violemment avec le fond noir qu’elle devient inquiétante plutôt que rassurante.
L’ambiguïté morale du gothique féminin imprègne également l’oeuvre de Weyant. Dans les romans de Radcliffe, nous ne savons jamais vraiment qui est bon et qui est mauvais jusqu’à la fin. Les apparences trompent constamment. De même, les personnages de Weyant résistent à l’interprétation morale simple. Sont-elles victimes ou complices? Innocentes ou calculatrices? Fragiles ou dangereuses? L’artiste refuse de trancher. Elle maintient ses figures dans un état d’ambiguïté productive.
Cette ambiguïté s’étend à ses natures mortes. Drawing for Lily (2021) présente un vase élégant, un pot à crème avec une cuillère et un revolver avec un ruban enroulé autour de la gâchette et du canon. Les objets domestiques innocents côtoient l’instrument de mort. Le critique John Elderfield a noté que ce dessin trouve le juste équilibre entre quiétude et malaise, contrairement aux natures mortes plus statiques de l’exposition. Les objets ordinaires deviennent porteurs de menaces diffuses.
Le gothique féminin excelle à cette transformation de l’ordinaire en menaçant. La vie domestique quotidienne se révèle pleine de périls cachés. Les héroïnes de Charlotte Brontë doivent négocier des dangers dans des salons et des salles à manger autant que dans des passages secrets. Weyant actualise cette vérité pour le XXIe siècle. Ses jeunes femmes évoluent dans un monde apparemment sûr, maisons bien tenues, vêtements soignés et fleurs fraîches, mais ce monde contient des violences sourdes.
L’artiste décrit ses natures mortes comme son “endroit heureux”, un refuge où elle peut pratiquer la peinture d’après nature [4]. Mais ces espaces heureux sont infiltrés par l’étrange et le menaçant. Cette infiltration rappelle la stratégie centrale du gothique féminin : montrer comment les structures censées protéger les femmes, le mariage, la famille et la maison, peuvent devenir des pièges. Les fleurs de Weyant sont coupées, mourantes, parfois décapitées. La beauté domestique masque la violence.
Sa palette contribue à cette atmosphère gothique. Les verts sombres, les jaunes sales, les roses fanés évoquent les intérieurs victoriens décrépits, les tapisseries moisies, les portraits noircis par le temps. Ces couleurs portent le poids de l’histoire, suggérant que les espaces domestiques contemporains sont hantés par les générations précédentes de femmes qui y ont vécu et souffert. Le gothique féminin est toujours hanté par les mères mortes, les tantes folles et les soeurs disparues. Weyant peint leurs héritières.
Sa technique lisse et perfectionnée crée un paradoxe visuel. Les images ressemblent à des publicités pour produits de luxe, cette perfection glacée des magazines de mode haut de gamme. Mais le contenu subvertit cette perfection. Une jeune femme qui tombe. Des fleurs qui meurent. Des revolvers enrubannés. Weyant utilise l’esthétique de la marchandisation pour critiquer la marchandisation elle-même. Ses héroïnes gothiques sont piégées non pas dans des châteaux mais dans des images, dans des attentes, dans des rôles prescrits.
Exister dans un espace d’incertitude
Anna Weyant crée une nouvelle forme de peinture gothique pour l’ère des réseaux sociaux. Ses héroïnes habitent un espace liminal, ni tout à fait vivantes ni tout à fait mortes, ni totalement innocentes ni complètement corrompues, ni franchement victimes ni clairement puissantes. Elles existent dans l’entre-deux, cet espace d’incertitude que notre époque trouve particulièrement difficile à tolérer. Nous voulons des jugements clairs ou des interprétations définitives. Weyant refuse de nous les donner.
Cette résistance à la certitude constitue son geste le plus radical. Dans un monde saturé d’images instantanément décodables, ses peintures demeurent opaques. Elles requièrent du temps, de l’attention, une volonté d’accepter l’ambiguïté. Elles empruntent le langage de la beauté conventionnelle mais parlent un dialecte étrange. Elles ressemblent à des poupées mais pensent comme des êtres humains. Elles occupent des intérieurs domestiques mais rêvent peut-être d’évasion.
Son utilisation de la tradition picturale hollandaise n’est pas simple citation postmoderne. C’est une revendication du droit de peindre lentement, soigneusement, avec une attention aux détails qui peut sembler anachronique. Dans un monde d’images numériques instantanées, elle oppose la patience de l’huile sur toile, les glacis successifs, la construction progressive de l’illusion. Cette lenteur est elle-même une forme de résistance.
Mais elle ne verse pas dans la nostalgie. Ses sujets sont résolument contemporains, jeunes femmes en sous-vêtements modernes, objets actuels, références à la culture populaire. Elle peint son époque tout en utilisant les outils du passé. Cette tension productive génère une grande partie de la puissance de son travail. Elle prouve que la peinture figurative peut encore avoir quelque chose d’urgent à dire sur notre condition présente.
Sa jeunesse la place dans une position unique. Elle appartient à la génération qui a grandi avec Instagram, qui comprend viscéralement la pression de se présenter comme une image parfaite. Mais elle a aussi étudié sérieusement l’histoire de l’art, s’est immergée dans les traditions picturales. Elle peut ainsi critiquer la culture de l’image de l’intérieur tout en mobilisant des stratégies visuelles séculaires.
Les critiques qui l’accusent de jouer la carte de la sécurité passent à côté de l’essentiel. Il est vrai que ses peintures ne sont pas violemment expérimentales dans leur forme. Elles ne cassent pas la représentation, ne fragmentent pas l’espace, ne hurlent pas leur modernité. Mais cette retenue formelle est précisément ce qui permet à leur contenu étrange de s’insinuer. Si les images étaient plus ouvertement perturbantes, nous pourrions les rejeter facilement. Leur beauté superficielle nous attire, puis nous piège.
Weyant travaille dans la tradition des peintres qui utilisent la séduction visuelle pour transmettre des messages inconfortables. John Currin, qu’elle cite comme influence majeure, fait la même chose. Lisa Yuskavage aussi. Mais elle apporte sa propre sensibilité, son propre regard de jeune femme observant les rituels de la féminité avec un mélange de tendresse et d’horreur. Elle peint de l’intérieur de l’expérience qu’elle représente, et cela fait toute la différence.
L’avenir dira si elle peut maintenir cette tension productive, si elle peut continuer à peindre l’abject et le gothique sans tomber dans la répétition ou la complaisance. Pour l’instant, avec moins d’une décennie de carrière professionnelle derrière elle, elle a déjà créé un corpus d’oeuvres qui mérite attention et analyse. Elle a trouvé une voie singulière à travers les territoires minés de la peinture figurative contemporaine.
Ses peintures nous rappellent que la beauté peut être dangereuse, que les intérieurs domestiques cachent des violences, que les jeunes femmes qui ressemblent à des poupées ont des pensées complexes et sombres. Elles nous rappellent aussi que la peinture, cet art ancien et patient, peut encore nous surprendre, nous déranger, nous obliger à regarder plus attentivement ce que nous croyions déjà connaître. Anna Weyant peint des surfaces qui demandent à être percées, des apparences qui dissimulent des abîmes.
- Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Paris, Éditions du Seuil, 1980.
- Ayanna Dozier, “Anna Weyant’s Uncanny Paintings Breathe New Life into Female Portraiture”, Artsy, 20 décembre 2022
- Sasha Bogojev, “Anna Weyant Welcomes Us to the Dollhouse”, Juxtapoz Magazine, janvier 2020
- John Elderfield, “Seductive Imitation: on Anna Weyant’s Still Lifes”, Gagosian Quarterly, 17 août 2023