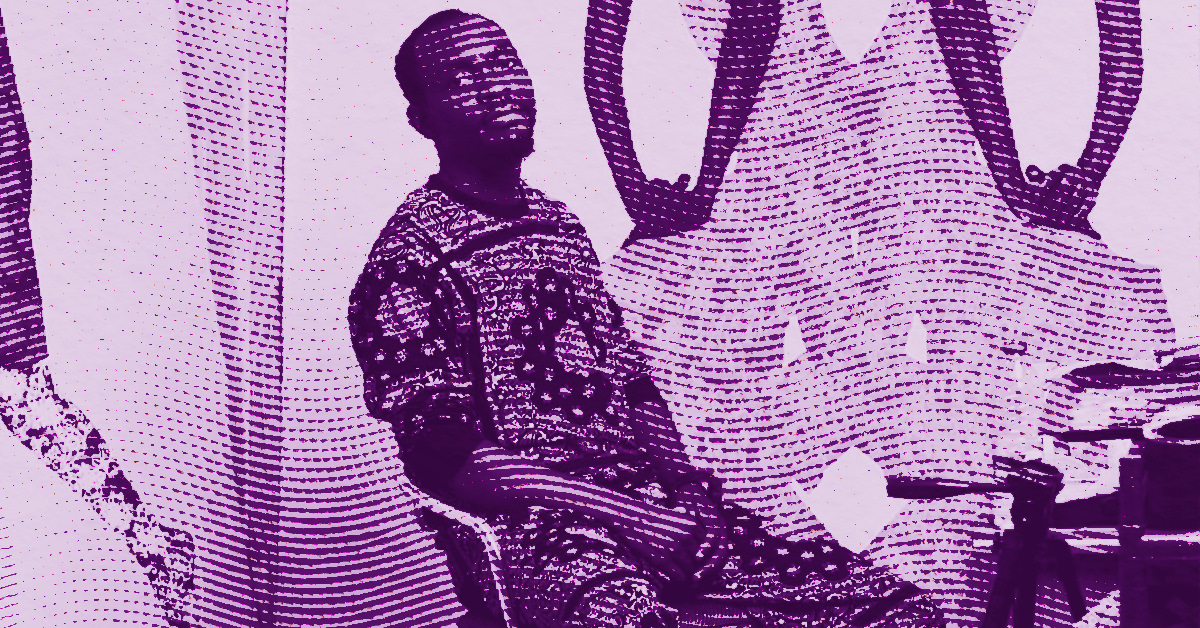Écoutez-moi bien, bande de snobs : voilà un artiste qui, depuis les ateliers d’Accra, réinvente le portrait noir avec une audace qui devrait vous faire honte de vos certitudes molles. Emmanuel Taku, né en 1986 au Ghana, dessine sur ses toiles monumentales une contre-histoire de la représentation, un manifeste visuel qui ne vous demande pas votre permission pour exister. Formé au Ghanatta College of Art and Design entre 2005 et 2009, cet homme a d’abord enseigné le dessin figuratif avant de comprendre que l’enseignement ne suffirait pas à contenir ce qu’il avait à dire. Ce qu’il fallait, c’était un langage neuf, une syntaxe plastique capable de porter la vénération des corps noirs sans tomber dans les pièges convenus de la commémoration ou du militantisme illustratif.
La série qui a propulsé Taku sur la scène internationale s’intitule “Temple of Blackness – It Takes Two”, produite lors de sa résidence inaugurale à Noldor en 2020. Le titre lui-même constitue déjà un geste théorique : là où les musées occidentaux ont longtemps érigé des temples à la blancheur, Taku construit ses propres autels. Ses figures, drapées dans des tissus aux motifs floraux sérigraphiés, se tiennent dans des poses qui empruntent simultanément aux magazines de mode et à la statuaire classique. Leurs yeux blancs, totalement dépourvus de pupilles, les transforment en demi-dieux. Ce détail formel, que l’artiste revendique comme une référence au film Man of Steel où Superman manifeste sa puissance par cette métamorphose oculaire, dépasse largement l’hommage cinématographique pour toucher à quelque chose de plus profond dans les cosmogonies ghanéennes.
Le lien avec le cinéma d’auteur n’est pas fortuit chez Taku. C’est en entendant le cinéaste britanno-ghanéen John Akomfrah évoquer son expérience d’enfant noir dans les musées anglais, qu’il a désignés comme des “temples de la blancheur” [1], que Taku a trouvé le concept fondateur de son travail. Akomfrah, né à Accra en 1957 avant d’émigrer en Grande-Bretagne, a cofondé le Black Audio Film Collective en 1982 et développé tout au long de sa carrière une oeuvre filmique qui interroge la mémoire postcoloniale, le déplacement diasporique et les structures de pouvoir inscrites dans les institutions culturelles. Ses installations vidéo multi-écrans, comme Vertigo Sea ou Purple, tissent ensemble archives historiques et images contemporaines pour créer des essais visuels sur la condition noire et la crise environnementale.
Pour Taku, cette formulation d’Akomfrah, les musées comme temples de la blancheur, a agi comme une révélation. Elle a cristallisé ce qu’il ressentait confusément : que les espaces culturels occidentaux ont historiquement fonctionné comme des lieux de consécration d’une certaine vision du monde, d’une certaine esthétique, d’une certaine humanité. Face à ces temples, Taku érige les siens. Mais contrairement à ce qu’une lecture superficielle pourrait suggérer, il ne s’agit pas d’un simple renversement binaire. Les personnages de Taku ne remplacent pas une hégémonie par une autre ; ils proposent une modalité différente de présence au monde. Leurs poses ne sont pas triomphales au sens martial du terme ; elles affirment une souveraineté tranquille, une majesté qui n’a pas besoin de conquérir pour s’affirmer.
Cette dimension architecturale du projet de Taku mérite qu’on s’y attarde. En parlant de “temple”, l’artiste ne se contente pas d’une métaphore : il convoque toute une tradition de pensée sur l’espace sacré, sur le seuil entre le profane et le divin, sur la fonction des lieux où s’opère une transformation du regard. Les temples, dans toutes les cultures, sont des espaces de passage où l’ordinaire rencontre l’extraordinaire. En faisant de ses toiles des fragments de ce temple métaphorique, Taku transforme l’acte de regarder en acte de dévotion. Le spectateur ne se trouve plus dans la position du juge esthétique qui évalue une oeuvre, mais dans celle du pèlerin qui pénètre un espace sacré. Cette inversion des rapports de pouvoir dans la relation entre l’oeuvre et son public constitue peut-être l’aspect le plus subversif du travail de Taku.
Le cinéma d’Akomfrah et la peinture de Taku partagent également une approche stratifiée de l’image. Chez Akomfrah, les écrans multiples et la superposition de temporalités créent une densité visuelle qui résiste à la lecture linéaire. Chez Taku, cette stratification s’opère par l’accumulation des techniques : acrylique, sérigraphie, collages de journaux, textiles. Les tissus floraux qui habillent ses figures ne sont pas de simples ornements ; ils portent une histoire, celle de la soeur couturière de l’artiste, celle des échanges commerciaux entre l’Inde, la Grande-Bretagne et l’Afrique, celle des identités hybrides qui se façonnent dans ces circulations. Le motif cachemire que Taku affectionne particulièrement incarne cette complexité : originaire de Perse et d’Inde, popularisé en Écosse, adopté par les mouvements contre-culturels occidentaux, il porte en lui-même la carte des appropriations et des réappropriations culturelles.
Mais il y a autre chose dans l’oeuvre de Taku, quelque chose de plus intime et de plus américain dans sa généalogie : l’influence de la pensée positive et du Nouveau Mouvement de Pensée tel qu’il s’est développé dans les années 1920. L’artiste cite volontiers The Secret of the Ages, ouvrage publié en 1926 par Robert Collier [2], comme ayant changé sa vie. Ce livre, qui s’est vendu à plus de 300.000 exemplaires du vivant de son auteur, appartient à cette tradition littéraire du développement personnel qui promet l’accès à un pouvoir illimité par la maîtrise de l’esprit subconscient. Collier, neveu du fondateur du magazine Collier’s Weekly, y développe une psychologie de l’abondance fondée sur le désir, la foi et la visualisation.
Cette référence pourrait surprendre. Que vient faire un tel ouvrage, souvent décrié pour son optimisme naïf et son individualisme forcené, dans l’économie d’une oeuvre qui se présente comme un projet de restitution collective de dignité ? La réponse se trouve précisément dans la manière dont Taku réarticule les propositions de Collier. Là où The Secret of the Ages s’adresse à des individus isolés cherchant le succès personnel, Taku transpose ces principes dans un registre communautaire et décolonial. La visualisation devient création d’images contre-hégémoniques ; la foi en ses propres possibilités se mue en affirmation d’une beauté et d’une puissance noires longtemps niées ; le pouvoir du subconscient devient capacité à se réinventer au-delà des scripts imposés par l’histoire coloniale.
Taku lui-même l’explique en ces termes : “Si vous pouvez le penser, alors vous pouvez l’obtenir” [3]. Cette phrase, directement inspirée de la rhétorique de Collier, prend chez l’artiste une dimension politique qu’elle n’avait pas chez l’auteur américain. Penser les corps noirs comme des entités divines, les visualiser dans des poses de pouvoir, les draper dans des tissus somptueux, c’est opérer cette transformation que Collier promettait : faire advenir par la pensée ce que le réel refuse encore. Le livre de 1926 et les toiles de 2020 partagent cette conviction que l’imagination n’est pas simple fantaisie, mais force créatrice capable de remodeler la réalité.
Il y a cependant une différence : chez Collier, la transformation reste individuelle et matérielle ; chez Taku, elle est collective et symbolique. Les figures de l’artiste ne sont jamais seules. Elles vont par paires, par groupes, formant des configurations où les corps s’entrelacent et se répondent. Cette insistance sur la dualité et la multiplicité trouve sa source dans un proverbe ghanéen que Taku convoque régulièrement : un balai isolé se brise facilement, mais liés ensemble, les balais deviennent incassables. La consolidation, la synergie, l’unité : voilà ce que recherchent ces compositions où les silhouettes anthropomorphes se fondent les unes dans les autres, créant des hybrides où l’on ne sait plus très bien où commence un corps et où finit l’autre.
Cette esthétique de la fusion contraste avec l’hyperindividualisme du Nouveau Mouvement de Pensée américain. Taku récupère l’outil conceptuel, la puissance de la pensée, la création par visualisation, mais le réoriente vers des fins communautaires. Ses temples ne célèbrent pas des héros solitaires mais des collectifs, des solidarités, des alliances. En cela, il effectue une traduction culturelle : le succès personnel devient émancipation collective. Cette opération de détournement témoigne d’une intelligence stratégique remarquable. Plutôt que de rejeter en bloc les outils conceptuels produits par la culture dominante américaine, Taku les plie à ses propres fins.
Les toiles monumentales de l’artiste, certaines mesurant jusqu’à 3 mètres de large, imposent physiquement leur présence. Elles ne se laissent pas regarder distraitement ; elles exigent qu’on se tienne devant elles, qu’on lève les yeux vers ces figures plus grandes que nature. Cette monumentalité participe de la stratégie de renversement : là où les corps noirs ont été historiquement réduits, objectifiés, fragmentés, Taku les amplifie, les magnifie, les rend incontournables. La sérigraphie qui orne les vêtements ajoute une dimension ornementale qui refuse la sobriété austère souvent associée à l’art “sérieux”. Ces motifs floraux exubérants, ces couleurs saturées, ce refus de l’ascétisme formel : tout cela constitue une affirmation joyeuse, presque insolente, du droit à la beauté et à la somptuosité.
Les collectionneurs ne s’y sont pas trompés. En 2022, avec près d’un million d’euros d’oeuvres vendues aux enchères, Taku est devenu le troisième artiste ghanéen de sa génération le plus performant sur le marché mondial. Un tableau réalisé pendant la résidence Noldor a établi son record personnel à 250.000 euros en mars 2022. Ces chiffres, qu’on pourrait juger vulgaires à mentionner dans une analyse critique, disent pourtant quelque chose d’important : le marché, malgré tous ses défauts, reconnaît ici la puissance d’un travail qui ne fait aucune concession. Taku n’a pas édulcoré son propos pour plaire ; il a au contraire radicalisé ses positions, et c’est précisément cette intransigeance qui séduit.
Car au fond, ce que propose Taku, c’est une sortie du régime de représentation compassionnel qui a longtemps caractérisé la manière dont l’art occidental abordait les sujets noirs. Ses figures n’appellent ni la pitié, ni la solidarité bien-pensante, ni l’indignation morale. Elles n’ont pas besoin de votre empathie. Elles se suffisent à elles-mêmes, souveraines et inaccessibles dans leur splendeur surnaturelle. Cette inaccessibilité, signifiée par les yeux blancs aveugles qui ne vous regardent pas vraiment, constitue un refus du pacte scopique habituel. Vous pouvez les contempler, mais elles ne vous contemplent pas en retour. Elles existent dans une sphère parallèle, celle du temple qu’elles habitent, et vous restez à l’extérieur, spectateur admis mais non invité.
Cette position esthétique rejoint finalement celle d’Akomfrah dans ses installations : créer des espaces contemplatifs où le spectateur occidental se trouve décentré, où son regard n’organise plus le monde. Dans les salles obscures où se déploient les vidéos d’Akomfrah, comme devant les toiles de Taku, on fait l’expérience d’une altérité qui ne se réduit pas, qui ne s’explique pas, qui simplement s’affirme. C’est cette dignité ontologique, cette présence pleine et entière, que les deux artistes, par des moyens différents, s’attachent à rendre visible. Le cinéma d’Akomfrah et la peinture de Taku forment ainsi une constellation diasporique ghanéenne, un dialogue par-delà l’Atlantique entre deux générations d’artistes qui refusent d’occuper les places qui leur étaient assignées.
Il ne s’agit pas ici de succomber à la tentation hagiographique qui guette toute critique d’art dès lors qu’elle aborde des questions de représentation et de justice. L’oeuvre de Taku comporte ses limites, ses zones d’ombre. On pourrait interroger la permanence de la figure humaine quand tant d’artistes contemporains explorent l’abstraction ou l’installation. On pourrait questionner aussi la relative uniformité formelle d’une production qui, série après série, reconduit les mêmes partis pris compositionnels. Mais ces réserves pèsent peu face à l’évidence d’une nécessité : ces images manquaient, et maintenant elles existent. Elles occupent les galeries de Bruxelles, de New York et de Hong Kong. Elles s’échangent dans les salles de vente. Elles entrent dans les collections muséales. Elles produisent ce que Taku avait visualisé, suivant en cela les préceptes de Collier : elles transforment le possible en réel.
Le temple que construit Emmanuel Taku n’est pas un monument statique ; c’est un chantier permanent, une architecture toujours en devenir. Chaque nouvelle toile ajoute une pierre à l’édifice, élargit l’espace sacré, accueille de nouvelles figures dans le panthéon. Et ce faisant, elle transforme imperceptiblement le paysage de l’art contemporain, elle déplace les lignes, elle rend un peu plus difficile le maintien des anciennes hiérarchies. C’est cette patience stratégique, cette confiance dans le pouvoir accumulatif des images, qui fait de Taku non pas un iconoclaste fracassant mais un bâtisseur obstiné. Il ne détruit pas les temples de la blancheur ; il érige patiemment, méthodiquement, les siens, sachant que leur simple existence suffit à questionner l’hégémonie des premiers. C’est peut-être la leçon la plus précieuse qu’on puisse tirer de cette oeuvre : que la contre-histoire s’écrit moins dans la confrontation frontale que dans la construction patiente d’alternatives visuelles, dans l’obstination à faire exister ce qui n’avait pas droit de cité. Et que cette existence, une fois établie, devient irréversible.
- John Akomfrah, référence mentionnée par Emmanuel Taku lors de son entretien avec Gideon Appah pour la Noldor Residency, 2020, concernant les musées comme “temples of whiteness”.
- Robert Collier, The Secret of the Ages, Robert Collier Publications, 1926.
- Emmanuel Taku, interview avec Fashion Week Daily, 2021.