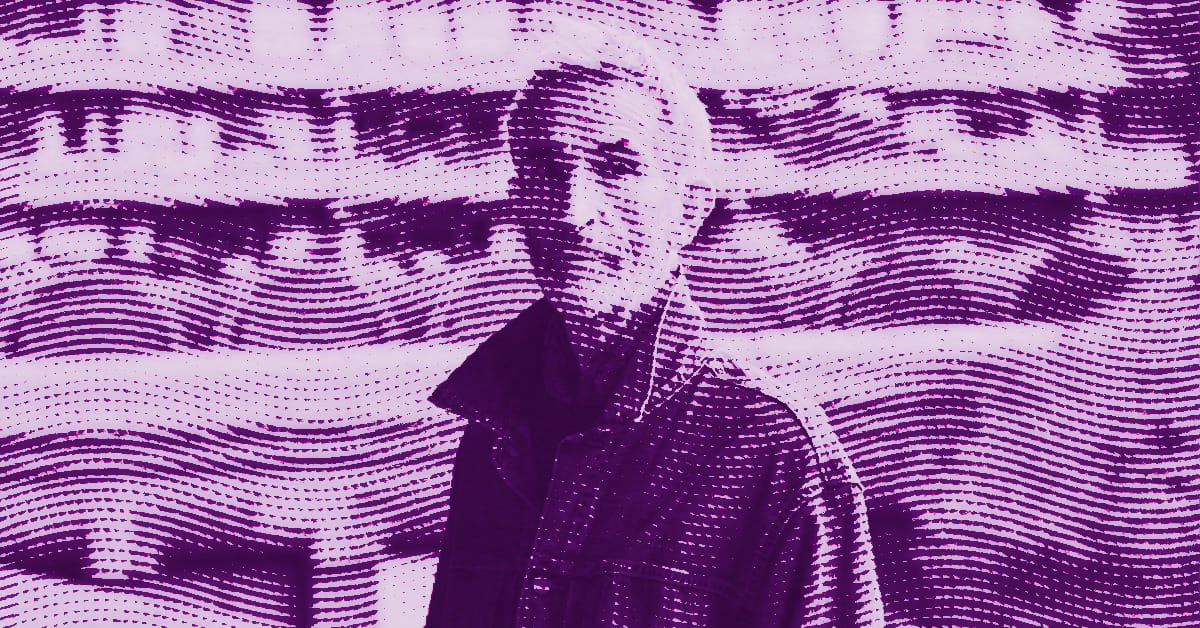Écoutez-moi bien, bande de snobs : Francis Alÿs ne nous demande pas de comprendre ses oeuvres, il nous demande de les parcourir. Dans un monde saturé d’images spectaculaires et de gestes artistiques tonitruants, ce Belge installé à Mexico depuis 1986 développe une pratique artistique fondée sur la simplicité du geste et la complexité de ses résonances. Ni peintre au sens traditionnel, ni performeur au sens théâtral, Alÿs occupe un territoire artistique singulier où l’acte de marcher devient un instrument de résistance poétique aux logiques urbaines contemporaines.
L’oeuvre de Francis Alÿs s’épanouit dans l’espace interstitiel entre l’art et l’anthropologie, entre le geste minimal et la charge politique maximale. Depuis ses premières déambulations dans les rues de Mexico City au début des années 1990, l’artiste développe une pratique qui interroge les modes d’occupation de l’espace urbain. Ses actions, documentées par la vidéo et prolongées par la peinture, constituent un corpus cohérent d’investigations sur les tensions géopolitiques contemporaines.
Né à Anvers en 1959, Francis Alÿs arrive au Mexique en tant qu’architecte, mandaté pour participer aux projets de reconstruction post-séisme de 1985. Cette formation d’architecte demeurera fondamentale dans son approche artistique : jamais il n’oubliera que l’espace urbain est d’abord un construit social, un ensemble de contraintes et de possibilités qui déterminent les modalités d’existence collective. Son passage à l’art, vers 1989, constitue moins une rupture qu’une radicalisation de cette préoccupation pour l’espace comme révélateur des rapports de force sociaux.
La marche comme écriture de l’espace
L’oeuvre de Francis Alÿs trouve sa résonance théorique la plus profonde dans la pensée de Michel de Certeau, particulièrement dans son analyse de la marche comme pratique de l’espace développée dans “L’invention du quotidien”. Pour Certeau, l’acte de marcher constitue une forme d’énonciation spatiale qui échappe aux systèmes de surveillance et de contrôle urbains [1]. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension des déambulations d’Alÿs, qui ne relèvent plus du simple exercice esthétique mais d’une véritable politique de l’espace.
Dans “The Collector” (1991-1992), Alÿs traîne un chien magnétique en peluche dans les rues de Mexico, collectant les débris métalliques qui jonchent l’asphalte. Cette action apparemment ludique révèle, par l’accumulation progressive des résidus ferreux, l’état de délabrement de l’infrastructure urbaine mexicaine. Le geste minimal d’Alÿs transforme la marche en instrument d’investigation sociale, révélant ce que les politiques officielles d’aménagement urbain s’efforcent de dissimuler.
Cette dimension critique de la marche trouve son expression la plus aboutie dans “Paradox of Praxis I (Sometimes Making Something Leads to Nothing)” (1997), où Alÿs pousse un bloc de glace dans les rues de Mexico City pendant neuf heures, jusqu’à sa fonte complète. L’action interroge frontalement les notions de productivité et d’efficacité qui structurent l’économie néolibérale. En investissant un effort considérable pour un résultat nul, Alÿs actualise les réflexions de Michel de Certeau sur les tactiques de résistance quotidienne : il s’agit de perturber, par la logique même de l’absurde, les rythmes et les finalités imposées par l’organisation rationnelle de l’espace urbain.
Les déambulations d’Alÿs s’inscrivent dans cette tradition théorique qui, de Baudelaire à Certeau en passant par les Situationnistes, pense la marche urbaine comme pratique critique. Mais Alÿs radicalise cette approche en transformant ses déplacements en événements artistiques documentés. Ses parcours ne relèvent plus de l’expérience subjective du flâneur mais de la construction d’objets artistiques qui interrogent les modalités contemporaines de circulation et de contrôle dans l’espace métropolitain.
Cette approche trouve une résonance particulière dans le contexte mexicain, où la rapide urbanisation et l’informalité de nombreux quartiers créent des espaces de friction entre planification officielle et usages populaires. Alÿs développe une poétique de ces interstices, révélant comment les habitants inventent quotidiennement des modes d’occupation qui échappent aux logiques dominantes d’aménagement.
L’efficacité critique des actions d’Alÿs tient à leur capacité à révéler, par le détournement minimal de gestes quotidiens, les structures invisibles qui organisent l’expérience urbaine. En marchant différemment, en s’arrêtant là où l’on ne s’arrête habituellement pas, en collectant ce que l’on néglige ordinairement, l’artiste actualise la fonction révélatrice de l’art que Certeau assignait aux pratiques quotidiennes de résistance.
La documentation vidéographique de ces actions ne constitue pas un simple enregistrement mais participe de leur efficacité critique. En transformant l’éphémère en archive, en rendant reproductible l’irréproductible, Alÿs interroge également les modalités contemporaines de circulation et de validation de l’art. Ses vidéos fonctionnent comme des virus, se propageant dans les circuits artistiques internationaux et contaminant d’autres contextes urbains par leurs questionnements.
Cette dimension politique de la marche trouve son prolongement dans les projets géopolitiques d’Alÿs, notamment “The Green Line” (2004), où l’artiste suit à pied, en versant de la peinture verte, la ligne d’armistice de 1948 à Jérusalem. L’action révèle l’arbitraire de toute frontière en même temps qu’elle réactualise, par la simple présence physique du marcheur, des divisions que les accords diplomatiques s’efforcent de naturaliser.
Cette politique de la déambulation trouve ses fondements théoriques dans l’analyse que propose Certeau des “arts de faire” quotidiens. Pour le théoricien français, ces pratiques ordinaires constituent des formes de résistance micropolitique qui, sans renverser les structures dominantes, les perturbent suffisamment pour créer des espaces de liberté. Alÿs radicalise cette analyse en transformant ces perturbations en événements artistiques qui révèlent la dimension politique de gestes apparemment anodins.
Le partage du sensible et la redistribution des rôles
La pratique artistique de Francis Alÿs trouve un second éclairage théorique essentiel dans les réflexions de Jacques Rancière sur le “partage du sensible” et la fonction politique de l’art. Pour Rancière, l’art politique ne consiste pas à véhiculer des messages politiques mais à redistribuer les partages entre le visible et l’invisible, entre le dicible et l’indicible, qui structurent l’ordre social [2]. Cette perspective permet de saisir la dimension proprement politique des interventions d’Alÿs, qui ne relèvent jamais de la propagande mais de la redistribution des perceptions.
Dans “When Faith Moves Mountains” (2002), Alÿs organise le déplacement collectif d’une dune de sable à Lima, au Pérou, mobilisant cinq cents volontaires munis de pelles. L’action, d’une futilité évidente du point de vue de l’efficacité géologique, redistribue radicalement les rôles sociaux habituels. Des habitants des bidonvilles de Ventanilla, ordinairement invisibles dans l’espace public péruvien, deviennent les protagonistes d’un événement artistique international. Cette redistribution des rôles constitue l’enjeu politique véritable de l’action : elle rend visible une population habituellement reléguée aux marges de la représentation.
Cette dimension politique ne relève pas du contenu explicite de l’oeuvre mais de sa forme même. En organisant une action collective autour d’un objectif apparemment absurde, Alÿs suspend temporairement les logiques de rentabilité et d’efficacité qui régissent ordinairement l’organisation sociale. Cette suspension ouvre un espace de possibilité où d’autres modalités de coexistence peuvent émerger, fût-ce temporairement.
Rancière insiste sur le fait que l’art politique ne consiste pas à représenter le politique mais à reconfigurer les conditions mêmes de la représentation. Les actions d’Alÿs opèrent exactement selon cette logique : elles ne dénoncent pas explicitement les inégalités sociales mais créent des situations où ces inégalités deviennent perceptibles autrement. Dans “The Green Line”, l’artiste ne prend pas parti dans le conflit israélo-palestinien mais rend sensible l’arbitraire de toute frontière en même temps que sa réalité contraignante.
Cette approche trouve une résonance particulière dans le contexte latino-américain, où les rapports entre art et politique ont longtemps été pensés sur le mode de l’engagement explicite. Alÿs développe une alternative à cette tradition en explorant les modalités indirectes par lesquelles l’art peut intervenir dans l’espace public. Ses actions ne militent pas pour une cause précise mais créent des situations où les spectateurs sont amenés à reconsidérer leurs perceptions habituelles de l’espace social.
La série “Children’s Games” (1999-présent) illustre de façon exemplaire cette politique de la redistribution perceptuelle. En documentant des jeux d’enfants dans des contextes géopolitiques tendus (Afghanistan, Irak, Ukraine), Alÿs ne verse jamais dans le misérabilisme mais révèle la persistance de formes de vie qui échappent aux logiques de la guerre. Cette persistance ne constitue pas un message d’espoir mais une donnée anthropologique fondamentale : malgré les contextes les plus dramatiques, l’invention ludique continue de structurer l’expérience enfantine.
Cette dimension anthropologique des oeuvres d’Alÿs rejoint les préoccupations de Rancière concernant la capacité de l’art à révéler des formes de vie ignorées par les discours dominants. En documentant ces jeux enfantins, l’artiste ne produit pas un témoignage sur la guerre mais révèle la coexistence de temporalités différentes au sein d’un même espace social. Cette coexistence perturbe les représentations univoques de la violence géopolitique en révélant la complexité irréductible du réel.
L’efficacité politique de ces documentations tient à leur capacité à suspendre nos catégories habituelles de perception. Face aux images d’enfants jouant dans les décombres de Mossoul, le spectateur ne peut plus maintenir une représentation uniforme de la guerre. Cette suspension des certitudes perceptuelles constitue, selon Rancière, la fonction politique spécifique de l’art : non pas convaincre mais troubler, non pas enseigner mais désorienter.
Les peintures d’Alÿs participent de cette même logique de redistribution perceptuelle. Ses petites toiles, souvent réalisées la nuit, fonctionnent comme des condensés poétiques de ses actions. Elles ne constituent pas des illustrations de ses performances mais des objets autonomes qui explorent d’autres modalités de rapport à l’espace et au temps. Par leur échelle réduite et leur facture délicate, elles contrastent avec l’ampleur géographique des actions qu’elles accompagnent, créant un jeu d’échelles qui perturbe nos habitudes perceptuelles.
Cette approche multimédiale permet à Alÿs d’explorer différentes modalités de la résistance esthétique. Ses actions interrogent les usages de l’espace public, ses peintures révèlent des temporalités alternatives, ses vidéos questionnent les modalités de circulation de l’art contemporain. Cette multiplication des supports ne relève pas de l’opportunisme mais d’une stratégie cohérente d’intervention dans différents régimes de sensibilité.
La force critique de l’oeuvre d’Alÿs tient finalement à sa capacité à éviter l’écueil du didactisme sans tomber dans l’esthétisme. Ses interventions ne délivrent pas de messages explicites mais créent des situations où l’ordre habituel des perceptions se trouve momentanément suspendu. Cette suspension ouvre des possibilités de reconfigurations perceptuelles qui constituent l’enjeu politique véritable de son travail.
L’art comme laboratoire d’alternatives
L’oeuvre de Francis Alÿs interroge fondamentalement les modalités contemporaines de résistance à la rationalisation néolibérale de l’existence. Face à la marchandisation croissante de l’espace urbain et à l’accélération des rythmes sociaux, l’artiste développe une pratique de la lenteur et de l’apparente inefficacité qui constitue une forme de résistance passive aux logiques dominantes de productivité.
Cette résistance ne relève pas de la nostalgie mais de l’invention de modalités alternatives d’existence collective. Les actions d’Alÿs fonctionnent comme des laboratoires où s’expérimentent d’autres rapports au temps, à l’espace et à l’efficacité. Dans “Rehearsal I” (1999-2001), une Volkswagen rouge tente inlassablement de gravir une côte à Tijuana, échouant systématiquement et recommençant à chaque fois. Cette répétition obsessionnelle interroge les mythologies du progrès qui structurent l’imaginaire de la modernisation latino-américaine.
L’efficacité critique de cette pièce tient à sa capacité à révéler l’aspect sisyphéen de nombreuses entreprises de développement économique. En transformant l’échec en spectacle esthétique, Alÿs ne tombe pas dans le cynisme mais révèle la dimension tragique et comique de certaines aspirations collectives. Cette révélation ne débouche pas sur une leçon morale mais sur une suspension des certitudes qui permet d’envisager autrement les enjeux du développement.
Les projets récents d’Alÿs en Afghanistan et en Irak révèlent une évolution significative de sa pratique vers des contextes de plus en plus dramatiques. Cette évolution ne relève pas de la recherche du sensationnel mais d’une radicalisation de ses questionnements sur les modalités de coexistence dans des espaces de conflit. Dans “Reel-Unreel” (2011), deux enfants afghans courent dans les rues de Kaboul en déroulant et enroulant alternativement une pellicule de film. Cette action simple révèle la persistance de formes de jeu et d’invention dans un contexte de guerre permanente.
Ces documentations posent des questions complexes sur les modalités éthiques de représentation de la guerre. Alÿs évite systématiquement le misérabilisme en se concentrant sur les formes de résistance quotidienne que développent les populations civiles. Cette approche rejoint les réflexions de Susan Sontag sur la photographie de guerre : plutôt que de documenter la souffrance, il s’agit de révéler les formes de vie qui persistent malgré la violence.
L’originalité d’Alÿs tient à sa capacité à éviter les pièges du voyeurisme humanitaire sans tomber dans l’esthétisation de la violence. Ses documentations révèlent comment l’art peut intervenir dans des contextes de conflit sans prétendre les résoudre. Cette modestie constitue paradoxalement la force politique de son travail : en renonçant aux grandes déclarations, il ouvre des espaces de réflexion plus nuancés sur les enjeux géopolitiques contemporains.
La dimension internationale de la carrière d’Alÿs pose également des questions sur les modalités de circulation de l’art critique dans les circuits institutionnels. Ses oeuvres, exposées dans les plus prestigieuses institutions artistiques occidentales, interrogent les rapports entre résistance esthétique et intégration marchande. Cette tension n’invalide pas la portée critique de son travail mais révèle les contradictions structurelles de l’art contemporain.
L’efficacité des oeuvres d’Alÿs tient finalement à leur capacité à créer des situations de réflexion plutôt que des objets de consommation culturelle. Ses actions fonctionnent comme des catalyseurs qui révèlent les tensions latentes de l’espace social sans prétendre les résoudre. Cette fonction révélatrice constitue l’apport spécifique de l’art aux débats politiques contemporains : non pas apporter des solutions mais complexifier les termes des problèmes.
L’oeuvre de Francis Alÿs nous invite ainsi à repenser les modalités contemporaines de la critique sociale. Face aux formes spectaculaires de la contestation politique, il développe une esthétique de la discrétion qui révèle la dimension politique de gestes apparemment anodins. Cette révélation ne débouche pas sur des programmes d’action mais sur une sensibilisation aux enjeux micropolitiques qui structurent l’existence quotidienne.
La force de cette approche tient à sa capacité à éviter l’écueil du moralisme sans tomber dans l’indifférence esthétique. Les interventions d’Alÿs créent des situations où les spectateurs sont amenés à reconsidérer leurs rapports habituels à l’espace, au temps et à l’efficacité. Cette reconsidération constitue un préalable nécessaire à toute transformation politique véritable : elle révèle la contingence de nos évidences perceptuelles et ouvre des possibilités d’organisation alternative de l’expérience collective.
L’art de Francis Alÿs nous enseigne finalement que la résistance politique peut emprunter des voies détournées, que l’efficacité critique ne se mesure pas nécessairement à l’amplitude des transformations produites mais à la qualité des questionnements suscités. Dans un monde où les formes spectaculaires de la contestation semblent souvent récupérées par les logiques qu’elles prétendent combattre, Alÿs explore les potentialités politiques de la modestie, de la lenteur et de l’apparente inefficacité. Cette exploration constitue un apport précieux aux réflexions contemporaines sur les modalités de la critique sociale et les fonctions politiques de l’art.
- Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990.
- Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.