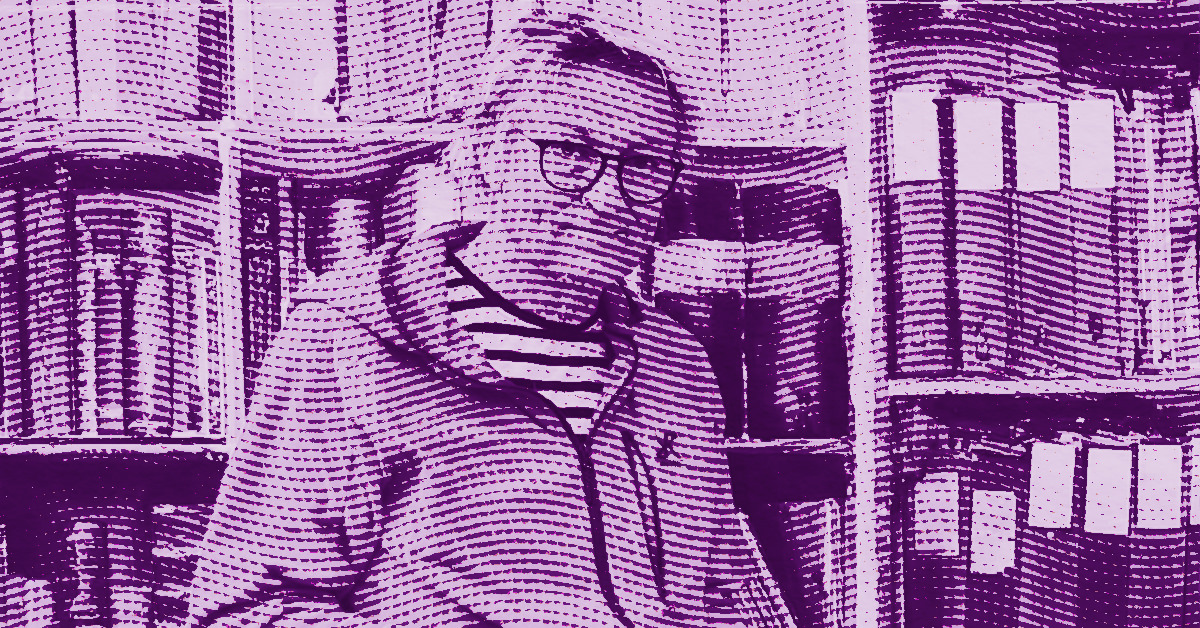Écoutez-moi bien, bande de snobs : si vous croyez encore que l’aquarelle n’est qu’un passe-temps dominical pour retraités nostalgiques, alors vous n’avez jamais contemplé les 450 centimètres de chaos maîtrisé d’un Lars Lerin. Ce Suédois, né dans les forêts de Munkfors en 1954, ne peint pas l’eau, il sculpte le temps, dirait Tarkovski. Et cette métaphore n’est pas fortuite.
Dans le milieu artistique scandinave, Lars Lerin occupe une position singulière qui défie les classifications hâtives. Formé à l’école de Gerlesborg puis aux Beaux-Arts de Valand à Göteborg entre 1980 et 1984, il s’est imposé comme l’un des aquarellistes les plus influents de sa génération, dépassant largement les frontières nordiques pour toucher l’âme européenne et américaine. Son musée permanent Sandgrund à Karlstad, inauguré en 2012, témoigne de cette reconnaissance institutionnelle, mais c’est dans la confrontation directe avec ses oeuvres monumentales que se révèle la véritable mesure de son génie.
Car Lerin opère une révolution silencieuse dans l’art de l’aquarelle. Là où l’on attend la délicatesse bourgeoise, il impose la brutalité poétique. Ses formats, souvent dépassant les 3 mètres, transforment l’intimité traditionnelle du medium en expérience immersive. “Je peins ce que je vois, pas ce que je sais”, déclare-t-il [1], écho troublant aux préceptes de Turner qu’il semble réinventer pour notre époque désenchantée.
La temporalité de Tarkovski ou l’art de sculpter l’instant
Il existe dans l’oeuvre de Lars Lerin une qualité temporelle qui évoque immédiatement l’univers cinématographique d’Andreï Tarkovski. Cette parenté n’est pas accidentelle : elle révèle une approche commune de l’art comme exploration métaphysique de l’existence humaine face à l’immensité naturelle.
Tarkovski, dans son ouvrage Le Temps scellé, théorisait le cinéma comme un art du temps pur, distinct du montage d’Eisenstein par sa capacité à capter la durée réelle. Les aquarelles de Lerin procèdent d’une démarche similaire : elles ne représentent pas un instant figé, mais portent en elles la mémoire du processus de création, cette “technique humide sur humide” [2] qui laisse l’eau et le pigment interagir selon leurs propres lois physiques.
Cette temporalité particulière se manifeste dans ses séries de Lofoten, archipel norvégien où il a vécu douze années déterminantes. Ses visions de Henningsvær ou ses Motifs des Lofoten ne saisissent pas la beauté touristique des paysages, mais leur mélancolie existentielle. Comme chez Tarkovski, l’obscurité n’est pas absence de lumière mais révélation d’une vérité plus profonde. Dans Fjord (2015), les mouettes volent bas sur l’eau sombre tandis que quelques bâtiments se pressent sur la rive, “sous le couvert de l’obscurité envahissante” [3]. L’écriture manuscrite qui traverse l’oeuvre crée un effet de distanciation que Tarkovski utilisait pour maintenir le spectateur dans un état de questionnement contemplatif.
L’influence de Tarkovski se retrouve également dans le traitement de l’architecture. Les maisons isolées de Lerin, ces “caravanes garées près d’une maison” ou ces “garages aux Lofoten” évoquent les bâtiments en ruine du maître russe, toujours sur le point d’être reconquis par la nature. Cette vulnérabilité architecturale exprime “la condition existentielle dans un environnement enveloppé par l’obscurité de l’hiver arctique” [3], thème central de la filmographie de Tarkovski où l’homme demeure éternellement en quête de sens face à l’infinité cosmique.
Mais c’est peut-être dans son rapport à la mémoire que Lerin rejoint le plus intimement Tarkovski. Ses oeuvres fonctionnent par accumulation de souvenirs visuels et textuels, créant ces “instantanés de mémoires qui capturent des impressions de vie et de chaleur telles qu’elles n’existent peut-être plus” [4]. Cette nostalgie n’est pas complaisante : elle devient instrument de connaissance, moyen d’accéder à une vérité poétique supérieure à la simple représentation naturaliste.
Lerin pratique ce que l’on pourrait nommer une “archéologie de l’instant”. Ses carnets de voyage se transforment en méditations visuelles où la géographie extérieure révèle les paysages intérieurs. Cette double exploration spatiale et temporelle s’épanouit dans ses grandes compositions où “différents noirs, ocre et outremer français” [5] composent des symphonies chromatiques d’une sophistication rare. L’artiste ne cherche pas à reproduire mais à révéler, travaillant “sur une table de ping-pong” [5] ces formats gigantesques qui transforment l’atelier en laboratoire d’expérimentation temporelle.
L’inquiétante étrangeté du familier
L’oeuvre de Lars Lerin trouve sa profondeur particulière dans ce que Sigmund Freud nomme das Unheimliche, l’inquiétante étrangeté. Cette notion psychanalytique, développée en 1919, désigne cette sensation troublante qui surgit lorsque le familier révèle soudain sa dimension cachée, secrète, potentiellement menaçante.
Chez Lerin, cette inquiétante étrangeté opère à plusieurs niveaux. D’abord dans son traitement des objets du quotidien : ses natures mortes de “porcelaine et de verrerie” transforment les ustensiles domestiques en présences énigmatiques. Les chaises qu’il peint deviennent “portraits” selon la curatrice Bera Nordahl, révélant “les caractéristiques personnelles et relationnelles dans le style, l’usure, la distance entre les chaises et leur placement directionnel” [6]. Ces sièges vides portent l’empreinte fantôme de leurs occupants absents, créant cette tension entre présence et absence caractéristique de l’unheimlich freudien.
Plus troublant encore, son travail sur les dioramas du Muséum d’Histoire naturelle de Göteborg révèle l’essence même de l’inquiétante étrangeté. Ces “animaux empaillés” qu’il peint “à l’intérieur de la vitrine” avec “l’arrière-plan derrière le photographe reflété dans le verre” [6] créent un monde aux multiples strates ontologiques. Que regardons-nous ? L’animal naturalisé ? Sa représentation picturale ? Le reflet du monde vivant dans la vitrine ? Cette stratification vertigineuse évoque directement l’analyse freudienne des automates et figures de cire, ces objets qui brouillent la frontière entre animé et inanimé.
L’inquiétante étrangeté de Lars Lerin trouve son expression la plus saisissante dans ses architectures dépeuplées. Ses maisons isolées dans la campagne suédoise ou norvégienne ne sont jamais simplement pittoresques : elles portent en elles une menace sourde, celle de l’abandon, de la disparition. Ces bâtisses “vulnérables aux éléments toujours présents” évoquent ce que Freud identifie comme le retour du refoulé, ici, la précarité fondamentale de notre inscription dans le monde.
L’écriture manuscrite qui traverse ses compositions ajoute une dimension supplémentaire à cette inquiétante étrangeté. Ces fragments de texte, souvent illisibles, fonctionnent comme des intrusions de l’inconscient dans l’ordre représentatif. Ils créent cette “autre dimension, association au journal, aux lettres” [7] que revendique l’artiste, mais ils génèrent simultanément une tension cognitive chez le spectateur, confronté à un message qu’il ne peut déchiffrer totalement.
Cette esthétique de l’incertitude trouve son apogée dans les oeuvres où Lerin mélange photographie mentale et création pure. Travaillant “d’impressions directes aux pièces plus complexes” où il s’arrête et “recommence après quelque temps pour une vision plus fraîche” [7], il instaure une temporalité de l’entre-deux qui déstabilise nos repères perceptuels. Ses paysages ne sont ni tout à fait mémoire ni tout à fait observation : ils occupent cet espace intermédiaire que Freud identifie comme le territoire privilégié de l’unheimlich.
L’alchimie de l’éphémère
La technique de Lerin révèle une maîtrise paradoxale : contrôler l’incontrôlable. Cette approche “humide sur humide”, où l’artiste “vaporise toute la feuille de papier et utilise ses pigments en lavis intuitifs de couleur dans les premières minutes pour obtenir cette qualité atmosphérique” [8], instaure un dialogue permanent avec l’accident créateur. Cette acceptation de l’imprévu s’inscrit dans une tradition esthétique qui va de Turner aux expressionnistes abstraits, mais Lerin y ajoute sa sensibilité nordique particulière.
Son rapport à la couleur témoigne de cette recherche d’équilibre entre maîtrise et lâcher-prise. Privilégiant “différents noirs, ocre et outremer français” [5], il construit ses harmonies sur des terres et des ombres plutôt que sur l’éclat. Cette palette volontairement restreinte génère une intensité émotionnelle d’autant plus forte qu’elle économise ses effets. Ses gris, “profonds et sombres, ou éthérés et brillants, semblant illuminer l’image de l’intérieur de manière magique” [9], révèlent une compréhension profonde des pouvoirs expressifs de la monochromie.
Cette économie chromatique sert un projet esthétique plus large : révéler l’extraordinaire dans l’ordinaire. Lerin ne peint pas des paysages de cartes postales mais des “conditions existentielles”, ces moments où l’être humain se trouve confronté à sa solitude fondamentale. Ses Promeneurs nocturnes avancent “vers nous, pataugeant dans la neige profonde le long d’une rue où l’on voit scintiller l’aurore boréale dans le ciel au-dessus” [3], mais toute cette beauté demeure “derrière le dos du promeneur nocturne, il ne la voit ni ne l’apprécie. Il est enfermé en lui-même dans le froid”.
Cette mélancolie n’est jamais complaisante chez Lerin. Elle procède d’une lucidité artistique qui assume sa fonction cathartique. Comme il l’explique lui-même : “Peindre et travailler avec des images (et des mots) est ma façon de gérer la vie, une sorte de méditation quotidienne, de routine” [7]. L’art devient ainsi instrument de survie psychique, moyen de transformer l’angoisse existentielle en beauté contemplative.
Cette transformation s’opère notamment par le gigantisme de ses formats. Ses oeuvres de “206 x 461 centimètres” ne cherchent pas l’effet spectaculaire mais l’immersion totale. Elles créent un environnement visuel qui enveloppe le spectateur, l’obligeant à une expérience physique autant qu’esthétique. Cette dimension incarnée de la réception esthétique rappelle que l’art de Lerin ne s’adresse pas seulement à l’intelligence mais à la sensibilité globale de l’être humain.
La poétique de l’absence
Au coeur de l’esthétique de Lars Lerin résonne une interrogation fondamentale sur l’absence et la perte. Cette préoccupation traverse l’ensemble de son oeuvre, depuis ses premières explorations dans le Värmland jusqu’à ses récents retours dans l’archipel des Lofoten documentés par la télévision suédoise en 2016.
L’absence se manifeste d’abord dans ses architectures dépeuplées. Ces maisons, ces garages, ces entrepôts à poissons ne sont jamais habités dans l’instant de la représentation. Ils portent les traces de la présence humaine, usure, patine et aménagements, mais demeurent fondamentalement vides. Cette vacuité n’est pas neutre : elle interroge notre rapport au lieu, à l’enracinement, à la permanence des choses humaines face à l’indifférence naturelle.
L’absence devient particulièrement poignante dans ses représentations d’objets domestiques. Ses chaises vides fonctionnent comme des portraits en creux, évoquant par leur seule disposition les relations humaines qui les ont façonnées. Cette capacité à faire parler l’inanimé révèle une sensibilité poétique rare, capable de déceler l’humain dans ses traces les plus ténues.
Mais c’est peut-être dans son traitement de la temporalité que Lerin développe sa poétique de l’absence la plus sophistiquée. Ses paysages ne saisissent jamais l’instant présent mais toujours un temps révolu ou suspendu. Cette temporalité fantôme s’exprime dans sa technique même : l’aquarelle capture l’évaporation de l’eau, transformant le processus de disparition en événement esthétique.
Cette esthétique de l’évanescence trouve son aboutissement dans ses oeuvres les plus récentes, où l’artiste explore “des pays lointains, ainsi que du coin de la rue dans le Värmland” [10]. Cette géographie élargie ne dilue pas sa poétique mais l’universalise : partout, l’homme demeure confronté aux mêmes questionnements existentiels, aux mêmes angoisses face au temps qui passe et aux certitudes qui s’effritent.
L’oeuvre de Lars Lerin constitue ainsi une méditation continue sur la condition humaine contemporaine. Dans un monde de plus en plus urbanisé et dématérialisé, il maintient vivante une relation sensuelle et spirituelle à la nature et au temps. Ses aquarelles fonctionnent comme des oasis de contemplation dans le flux accéléré de notre époque, rappelant que l’art conserve ce pouvoir unique de ralentir le temps et d’approfondir notre rapport au réel.
Cette capacité à toucher l’universel par le particulier explique le succès considérable de Lerin en Scandinavie et au-delà. Ses expositions attirent des foules qui retrouvent dans ses paysages une part d’eux-mêmes oubliée ou refoulée. Car au-delà de sa virtuosité technique indiscutable, Lerin possède ce don rare de révéler la beauté mélancolique du monde, cette beauté qui naît précisément de la conscience de sa fragilité.
Face à ses grandes compositions, le spectateur fait l’expérience de ce que l’on pourrait nommer un “sublime nordique”, mélange d’élévation esthétique et d’angoisse métaphysique caractéristique de la sensibilité scandinave. Cette esthétique de l’ambivalence, où beauté et inquiétude se mêlent inextricablement, place Lars Lerin parmi les artistes les plus authentiques de notre temps, ceux qui refusent les consolations faciles pour affronter directement les questions ultimes de l’existence humaine.
Son influence s’étend désormais bien au-delà du cercle restreint des amateurs d’aquarelle. Reconnu par l’Académie royale des Beaux-Arts de Stockholm, lauréat du prix August 2014 pour son livre Naturlära, personnalité télévisuelle de l’année 2016 en Suède, Lerin incarne cette figure rare de l’artiste populaire sans concession esthétique. Sa capacité à toucher simultanément l’élite culturelle et le grand public témoigne de l’authenticité de sa démarche artistique.
Cette réussite ne doit cependant pas masquer la radicalité de son projet esthétique. En réinventant l’aquarelle nordique, Lerin propose une alternative à l’art conceptuel dominant de notre époque. Il revendique un retour aux sources sensorielles de la création, cette “méditation quotidienne” [7] qui fait de l’atelier un laboratoire existentiel autant qu’esthétique.
Cette position singulière dans le paysage artistique contemporain lui permet d’explorer des territoires émotionnels souvent négligés par l’art officiel. Ses oeuvres parlent de solitude sans misérabilisme, de mélancolie sans complaisance, d’angoisse sans désespoir. Elles révèlent cette “nostalgie existentielle commune à nous tous” [4] que notre civilisation technicienne tend à refouler ou à médicaliser.
L’art de Lars Lerin nous rappelle ainsi que la fonction première de l’art demeure l’exploration de la condition humaine dans ses dimensions les plus fondamentales. Face à l’accélération du monde contemporain, ses aquarelles proposent un temps alternatif, celui de la contemplation active et de la reconnaissance silencieuse de notre vulnérabilité commune face à l’immensité du monde.
Cette leçon de sagesse esthétique place Lars Lerin parmi les créateurs essentiels de notre époque, ceux qui maintiennent vivante la tradition humaniste de l’art européen tout en l’adaptant aux sensibilités contemporaines. Son oeuvre constitue un pont entre les préoccupations ancestrales de l’homme nordique et les questionnements universels de notre modernité tardive, offrant à chacun la possibilité de retrouver, le temps d’une contemplation, cette part d’éternité que recèle tout véritable art.
- Konstantin Sterkhov, “Lars Lerin Interview”, Art of Watercolor, 2012
- Hanna August-Stohr, “The Watercolor Worlds of Lars Lerin”, American Swedish Institute, Minneapolis, 2016
- Galleri Lofoten, “A new approach to Lofoten, Lars Lerin”, 2025
- Bera Nordal, Nordic Water Colour Museum, “Watercolour technique is a powerful tool”, 2011
- Konstantin Sterkhov, “Lars Lerin Museum Interview”, Art of Watercolor, 2013
- Susan Kanway, “Lars Lerin at American Swedish Institute”, Art As I See It Blog, 2016
- Konstantin Sterkhov, “Lars Lerin Interview”, Art of Watercolor, 2012
- Hanna August-Stohr, “The Watercolor Worlds of Lars Lerin”, American Swedish Institute, Minneapolis, 2016
- Galleri Lofoten, “Lars Lerin Exhibition Description”, Gallery Lofoten, 2025
- Sune Nordgren, “As Fast as The Eye”, The Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, 2025