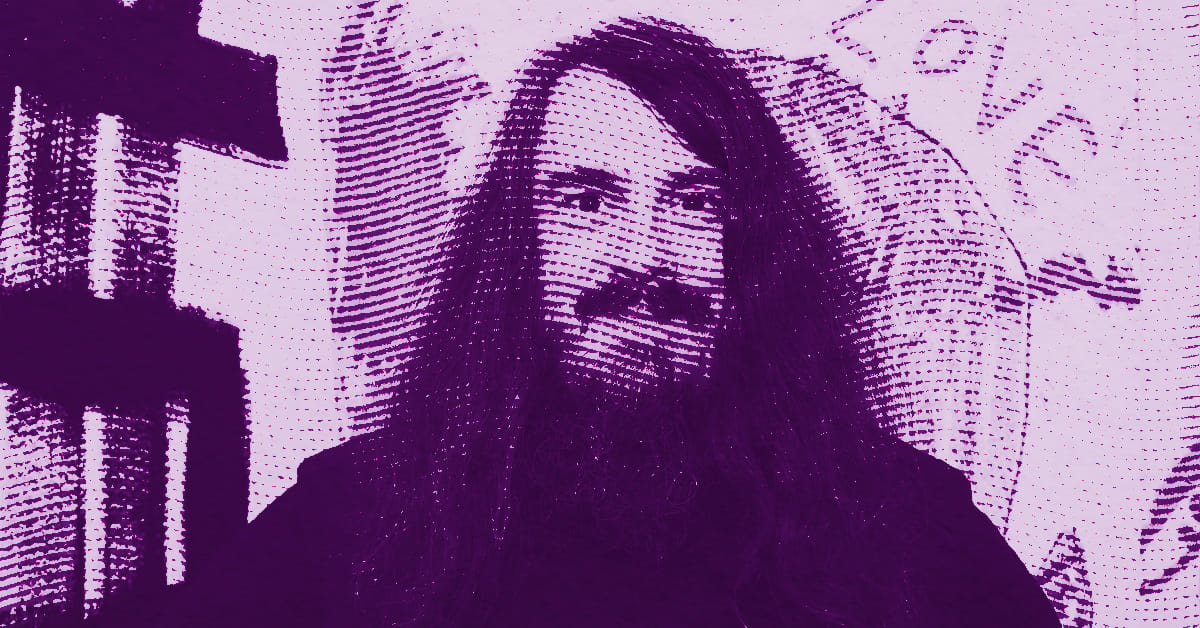Écoutez-moi bien, bande de snobs. Nous voici face à l’un des phénomènes artistiques les plus déroutants et nécessaires de notre époque : Jonathan Meese, cet Allemand né à Tokyo en 1970, qui depuis plus de deux décennies martyrise nos certitudes esthétiques avec une constance admirable. Dans son atelier-bunker de Berlin, entouré de sa mère Brigitte qui joue les sergents instructeurs de l’ordre créatif, Meese fabrique un art qui refuse obstinément de se laisser domestiquer par nos grilles de lecture habituelles. Son univers pictural, peuplé de figures historiques décomposées et de références pop massacrées à coups de pinceau rageur, constitue une expérience visuelle qui nous confronte brutalement à nos propres limites conceptuelles.
L’oeuvre de Meese ne se contente pas d’occuper l’espace muséal avec l’arrogance désinvolte d’un squatteur de luxe. Elle impose sa présence par une violence chromatique et formelle qui sidère autant qu’elle révulse, créant cette sensation particulière d’être pris au piège d’un cauchemar technicolor dont l’issue demeure obstinément invisible. Ses toiles, véritables champs de bataille où s’affrontent pâtes colorées et figures grimaçantes, témoignent d’une urgence expressive qui traverse l’histoire de l’art allemand comme une lame chauffée à blanc. Cette urgence trouve ses racines dans un rapport complexe au pouvoir, à l’autorité, et surtout à cette “Dictature de l’Art” qu’il proclame avec la ferveur d’un évangéliste halluciné.
L’inconscient à l’oeuvre : Jonathan Meese et la machine psychanalytique
L’approche de Jonathan Meese révèle des correspondances troublantes avec les mécanismes de l’inconscient freudien, particulièrement dans sa capacité à transformer les traumatismes collectifs en matière picturale. L’art contemporain, en flirtant avec l’abstraction ou en proposant des oeuvres conceptuelles, invite chacun à projeter ses propres expériences, ses peurs et ses désirs sur l’oeuvre [1], et Meese pousse cette logique jusqu’à ses limites les plus extrêmes. Ses peintures fonctionnent comme des écrans de projection où viennent se cristalliser nos angoisses les plus profondes concernant l’autorité, la violence et la soumission.
L’artiste développe un processus créatif qui évoque irrésistiblement le travail de condensation et de déplacement à l’oeuvre dans la formation des rêves. Ses personnages historiques, Hitler, Napoléon et Wagner, subissent des transformations plastiques qui les dépouillent de leur gravité historique pour les transformer en figures grotesques, presque clownesques. Cette opération de dévaluation symbolique rappelle les mécanismes de défense psychique par lesquels l’individu neutralise ce qui le menace. Meese ne détruit pas ces figures, il les rend ridicules, les vidant de leur puissance fantasmatique par l’excès même de leur représentation.
La présence obsédante de sa mère dans son processus créatif constitue un élément capital pour comprendre la dimension psychanalytique de son oeuvre. Brigitte Meese n’est pas seulement son assistante, elle incarne une autorité maternelle qui structure et canalise les pulsions destructrices de l’artiste. Cette configuration familiale évoque les analyses freudiennes sur la sublimation, processus par lequel les pulsions agressives trouvent une issue socialement acceptable dans la création artistique. Meese lui-même reconnaît que sa mère “apporte de l’ordre” dans sa vie et son atelier, jouant le rôle de surmoi bienveillant qui permet à l’artiste de donner forme à ses obsessions sans sombrer dans l’autodestruction.
Le rapport complexe que Meese entretient avec l’idéologie s’éclaire également sous l’angle psychanalytique. Sa “Dictature de l’Art” fonctionne comme une formation de compromis, permettant d’exprimer des fantasmes de toute-puissance tout en les désamorçant par leur caractère ouvertement délirant. L’artiste projette sur l’art lui-même ses pulsions dominatrices, créant une fiction théorique qui lui permet d’éviter l’engagement politique direct. Cette stratégie d’évitement révèle une structure psychique particulièrement sophistiquée, capable de transformer l’angoisse en énergie créatrice tout en maintenant une distance critique vis-à-vis de ses propres obsessions.
L’analyse de ses autoportraits révèle également une dimension narcissique assumée qui rappelle les descriptions freudiennes du narcissisme primaire. Meese se représente constamment dans ses oeuvres, mais toujours sous des traits déformés, grotesques, qui témoignent d’une relation ambivalente à sa propre image. Cette auto-représentation compulsive évoque le Fort-Da décrit par Freud, ce jeu de répétition par lequel l’enfant maîtrise symboliquement ce qui lui échappe. Meese disparaît et réapparaît dans ses toiles comme s’il tentait de contrôler sa propre existence par la répétition de son image.
La dimension pulsionnelle de son travail se manifeste également dans sa technique picturale brutale, où la peinture est directement pressée du tube sur la toile, évitant toute médiation par le pinceau traditionnel. Cette immédiateté du geste évoque l’expression directe de la libido, sans les sublimations habituelles de la pratique artistique classique. Meese peint comme on évacue une tension, dans l’urgence d’un soulagement qui ne peut être différé.
L’obsession récurrente pour des figures masculines de pouvoir, dictateurs, empereurs et héros wagnériens, révèle une fascination pour l’autorité paternelle que l’artiste s’approprie et déconstruit simultanément. Ces personnages fonctionnent comme des substituts du père symbolique, qu’il peut à la fois vénérer et détruire sans risquer de vraies conséquences. La psychanalyse nous enseigne que l’art peut servir d’espace transitionnel où s’élaborent nos rapports les plus conflictuels à l’autorité, et l’oeuvre de Meese constitue un laboratoire privilégié pour observer ces mécanismes à l’état brut.
Wagner et la tentation de l’oeuvre d’art totale
La relation de Jonathan Meese à Richard Wagner révèle une autre dimension essentielle de son projet artistique : l’aspiration au Gesamtkunstwerk, cette oeuvre d’art totale qui obsède la culture allemande depuis le XIXe siècle. Cette ambition wagnerienne imprègne profondément la pratique de Meese, qui refuse de se cantonner à un médium unique et développe simultanément peinture, sculpture, performance, écriture théorique et mise en scène lyrique. Son approche multidisciplinaire témoigne d’une volonté de saturer l’espace artistique, de créer un environnement total où le spectateur se trouve immergé dans un univers cohérent et oppressant.
L’influence wagnérienne transparaît particulièrement dans les dimensions épiques de ses installations, qui transforment l’espace d’exposition en théâtre de ses obsessions personnelles. Comme Wagner construisait ses opéras selon une dramaturgie totalisante où musique, texte, scénographie et interprétation concouraient à un effet unique, Meese conçoit ses expositions comme des spectacles globaux où chaque élément, peintures, sculptures, vidéos et performances, participe d’une mise en scène d’ensemble. Cette approche orchestrale de l’art contemporain révèle une ambition démiurgique qui n’est pas sans rappeler les rêves de régénération culturelle chers au compositeur.
La production opératique de Meese, notamment sa version de Parsifal créée aux Wiener Festwochen en 2017, constitue l’aboutissement logique de cette démarche totalisante. En s’attaquant au dernier opéra de Wagner, Meese s’inscrit dans une lignée d’artistes allemands hantés par l’héritage du maître de Bayreuth. Mais là où les metteurs en scène traditionnels tentent généralement de domestiquer la dimension mythologique wagnérienne par des lectures psychologiques ou sociologiques, Meese pousse au contraire cette mythologie vers ses extrêmes les plus délirants. Son Parsifal futuriste, peuplé de personnages de science-fiction et situé dans une base lunaire, radicalise l’esthétique wagnérienne au lieu de la neutraliser.
Cette stratégie d’amplification révèle une compréhension subtile des enjeux esthétiques et idéologiques de l’opéra wagnérien. Plutôt que de tenter d’épurer Wagner de ses aspects les plus problématiques, Meese choisit de les exacerber jusqu’à l’absurde, créant une forme de vaccination artistique contre les tentations totalitaires. Son Parsifal devient une parodie des aspirations à la rédemption collective, transformant le drame sacré en opéra de l’espace déjanté où la quête du Graal se mue en aventure de série B.
L’approche scénographique de Meese révèle également une maîtrise consommée des codes visuels wagnériens qu’il détourne à des fins critiques. Les costumes, les décors, les éclairages empruntent au vocabulaire esthétique de Bayreuth tout en le parasitant par des éléments pop et de science-fiction qui en révèlent l’artificialité. Cette contamination stylistique crée un effet de distanciation qui permet au spectateur de percevoir les mécanismes de séduction à l’oeuvre dans l’art de Wagner sans pour autant y succomber.
La dimension temporelle constitue un autre point de convergence entre Wagner et Meese. Comme les opéras de Wagner déploient leurs effets sur des durées inhabituelles qui saturent la perception du spectateur, les installations de Meese créent une temporalité spécifique, dilatée, où l’accumulation d’éléments visuels finit par produire une forme d’épuisement sensoriel. Cette stratégie d’immersion prolongée vise à dépasser les résistances rationnelles du public pour atteindre des zones de réception plus primitives, plus directement émotionnelles.
L’ambition wagnérienne de régénération culturelle trouve chez Meese une traduction contemporaine dans sa théorie de la “Dictature de l’Art”. Comme Wagner rêvait d’un art capable de refonder la société allemande, Meese prophétise l’avènement d’un règne esthétique qui dépasserait les clivages politiques traditionnels. Cette utopie artistique, aussi délirante soit-elle, témoigne d’une permanence des aspirations totalisantes dans la culture allemande, aspirations que Meese réactive tout en les vidant de leur dangerosité par l’excès même de leur formulation.
L’héritage de Wagner transparaît aussi dans la conception que Meese se fait du rôle de l’artiste. Comme Wagner se posait en réformateur culturel total, théoricien autant que créateur, Meese développe un corpus théorique proliférant où il expose sa vision du monde et de l’art. Ses manifestes, ses interviews, ses performances théoriques participent de cette ambition pédagogique qui fait de l’artiste un guide spirituel de son époque. Cette posture prophétique, héritée du romantisme allemand et amplifiée par Wagner, trouve chez Meese une expression contemporaine qui en révèle à la fois la nécessité et les limites.
L’esthétique de la contradiction
Ce qui frappe d’emblée dans l’univers de Jonathan Meese, c’est sa capacité à maintenir en tension des éléments apparemment incompatibles. D’un côté, cet homme de plus de cinquante ans qui vit encore avec sa mère proclame la nécessité d’une “Dictature de l’Art” avec la véhémence d’un tribun révolutionnaire. De l’autre, il développe une pratique picturale d’une tendresse inattendue, où les couleurs éclatantes et les formes biomorphes évoquent autant l’univers de l’enfance que les cauchemars de l’âge adulte. Cette schizophrénie assumée constitue peut-être la clé de voûte de son système esthétique : refuser tout confort interprétatif, maintenir le spectateur dans un état d’incertitude productive.
Ses peintures récentes, notamment celles consacrées à Scarlett Johansson ou aux figures maternelles, révèlent une sensibilité chromatique qui n’a rien à envier aux grands coloristes de l’histoire de l’art. Mais cette maîtrise technique se trouve constamment sabotée par des éléments volontairement grossiers : inscriptions au marqueur, collages hasardeux, empâtements brutaux qui transforment chaque toile en champ de bataille esthétique. Meese semble incapable de créer du beau sans immédiatement le souiller, comme s’il craignait les sortilèges de la séduction artistique.
Cette esthétique de l’autosabotage trouve son expression la plus radicale dans ses performances, où l’artiste endosse alternativement les rôles du bouffon et du dictateur, du prophète et du charlatan. Ses apparitions publiques, toujours spectaculaires, créent un malaise productif qui interroge nos attentes vis-à-vis de la figure de l’artiste contemporain. En refusant la posture de l’intellectuel distingué comme celle du rebel romantique, Meese invente une persona artistique inédite, à la fois grotesque et charismatique, qui déstabilise nos habitudes de réception.
Son rapport à l’histoire allemande illustre parfaitement cette logique contradictoire. Plutôt que d’éviter les symboles compromettants ou de les dénoncer frontalement, il choisit de les incorporer à son univers esthétique en les vidant de leur charge dramatique par la répétition et la déformation. Cette stratégie d’épuisement symbolique révèle une intelligence tactique remarquable : en transformant les icônes du mal en marionnettes colorées, Meese leur ôte leur pouvoir de fascination tout en préservant leur fonction critique.
L’accumulation d’objets hétéroclites dans ses installations participe de cette même logique de saturation sémantique. Jouets, artefacts militaires, références pop, fragments d’oeuvres classiques se côtoient dans un chaos organisé qui défie toute tentative de hiérarchisation culturelle. Cette égalisation par l’excès produit un effet de vertige qui nous confronte à l’arbitraire de nos échelles de valeur esthétique. Chez Meese, un masque de Dark Vador vaut un buste de Napoléon, et cette équivalence assumée constitue peut-être sa contribution la plus subversive au débat artistique contemporain.
Au-delà du spectacle : La question de la nécessité
Derrière le cirque médiatique et les provocations calculées, l’oeuvre de Jonathan Meese pose une question fondamentale : celle de la nécessité de l’art dans nos sociétés désenchantées. Sa “Dictature de l’Art”, malgré ses aspects délirants, formule une exigence légitime : que l’art retrouve une fonction sociale qui dépasse le simple divertissement culturel ou l’investissement spéculatif. En proclamant que seul l’art peut sauver l’humanité des idéologies mortifères, Meese réactive une tradition utopique qui traverse l’histoire de la modernité artistique, de l’avant-garde russe au surréalisme français.
Cette dimension prophétique ne doit pas masquer la rigueur de sa démarche formelle. Meese maîtrise parfaitement les codes de l’art contemporain international, mais il choisit de les détourner au service d’un projet personnel qui échappe aux catégories critiques habituelles. Ses collaborations avec Albert Oehlen, Daniel Richter ou Tal R témoignent d’une capacité de dialogue avec ses pairs qui contredit l’image d’un artiste isolé dans ses obsessions. Cette dimension collective de son travail révèle une stratégie de résistance face à l’individualisme forcené du marché de l’art contemporain.
L’évolution récente de sa pratique, marquée par un refus de se déplacer pour ses expositions et par un recentrage sur son atelier berlinois, suggère une maturation qui mérite attention. En choisissant la sédentarité contre la nomadisme artistique, Meese affirme la primauté du processus créatif sur sa médiatisation. Cette sagesse inattendue, chez un artiste réputé pour ses excès, témoigne d’une lucidité croissante sur les pièges du système artistique actuel.
Ses oeuvres récentes, moins chargées symboliquement que ses productions des années 2000, révèlent un apaisement relatif qui n’exclut pas l’intensité expressive. Les séries consacrées aux masques en céramique ou aux paysages mentaux montrent un artiste capable d’évoluer sans renier ses obsessions fondamentales. Cette capacité de renouvellement, rare dans le milieu de l’art contemporain, suggère que Meese pourrait bien dépasser le statut d’enfant terrible qui lui colle à la peau pour accéder à une reconnaissance plus durable.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit finalement : Jonathan Meese nous confronte à nos propres limites, à nos peurs, à nos désirs refoulés avec une brutalité salutaire qui fait de chaque confrontation avec son oeuvre une expérience transformatrice. Dans un paysage artistique souvent policé par les impératifs marchands et les convenances institutionnelles, il maintient vivante cette fonction dérangeante de l’art qui nous oblige à questionner nos certitudes. Et pour cela, paradoxalement, nous pouvons lui être reconnaissants. Même si, surtout si, son art nous met profondément mal à l’aise en nous confrontant à nos propres limites.
- “Le sujet, la psychanalyse et l’art contemporain”, Cairn.info, 2012