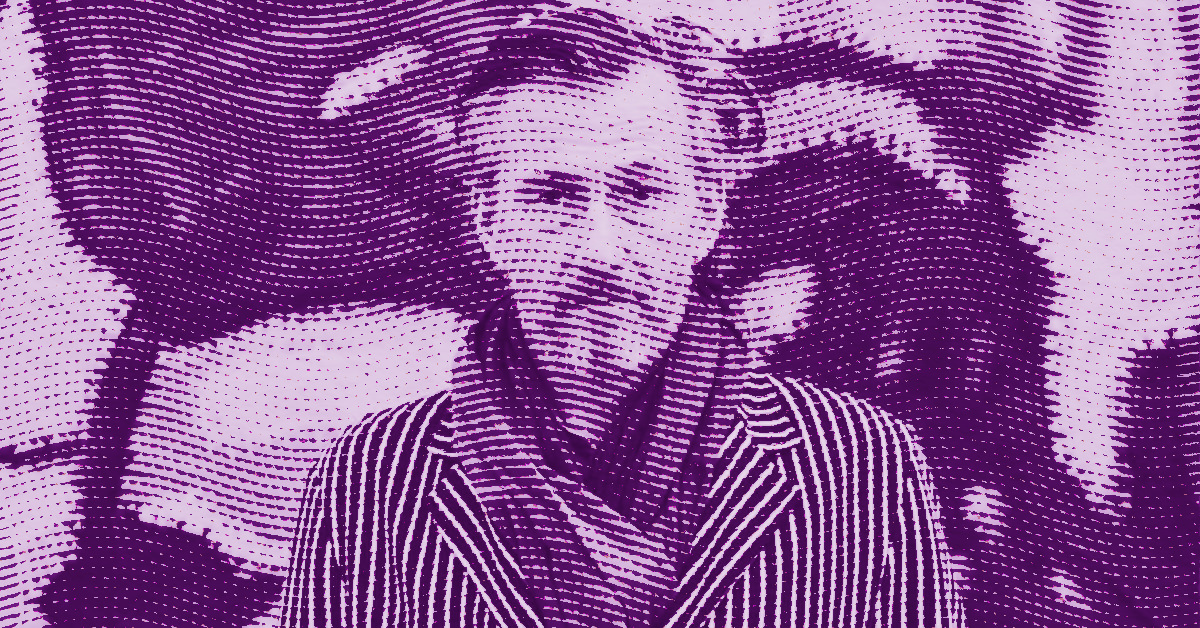Écoutez-moi bien, bande de snobs. Quand Gunter Damisch déclarait que son système pictural était guidé par l’idée de transformation et de métamorphose, il ne faisait pas que prononcer une formule creuse destinée aux catalogues d’exposition. Cet homme, disparu trop tôt en 2016 à l’âge de cinquante-huit ans, avait compris quelque chose d’essentiel sur la nature même de l’art contemporain : que la peinture pouvait être simultanément massage des cellules nerveuses et cartographie de l’invisible.
Damisch appartenait à cette génération des Nouveaux Sauvages autrichiens qui, au début des années 1980, bousculait les codes établis aux côtés d’Otto Zitko et Hubert Scheibl. Mais contrairement à ses contemporains, il développa rapidement une voie singulière, celle d’un explorateur des territoires limites entre science et sensibilité, entre macrocosme et microcosme. Ses toiles, peuplées de créatures organiques aux tentacules déployés, de formes cristallines en croissance et de concentrations énergétiques galactiques, révèlent un artiste qui avait saisi l’essence même de notre époque : cette tension permanente entre l’infiniment petit et l’infiniment grand qui caractérise notre rapport moderne au monde.
La danse architecturale de l’espace
L’oeuvre de Damisch entretient un dialogue constant avec l’architecture, non pas celle des édifices et des monuments, mais celle des structures invisibles qui organisent notre perception. Ses mondes, ses champs, ses réseaux et ses “Flämmer”, ces créatures plutôt gazeuses qui servent de connecteurs entre les différents mondes de ses compositions, constituent une véritable grammaire spatiale, un vocabulaire architectural de l’intime et du cosmique. Quand il créait ses figures défiant la gravité, dépourvues d’extrémités et semblant flotter dans un système mouvant, Damisch orchestrait une chorégraphie de l’espace qui évoque les recherches les plus audacieuses de l’architecture contemporaine.
Cette approche architecturale se manifeste particulièrement dans sa compréhension de l’espace pictural comme territoire à habiter plutôt qu’à contempler. Ses toiles ne sont pas des fenêtres ouvertes sur un ailleurs, mais des environnements immersifs où le regard du spectateur devient nomade, explorant sans cesse de nouveaux territoires. Comme le rappelait Andrea Schurian, Damisch était un “façonneur de mondes” qui ouvrait l’espace bidimensionnel de la toile vers l’infini par ses enchevêtrements colorés sériels, ses effacements et ses grattages.
L’architecte Tadao Ando parle de l’importance du vide dans la création spatiale [1]. Chez Damisch, ce vide devient positif, générateur de formes et de mouvements. Ses espaces picturaux illimités, structurés par l’interférence entre le grand et le petit, créent une architecture de l’expérience plutôt qu’une architecture de l’objet. Les lignes serpentines qui s’inscrivent dans ses cosmos révèlent une conception spatiale où l’architecture devient flux, mouvement et transformation permanente.
Cette vision architecturale dépasse largement la simple organisation compositionnelle. Elle engage une réflexion sur l’habitat humain dans un monde en perpétuelle mutation. Les “lieux intérieurs” de ses sculptures en bronze, ces espaces refuges peuplés de créatures minuscules, proposent une alternative à l’architecture fonctionnaliste dominante. Damisch imagine des espaces organiques, respirants, où l’humain pourrait retrouver sa place dans l’ordre naturel.
Ses tours réticulaires délicates, plus grandes que nature, constituent de véritables propositions architecturales. Elles suggèrent des structures habitables où la frontière entre intérieur et extérieur s’estompe, où l’architecture devient membrane perméable entre l’homme et son environnement. Cette vision préfigure les recherches contemporaines sur l’architecture biomimétique et les structures adaptatives.
L’influence de l’architecture sur son travail graphique mérite également d’être soulignée. Ses structures rhizomatiques, ses flux de couleur laviques, ses lignes rythmiques serpentines constituent une véritable morphologie emblématique accessible à tous. Ces notations graphiques fonctionnent comme des plans d’architecte de l’invisible, des relevés topographiques d’espaces mentaux où chacun peut projeter ses propres expériences spatiales.
La mélancolie créatrice et l’alchimie des formes
L’oeuvre de Damisch dialogue également avec une tradition littéraire profonde, celle qui explore les correspondances secrètes entre les états d’âme et les formes du monde. Ses “enchevêtrements” et “convolutions” évoquent irrésistiblement l’univers de W.G. Sebald, cet écrivain qui savait transformer la mélancolie en force créatrice. Comme chez l’auteur des “Anneaux de Saturne”, la contemplation des formes naturelles devient chez Damisch le point de départ d’une méditation sur le temps, la mémoire et la transformation.
Cette dimension mélancolique ne relève pas du pessimisme, mais d’une lucidité particulière face aux cycles de destruction et de régénération qui gouvernent le vivant. Quand Damisch observait “les vers et les serpents, les boucles et les lianes, les ruisseaux et les rivières sinueuses, les lignes côtières et les rives, les ruisselets et les trous de vers, les traces de rongement d’insectes dans les écorces et les érosions des eaux”, il pratiquait cette forme de mélancolie active que Sebald qualifiait de “science naturelle de la destruction”.
Ses titres poétiques témoignent de cette sensibilité littéraire particulière. “Weltwegköpflerdurcheinander”, “Köpflerflämmler am Wetlbogen”, “Köpflersteher Weltaffäre” sont des expressions semblant être des mots allemands composés, mais totalement inventés par l’artiste et volontairement absurdes. Ces néologismes révèlent un artiste qui pensait en poète, pour qui la nomination des formes participait de leur création même. Cette approche linguistique de la peinture rappelle les recherches de Paul Celan sur les correspondances entre image et langage.
La mélancolie de Damisch transforme l’observation naturaliste en vision cosmique. Ses créatures monocellulaires aux tentacules déployés, ses formations cristallines, ses concentrations énergétiques galactiques témoignent d’une capacité à percevoir dans le microscopique les lois qui gouvernent l’univers entier. Cette vision mélancolique et scientifique à la fois évoque les “Affinités électives” de Goethe, où l’observation des phénomènes naturels révèle les lois secrètes qui régissent les passions humaines.
Le passage de la picturalité à la textualité dans son oeuvre des années 1990 illustre parfaitement cette dimension littéraire. Damisch développa un cosmos pictural doté de son propre vocabulaire conceptuel, où “Welten”, “Steher”, “Flämmler” et “Wege” devenaient les personnages d’une mythologie personnelle. Cette création linguistique parallèle à la création plastique témoigne d’une approche totale de l’art, où peinture et littérature se nourrissent mutuellement.
Ses collages, intégrant des coupures de journaux et de gravures sur bois dans la surface picturale avant de les recouvrir de peinture, rappellent la technique de la composition par couches successives chère aux écrivains. Comme chez Sebald, le passé affleure sous la surface du présent, créant ces effets de transparence temporelle qui donnent à l’oeuvre sa profondeur mélancolique.
Cette mélancolie créatrice trouve son expression la plus aboutie dans ses sculptures en bronze, que Otto Breicha qualifiait de “modèles épineux pour l’ensemble du monde” [2]. Ces créatures fossilisées semblent porter en elles la mémoire géologique de la terre, témoignant de cette capacité proprement littéraire à percevoir dans le présent les traces du temps long.
L’enseignement comme acte artistique
Professeur pendant plus de vingt ans à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, Damisch révolutionna l’approche pédagogique de l’art. Son enseignement ne visait pas à former des “petits Damisch”, mais à révéler chez chaque étudiant cette “petite plante art” qu’il percevait en chacun. Cette approche pédagogique constitue en elle-même une oeuvre d’art, une sculpture sociale au sens où l’entendait Joseph Beuys.
Damisch considérait l’enseignement comme un processus de transformation mutuelle. Il ne s’agissait pas de transmettre un savoir constitué, mais de créer les conditions d’une découverte commune. Ses étudiants témoignent unanimement de cette capacité unique à créer un climat d’apprentissage où “l’art peut tout et ne doit rien”. Cette formule, qu’il aimait répéter, résume parfaitement sa philosophie pédagogique : offrir un cadre de liberté totale tout en maintenant les exigences les plus hautes.
Cette approche trouvait son origine dans sa propre formation auprès d’Arnulf Rainer et Max Melcher, mais aussi dans son expérience de musicien au sein du groupe punk “Molto Brutto”. Damisch avait compris que l’apprentissage artistique relevait moins de l’acquisition de techniques que de la capacité à développer un langage personnel. Sa méthode consistait à accompagner chaque étudiant dans cette quête d’authenticité, sans jamais imposer sa propre esthétique.
Les témoignages de ses anciens étudiants révèlent un enseignant qui savait adapter son approche à chaque personnalité. Certains avaient besoin d’encouragements, d’autres de remises en question plus fermes. Damisch maîtrisait cet art délicat de la pédagogie différenciée, sachant quand “consoler” et quand donner “un coup de pied aux fesses”, selon l’expression d’un de ses étudiants.
Son engagement institutionnel témoigne également de cette conception élargie de l’art. Président de commission, membre du sénat, responsable d’institut : Damisch considérait ces fonctions administratives non comme des contraintes, mais comme des extensions naturelles de son travail artistique. Il s’agissait de créer les conditions institutionnelles permettant à l’art de s’épanouir.
Un héritage vivant
Presque dix ans après sa disparition, l’oeuvre de Gunter Damisch continue de rayonner bien au-delà des cercles spécialisés. Ses recherches sur les correspondances entre macro et microcosme trouvent un écho particulier dans nos préoccupations contemporaines liées à l’écologie et aux sciences du vivant. Ses “modèles épineux pour l’ensemble du monde” offrent des clés de compréhension pour penser notre rapport à la nature dans l’Anthropocène.
L’influence de son enseignement se mesure à la diversité des parcours de ses anciens étudiants, aujourd’hui actifs dans les domaines artistiques les plus variés. Cette dispersion créatrice témoigne de la justesse de sa méthode pédagogique : former des artistes capables de développer leur propre langage plutôt que des épigones.
Ses recherches plastiques sur la transformation et la métamorphose anticipent également les questionnements actuels sur l’intelligence artificielle et les biotechnologies. En explorant les territoires limites entre organique et inorganique, entre naturel et artificiel, Damisch a ouvert des voies que l’art contemporain commence seulement à explorer.
L’universalité de son langage plastique explique sa réception internationale croissante. Ses expositions en Chine, en Islande, en République tchèque témoignent de cette capacité à parler un langage visuel qui dépasse les frontières culturelles. Ses “créatures gazeuses” et ses “connecteurs entre les mondes” offrent des métaphores visuelles pour penser la mondialisation et les échanges interculturels.
Damisch nous a légué une oeuvre qui fonctionne comme un “filet jeté dans l’océan de la conscience”. À l’heure où l’art contemporain semble parfois se perdre dans la pure conceptualisation ou le spectaculaire, son exemple rappelle que la peinture peut encore offrir des expériences sensorielles irremplaçables. Ses toiles continuent d’inviter à cette “perception dansante de soi-même comme percevant” qu’il appelait de ses voeux.
L’art véritable survit à son créateur en continuant de produire du sens. L’oeuvre de Gunter Damisch répond parfaitement à ce critère. Elle nous offre des outils visuels et conceptuels pour appréhender la complexité du monde contemporain, cette tension permanente entre local et global, entre individuel et collectif, entre humain et non-humain qui caractérise notre époque.
- Tadao Ando, “L’Architecture du vide”, Éditions du Moniteur, 2000.
- Otto Breicha, cité dans “Gunter Damisch. Weltwegschlingen”, Hohenems/Vienne, 2009.