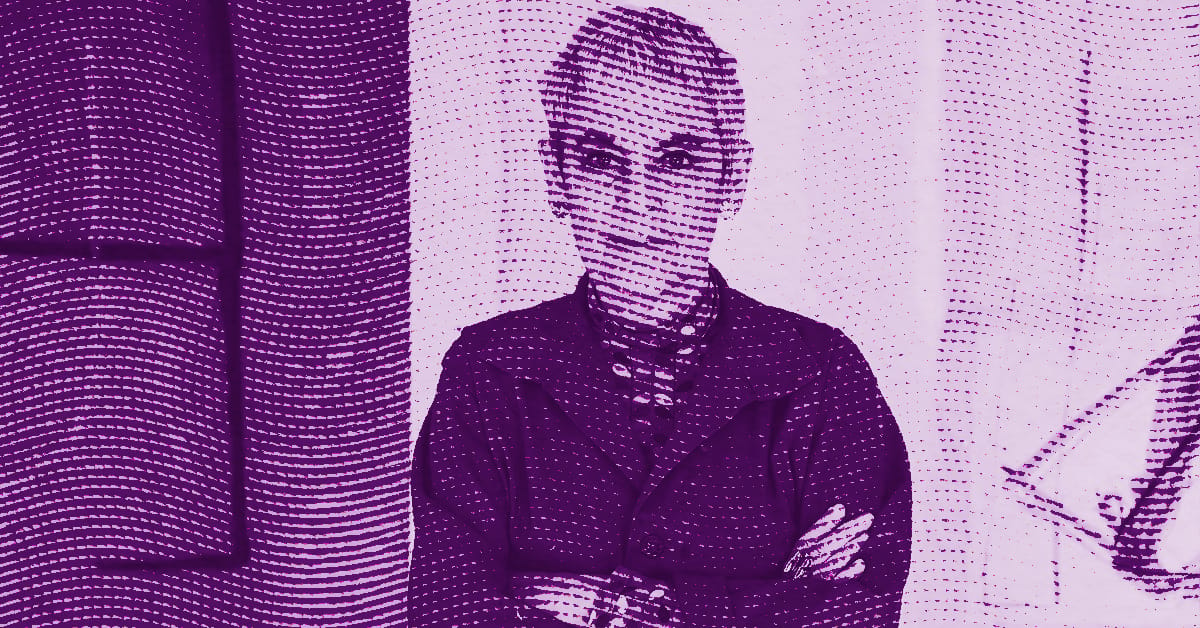Écoutez-moi bien, bande de snobs : Mira Schor peint comme on écrit un manifeste, écrit comme on peint un combat, et dans cette double pratique réside toute la puissance de son oeuvre. Artiste new-yorkaise née en 1950, formée au California Institute of the Arts où elle participa au légendaire Womanhouse en 1972, Schor incarne cette génération de créatrices qui refusèrent de choisir entre la pensée et la matière, entre le féminisme et le formalisme. Son parcours s’inscrit dans une lignée d’artistes-théoriciennes qui ont compris que l’art ne saurait être muet, et que les mots ne suffisent pas sans la chair de la peinture.
L’oeuvre de Schor se déploie dans un territoire où le langage devient image et où l’image porte en elle la charge du langage. Ses toiles des années 1970, ces Story Paintings créées en Californie, représentent des femmes nues évoluant dans des paysages luxuriants, souvent accompagnées d’animaux sauvages, notamment des ours. Ces compositions ne sont pas de simples illustrations d’un rapport harmonieux avec la nature : elles interrogent la place de la féminité hors des cadres domestiques qui lui furent historiquement assignés. La femme y apparaît non pas comme une créature à dompter, mais comme une force qui dialogue d’égale à égale avec le sauvage. Cette vision trouve un écho puissant dans la littérature, particulièrement chez les auteures qui ont exploré les territoires interdits de l’expérience féminine.
Charlotte Perkins Gilman, dans sa nouvelle The Yellow Wallpaper publiée en 1892, décrit une narratrice qui se met à ramper à quatre pattes, adoptant des comportements animaux pour échapper à l’enfermement domestique qui la rend folle [1]. Ce texte fondateur de la littérature féministe américaine révèle comment le patriarcat associe la femme à l’animal pour mieux la dévaloriser, pour mieux l’enfermer dans le rôle de créature irrationnelle nécessitant contrôle et surveillance. Mais là où Gilman expose la pathologie d’un système oppressif, Schor propose une réappropriation. Dans ses peintures californiennes, l’animalité n’est plus stigmate mais libération. La femme qui étreint l’ours, qui évolue dans la nature sauvage, refuse le domestique pour embrasser ce que Jack Halberstam nommerait les façons d’être “wild”, ces manières de vivre en marge des normes établies.
Cette convergence entre l’oeuvre picturale de Schor et la critique littéraire féministe n’est pas fortuite. Dans son essai “Figure/Ground” publié en 2001, Schor analyse comment le modernisme utopique craignait la “viscosité” de la peinture et de la féminité, cette qualité humide et organique qui résiste à la rigueur conceptuelle masculine. Son recueil Wet: On Painting, Feminism, and Art Culture, paru en 1997, défend précisément cette matérialité que l’art contemporain dominé par les hommes cherchait à évacuer. Schor écrit depuis sa double position de peintre et de critique, position inconfortable qui fait d’elle une voix dissidente dans un milieu où théorie et pratique sont souvent artificiellement séparées.
La littérature traverse l’oeuvre de Schor bien au-delà de ces références thématiques. Ses peintures intègrent fréquemment du texte, des fragments de langage qui ne sont ni légendes ni illustrations mais parties intégrantes de la composition. Robert Berlind, peintre et critique, écrivit en 2009 que Schor était “une intimiste dont la franchise rappelle celle d’Emily Dickinson” [2]. Cette comparaison avec la poétesse américaine n’est pas anodine. Comme Dickinson refusait les formes poétiques conventionnelles de son époque, Schor refuse les dichotomies faciles entre abstraction et figuration, entre engagement politique et plaisir visuel. Ses toiles des années 1990 et 2000 sont peuplées de mots, de phrases, de fragments linguistiques qui flottent dans l’espace pictural comme des pensées incarnées. Le langage chez Schor n’est jamais transparent : il est matière, couleur et forme.
Cette pratique trouve une résonnance particulière dans le contexte de l’art conceptuel qui dominait la scène new-yorkaise des années 1970 et 1980. Là où les conceptualistes cherchaient à dématérialiser l’art, à le réduire à l’idée pure, Schor maintenait obstinément la présence de la peinture, sa sensualité, sa corporéité. En 2012, la critique Roberta Smith écrivit dans le New York Times que les peintures de Schor “donnent une forme visuelle rare et sardonique à la vie, et au travail, de l’esprit” [3]. Cette formulation saisit parfaitement la tension productive qui anime l’oeuvre : entre esprit et corps, entre concept et sensation, Schor refuse de trancher.
L’engagement féministe de Schor ne se limite pas aux thématiques abordées dans ses peintures. En 1986, avec Susan Bee, elle fonde M/E/A/N/I/N/G, une revue d’art qui donna la parole aux artistes et critiques marginalisés par le discours dominant. Pendant dix ans, cette publication offrit un espace alternatif de discussion, loin des diktats de revues comme October qui annonçaient la mort de la peinture. L’archive de M/E/A/N/I/N/G fut acquise par la Beinecke Library de Yale en 2007, reconnaissance institutionnelle de son importance historique. Cette activité éditoriale s’inscrit dans une tradition d’artistes-écrivains qui refusèrent de laisser aux autres le soin de définir leur pratique.
Dans son oeuvre récente, notamment depuis la première élection de Donald Trump en 2016, Schor a intensifié la dimension politique de son travail. Ses interventions sur les pages du New York Times, où elle annote, corrige, commente les titres et articles, constituent une forme d’activisme artistique qui brouille les frontières entre art et commentaire social. Ces gestes rappellent que l’artiste ne peut rester dans sa tour d’ivoire quand le monde brûle. La figure féminine mythologique hurlante qui apparaît dans ses dessins politiques n’est pas sans évoquer les Furies de la mythologie grecque, ces divinités vengeresses qui punissaient les crimes contre l’ordre naturel.
L’histoire de l’art traverse également l’oeuvre de Schor de manière complexe. Fille d’Ilya et Resia Schor, artistes polonais juifs réfugiés aux États-Unis en 1941, Mira grandit entourée d’art et de culture européenne. Elle fut éduquée au Lycée Français de New York, institution qui lui donna une perspective internationale rare dans le milieu artistique américain. En 1969, la peintre Yvonne Jacquette lui prêta un livre de peinture et poésie Rajput, qui eut selon ses propres mots “une influence énorme” sur son travail. Cette référence à la tradition picturale indienne, où texte et image s’entrelacent depuis des siècles, éclaire la démarche formelle de Schor. Elle s’inscrit dans une généalogie qui dépasse largement le canon occidental moderniste.
Au California Institute of the Arts, Schor étudia avec Judy Chicago et Miriam Schapiro dans le Feminist Art Program, mais aussi avec le sculpteur Stephan Von Huene qui l’encouragea à développer une approche quasi psychanalytique du dialogue avec l’oeuvre. Cette formation hybride, entre militantisme féministe et réflexion formelle approfondie, façonna son identité artistique. Elle refuse depuis toujours de sacrifier l’un à l’autre, de choisir entre beauté et politique, entre plaisir visuel et engagement critique. C’est précisément cette double exigence qui fait de son oeuvre un territoire inconfortable pour les gardiens du temple, qu’ils soient formalistes purs ou activistes dogmatiques.
Les peintures de Schor sont généralement de petit format, intimistes, exigeant une attention rapprochée. Dans un monde saturé d’images monumentales et spectaculaires, ce choix de l’échelle modeste constitue en soi un acte de résistance. Ses toiles invitent à la lenteur, à la contemplation, à la lecture attentive des strates de sens qui s’y accumulent. La couleur y joue un rôle primordial : Schor utilise souvent des tons terreux, des ocres, des rouges profonds qui évoquent à la fois le corps et la terre. Cette palette chromatique refuse l’asepsie conceptuelle au profit d’une sensualité assumée.
L’exposition “California Paintings: 1971-1973” présentée à la galerie Lyles & King en 2019 révéla au public une facette méconnue de son travail. Ces gouaches sur papier, réalisées pendant ses années de formation, montrent une artiste déjà pleinement consciente de ses enjeux formels et politiques. Les femmes y apparaissent dans des poses qui oscillent entre vulnérabilité et puissance, souvent en interaction avec des éléments naturels, arbres, fleurs ou animaux, qui ne servent jamais de simple décor mais constituent des acteurs à part entière de la composition. La critique Ksenia M. Soboleva nota que ces oeuvres redéfinissaient la “sauvagerie” féminine, non plus comme pathologie mais comme mode d’être légitime.
La pratique d’écriture de Schor accompagne et nourrit sa pratique picturale sans jamais la supplanter. Ses essais, rassemblés dans Wet et plus tard dans A Decade of Negative Thinking publié en 2009, constituent une contribution majeure à la théorie féministe de l’art. Elle y défend une position parfois qualifiée d’essentialiste par ses détracteurs, refusant d’abandonner la référence au corps féminin et à l’expérience vécue des femmes au profit d’un constructivisme pur. Cette controverse révèle les tensions qui traversent le féminisme académique, entre celles qui voient dans toute référence au corps une capitulation devant le patriarcat, et celles qui, comme Schor, considèrent que nier le corps c’est accepter la vision masculine qui le réduit à de la pure matière.
Dans son essai “Patrilineage”, republié dans The Feminism and Visual Culture Reader édité par Amelia Jones, Schor examine comment les artistes femmes sont systématiquement effacées des généalogies artistiques, comment leurs influences et leurs innovations sont attribuées à des hommes, comment l’histoire de l’art se construit comme une succession de pères et de fils. Son propre travail s’efforce de rendre visibles ces lignées féminines occultées, citant dans ses communiqués de presse les influences de femmes artistes plutôt que les sempiternelles références masculines. Ce geste, apparemment simple, constitue une intervention politique dans les mécanismes de légitimation artistique.
La réception critique de l’oeuvre de Schor illustre les difficultés que rencontrent les artistes qui refusent les catégorisations faciles. Trop politique pour les formalistes, trop attachée à la peinture pour les conceptualistes, trop intellectuelle pour certains, trop sensible pour d’autres, Schor occupe un espace interstitiel qui dérange. Cette position marginale, loin d’être un handicap, constitue peut-être sa plus grande force. Elle permet un regard décalé, une liberté vis-à-vis des modes et des dogmes. Ses expositions récentes à Paris, à la Bourse de Commerce en 2023, et dans diverses institutions européennes, témoignent d’une reconnaissance internationale qui dépasse les clivages du milieu artistique new-yorkais.
L’héritage de Schor ne se mesure pas seulement à son oeuvre picturale et critique. En tant qu’enseignante à la Parsons School of Design, elle a formé des générations d’artistes, leur transmettant cette double exigence de rigueur formelle et d’engagement politique. Son influence passe aussi par M/E/A/N/I/N/G, qui offrit un modèle de publication alternative, démontrant qu’il était possible de créer des espaces de discussion en dehors des circuits institutionnels dominants. Ces contributions pédagogiques et éditoriales, souvent invisibilisées dans l’histoire de l’art qui privilégie les objets aux processus, constituent pourtant une part essentielle de son legs.
Mira Schor incarne une forme de résistance culturelle rare et précieuse. Dans un monde de l’art de plus en plus soumis aux logiques du marché, où le spectaculaire et l’immédiatement lisible dominent, elle maintient vivante une pratique exigeante, réflexive, attentive aux nuances. Sa double pratique d’artiste et de théoricienne ne relève pas d’une incapacité à choisir, mais d’une compréhension profonde que penser et faire sont indissociables, que l’art ne se justifie pas par le discours mais que le discours éclaire l’art sans jamais le remplacer. Son oeuvre nous rappelle que la peinture peut être un lieu de pensée aussi rigoureux que n’importe quel texte philosophique, et que les mots peuvent avoir la sensualité de la couleur. Dans cette époque d’hyperspécialisation où chacun doit rester dans sa case, Schor nous montre qu’il existe d’autres chemins, plus sinueux peut-être, mais infiniment plus riches. Elle nous enseigne que refuser de choisir entre féminisme et formalisme, entre engagement et beauté, entre corps et esprit, n’est pas de l’indécision mais une position éthique et esthétique pleinement assumée. Son oeuvre constitue un antidote contre tous les fondamentalismes, qu’ils soient esthétiques ou politiques, et nous invite à habiter les zones grises, ces territoires fertiles où les contradictions ne s’annulent pas mais se nourrissent mutuellement. En cela, Mira Schor appartient à cette lignée d’artistes rares qui ne cherchent pas à plaire mais à ouvrir des possibles, qui n’offrent pas de réponses définitives mais posent les bonnes questions, celles qui dérangent et libèrent à la fois.
- Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper, The New England Magazine, 1892
- Robert Berlind, cité dans la biographie de Mira Schor, 2009
- Roberta Smith, “Voice and Speech”, The New York Times, 2012