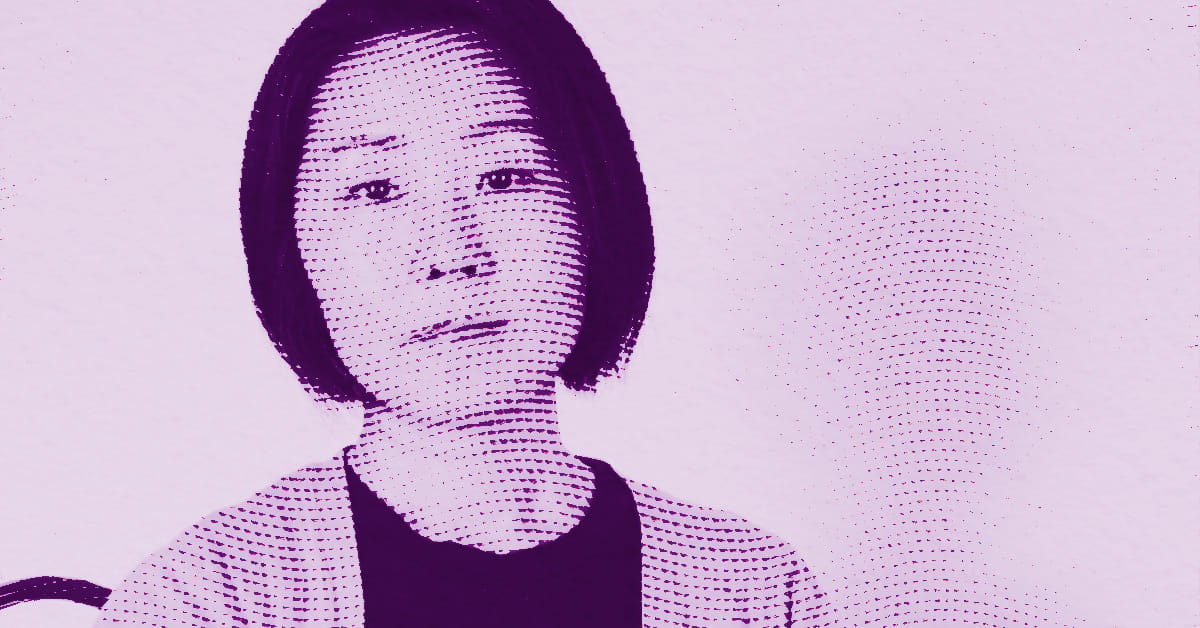Écoutez-moi bien, bande de snobs, je dois attirer votre attention sur l’oeuvre remarquable de Naoko Sekine, artiste japonaise dont le travail bouscule les conventions établies de l’art contemporain avec une subtilité et une profondeur intellectuelle incontestables, et qui a remporté, avec deux autres lauréats, le prestigieux Luxembourg Art Prize en 2023, distinction artistique internationale.
Sekine est une virtuose du paradoxe, jonglant entre l’immanence et la transcendance avec une désinvolture qui ferait pâlir d’envie vos artistes conceptuels préférés. Ses oeuvres, ces structures miroitantes où les lignes physiques et imaginaires s’entrecroisent, ne sont pas de simples objets à contempler mais des dispositifs qui nous forcent à repenser notre rapport à l’espace et au temps.
Prenez “Mirror Drawing-Straight Lines and Nostalgia” (2022), cette composition monumentale de presque trois mètres sur trois mètres. L’oeuvre évoque les paysages urbains de New York vus à travers le prisme de Mondrian, mais Sekine pousse l’expérience bien plus loin. Les neuf panneaux indépendants de taille différente qui constituent l’ensemble créent des lignes physiques qui deviennent partie intégrante de la composition. En polissant la surface graphite comme on polirait une pierre précieuse, elle transforme la matière opaque en surface réfléchissante, invitant le spectateur et l’espace environnant à se fondre dans l’oeuvre.
Cette approche me rappelle étrangement les réflexions de Maurice Blanchot sur l’espace littéraire, où l’écrivain disparaît derrière son oeuvre pour laisser place à l’expérience pure du langage. Dans L’Espace littéraire (1955), Blanchot écrivait : “L’oeuvre attire celui qui s’y consacre vers le point où elle est à l’épreuve de l’impossibilité” [1]. Ce point d’impossibilité, Sekine le matérialise dans ses surfaces miroitantes, créant un seuil où l’image et le réel se confondent, où le spectateur se trouve simultanément dedans et dehors, comme suspendu dans un entre-deux vertigineux.
Quand Blanchot parlait de “la solitude essentielle de l’oeuvre”, il pointait vers cette capacité de l’art à créer un espace autonome qui, paradoxalement, ne prend vie que dans la rencontre avec le spectateur. Les oeuvres de Sekine incarnent parfaitement cette tension : leurs surfaces réfléchissantes absorbent et transforment l’environnement, rendant chaque expérience unique et contingente. C’est un art qui refuse la fixité et revendique le mouvement perpétuel de la perception.
Dans “Stacks Ⅱ” (2023), Sekine joue avec notre perception de l’espace en juxtaposant deux types de lignes : celles physiquement créées par l’assemblage des panneaux et celles dessinées à la main. Ce dialogue entre le matériel et le représenté n’est pas sans rappeler les réflexions de Blanchot sur la distinction entre le langage ordinaire, qui fait disparaître les mots au profit de leur signification, et le langage littéraire, qui fait apparaître les mots dans leur matérialité même.
Ce qui me plaît chez Sekine, c’est sa manière d’incorporer la sérendipité dans son processus créatif. Quand elle mentionne les “accidents” qui surviennent pendant la création et qu’elle intègre comme éléments de l’oeuvre, on sent une artiste qui dialogue avec la matière plutôt que de lui imposer une vision préconçue. Cette démarche évoque irrésistiblement les principes du wabi-sabi japonais, cette esthétique qui valorise l’imperfection et l’impermanence.
L’inspiration que Sekine puise dans les grottes préhistoriques françaises qu’elle a visitées en 2013 est particulièrement révélatrice. Ces artistes anonymes d’il y a 30.000 ans utilisaient déjà les reliefs naturels des parois pour compléter leurs représentations animales, créant une fusion entre la nature et l’intervention humaine. Sekine poursuit cette tradition millénaire en intégrant la physicalité de ses supports dans la composition finale. L’art n’est plus une simple représentation plaquée sur un support neutre, mais une collaboration avec la matérialité même du monde.
Passons maintenant à la série “Colors”, dans laquelle Sekine extrait des palettes chromatiques d’oeuvres comme “Les Licornes” de Gustave Moreau ou “Model by The Wicker Chair” (“Modèle de la chaise en osier”) d’Edvard Munch pour créer des compositions pointillistes d’une complexité saisissante. Ce qui m’intéresse ici, c’est moins la référence à ces peintres que la structure musicale qui sous-tend ces oeuvres.
Car voilà le deuxième concept qui illumine l’oeuvre de Sekine : la musicalité minimaliste contemporaine. Dans ses écrits, l’artiste japonaise fait explicitement référence à la composition “Music for 18 Musicians” du compositeur américain Steve Reich comme source d’inspiration fondamentale pour sa démarche artistique. Cette oeuvre phare du minimalisme musical, créée en 1976, présente une structure particulière où dix-huit instrumentistes et vocalistes génèrent collectivement une trame sonore sophistiquée sans direction d’un chef d’orchestre. Cette approche compositionnelle fait écho à la pratique artistique de Sekine par sa conception non hiérarchique de l’ensemble : chaque élément musical (ou visuel dans le cas de Sekine) préserve son autonomie tout en contribuant à une cohérence globale de l’oeuvre.
Le compositeur John Cage, parlant de la musique de Reich, notait : “Ce n’est pas un début-milieu-fin, mais plutôt un processus, un processus qui se dévoile” [2]. Cette description pourrait tout aussi bien s’appliquer aux oeuvres de Sekine, particulièrement sa série “Colors” où chaque point de couleur, placé avec précision dans un système de coordonnées, crée une expérience visuelle qui transcende la somme de ses parties.
Reich lui-même expliquait : “La musique comme processus graduel me permet de me concentrer sur le son lui-même” [3]. De manière similaire, Sekine nous invite à nous concentrer sur l’expérience visuelle pure, plutôt que sur la représentation ou le message. Ses points de couleur créent des vibrations optiques qui rappellent les battements rythmiques de Reich, cette pulsation qui émerge de la répétition de motifs similaires mais légèrement décalés.
Dans “Colors-The Unicorns (383)” (2023), les points de couleur forment ce que Sekine appelle une “structure circulaire”, où aucun élément ne domine les autres. Comme dans la musique de Reich, où les instruments entrent et sortent de la composition sans hiérarchie fixe, les couleurs de Sekine créent un réseau d’interactions où le spectateur perçoit des mouvements, des vibrations et des mélanges optiques qui n’existent pas matériellement sur la surface. L’oeuvre se complète dans l’oeil et l’esprit du spectateur, tout comme la musique de Reich prend vie dans l’oreille de l’auditeur.
Cette idée de la structure circulaire opposée à la structure pyramidale traditionnelle de l’art représentatif est particulièrement intéressante. Sekine rejette l’idée d’un motif central auquel tous les autres éléments seraient subordonnés, préférant une constellation d’éléments qui interagissent sur un pied d’égalité. C’est une approche qui fait écho à la musique minimaliste processuelle, où les motifs se superposent et se transforment graduellement, créant une expérience immersive qui évoque les cycles naturels.
Les grands compositeurs minimalistes ont souvent déclaré qu’ils ne veulent pas imiter, mais simplement comprendre les processus [4]. Cela pourrait être la devise de Sekine, qui ne cherche pas à reproduire fidèlement des images, mais à comprendre et à révéler les processus perceptifs qui donnent naissance à notre expérience du monde. Ses “Mirror Drawings” reflètent littéralement l’environnement dans lequel ils sont exposés, transformant chaque exposition en une expérience unique et contextuelle.
Et que dire de son intérêt pour le Bunraku, ce théâtre de marionnettes japonais traditionnel ? Là encore, on retrouve cette fascination pour les systèmes où différents éléments (manipulateurs, récitants, musiciens) conservent leur indépendance tout en créant une expérience unifiée. La séparation entre le récitant et la marionnette, entre la voix et le mouvement, crée un espace intermédiaire où l’imaginaire du spectateur peut s’engouffrer, exactement comme dans les oeuvres de Sekine, où les lignes physiques et dessinées créent un interstice conceptuel.
“Edge Structure” (2020) illustre parfaitement cette approche. Dans cette oeuvre, Sekine découpe un dessin abstrait suivant ses contours, puis extrait un carré de l’intérieur et réorganise les éléments pour créer une nouvelle composition. Ce processus de déconstruction et de reconstruction évoque la façon dont la musique processuelle décompose et recompose ses motifs. L’artiste visuelle et le compositeur explorent tous deux comment la transformation de structures existantes peut révéler de nouvelles possibilités perceptives.
La musique minimaliste américaine est célèbre pour la “gradualité audible” de ses processus musicaux [5]. Cette transparence du processus se retrouve chez Sekine, qui ne cache pas les mécanismes de création de ses oeuvres mais au contraire les met en avant. Les joints entre les panneaux, les traces de polissage, les couches successives de matériaux, tout est visible, créant une honnêteté matérielle qui engage directement le spectateur.
Ce qui me plaît dans ces approches artistiques parallèles, c’est leur capacité à créer des oeuvres qui sont à la fois intellectuellement stimulantes et sensuellement captivantes. La musique minimaliste, malgré sa rigueur conceptuelle, reste profondément émouvante et physiquement ressentie. De même, les oeuvres de Sekine, malgré leur sophistication théorique, offrent une expérience visuelle immédiate et viscérale, ces surfaces miroitantes qui captent la lumière et transforment l’espace créent une sensation presque tactile.
“Square Square” (2023), avec ses rectangles décalés et ses différents types de lignes, crée ce que j’appellerais une “polyphonie visuelle” où différentes couches de perception se superposent sans jamais se fondre complètement. Cette stratification rappelle la technique du “déphasage” caractéristique de la musique minimaliste, où deux motifs identiques joués à des vitesses légèrement différentes créent progressivement des configurations rythmiques complexes.
Je vous entends déjà murmurer : “Encore un de ces artistes intellectuels qui fait de l’art pour les théoriciens”. Détrompez-vous. Ce qui sauve Sekine de l’aridité conceptuelle, c’est son attachement inébranlable à la sensualité de la matière. Ces surfaces polies comme des miroirs, ces lignes qui changent d’apparence selon l’angle et la lumière, ces points de couleur qui vibrent dans notre rétine, tout cela crée une expérience esthétique immédiate qui transcende l’intellectualisation.
C’est là que réside la véritable originalité de Naoko Sekine : dans sa capacité à réconcilier des approches apparemment contradictoires. Le conceptuel et le sensuel, le plan et le volume, le fixe et le mobile, le contrôlé et l’aléatoire coexistent dans ses oeuvres sans s’annuler mutuellement. Comme dans la musique minimaliste contemporaine, où la rigueur mathématique engendre paradoxalement une expérience méditative presque mystique, les oeuvres de Sekine utilisent la précision géométrique pour nous ouvrir à une perception plus fluide et intuitive du monde.
Si l’art a encore un rôle à jouer dans notre monde saturé d’images, c’est précisément celui-là : nous rappeler que notre perception n’est pas un simple enregistrement passif du réel, mais une construction active où matérialité et conscience s’entremêlent inextricablement. Les oeuvres de Sekine, en rendant visibles ces mécanismes perceptifs, nous invitent à un nouveau dialogue avec le monde visible, un dialogue où nous ne sommes plus simplement spectateurs, mais participants actifs dans la création du sens.
Alors la prochaine fois que vous verrez une oeuvre de Naoko Sekine, arrêtez-vous un instant. Regardez comment la lumière joue sur ces surfaces polies, comment votre propre reflet se mêle aux lignes tracées par l’artiste, comment les points de couleur se transforment selon votre distance et votre angle de vue. Et peut-être entendrez-vous, dans ce dialogue silencieux entre l’oeuvre et votre perception, les échos lointains de ces structures musicales qui ont tant inspiré l’artiste, ces pulsations rythmiques minimalistes qui, comme nos battements de coeur, marquent le temps de notre existence.
- Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Gallimard, 1955.
- John Cage, Silence: Lectures and Writings, Wesleyan University Press, 1961.
- Steve Reich, Writings on Music, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.
- Steve Reich, entretien avec Jonathan Cott, The Rolling Stone Interview, 1987.
- Steve Reich, Music as a Gradual Process in Writings on Music, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.