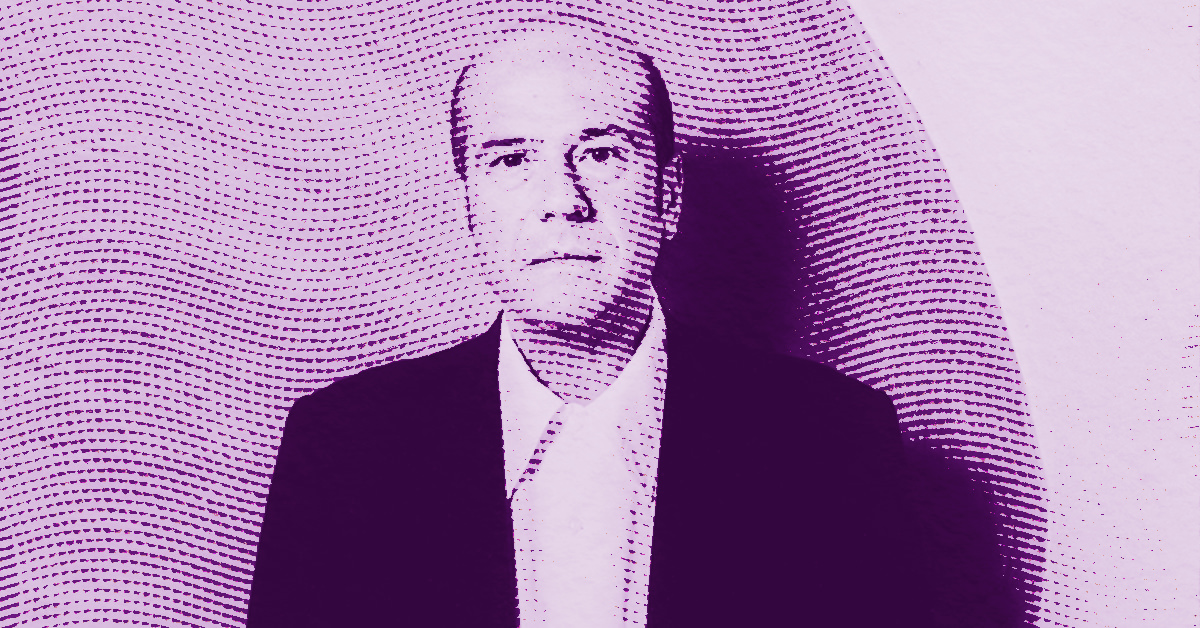Écoutez-moi bien, bande de snobs. Il existe encore dans ce monde aseptisé de l’art contemporain des territoires préservés où l’émotion pure résiste aux calculs marchands et aux poses conceptuelles. Nicola De Maria en est un gardien opiniâtre. Depuis plus de quarante ans, cet homme né en 1954 à Foglianise déploie sur les murs du monde entier un univers chromatique où la poésie rejoint l’architecture, où la peinture déborde de son cadre pour envahir l’espace et réinventer notre rapport au lieu.
Dans ce marché de l’art où les tendances se succèdent avec la rapidité d’un algorithme, De Maria maintient une constance déconcertante. Sa série Regno dei Fiori [1], commencée dans les années 1980, continue de fleurir aujourd’hui avec une obstination qui confine au sacré. Ces “royaumes de fleurs” ne sont pas de simples jardins peints, mais des territoires psychiques où l’artiste déploie une mythologie personnelle faite de couleurs primaires, d’étoiles stylisées et de maisons symboliques.
Le parcours de De Maria commence par une résistance. Formé en médecine avec une spécialisation en psychiatrie qu’il n’exercera jamais, il choisit la peinture en 1977 dans le Turin conceptuel des années soixante-dix, quand tous proclamaient la mort de la peinture. Premier acte de rébellion : créer sa première peinture murale à Milan la même année, puis participer à la Biennale de Paris. Geste prophétique d’un homme qui refuse les frontières entre les disciplines et les supports.
Sa reconnaissance vient en 1979 avec son intégration au mouvement de la Transavanguardia théorisé par Achille Bonito Oliva. Aux côtés de Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi et Mimmo Paladino, De Maria incarne pourtant une voie singulière : là où ses compagnons explorent la figuration ironique ou néo-expressionniste, lui développe une abstraction lyrique qui puise dans l’inconscient collectif. Cette différence n’est pas anecdotique. Elle révèle un artiste qui, dès l’origine, refuse les étiquettes pour creuser son propre sillon.
L’inconscient collectif
L’oeuvre de Nicola De Maria révèle une compréhension intuitive des mécanismes de l’inconscient collectif théorisés par Carl Gustav Jung [2]. Cette dimension psychanalytique de son travail dépasse le simple usage décoratif de symboles universels pour atteindre une véritable activation des archétypes de Jung. Celui-ci décrivait l’inconscient collectif comme “un socle partagé par l’humanité, contenant les archétypes : des modèles universels” qui se manifestent dans les récits mythologiques et les créations artistiques. Chez De Maria, cette théorie trouve une application picturale d’une rare cohérence.
Ses étoiles ne sont pas de simples motifs ornementaux mais des manifestations de l’archétype du cosmos intérieur, cette quête d’orientation dans l’immensité psychique que Jung identifiait comme fondamentale chez l’être humain. Les maisons qui parsèment ses toiles évoquent l’archétype du refuge, du temenos sacré où l’individuation peut s’accomplir. Quant aux fleurs omniprésentes, elles incarnent l’archétype de la renaissance perpétuelle, du cycle éternel qui régit autant la nature que la psyché.
Cette lecture de Jung s’enrichit quand on observe la technique murale de l’artiste. Ses “Space Paintings” qui envahissent les murs des galeries reproduisent le processus d’individuation décrit par Jung : le spectateur, immergé dans ces environnements colorés, vit une expérience de transformation où les frontières entre le moi et l’espace se dissolvent temporairement. Cette dissolution n’est pas pathologique mais thérapeutique, permettant à l’inconscient personnel de dialoguer avec l’inconscient collectif.
L’usage que fait De Maria des couleurs primaires s’inscrit également dans cette logique archétypale. Le rouge évoque l’énergie vitale, la libido au sens de Jung. Le bleu convoque l’infini spirituel, la transcendance. Le jaune irradie la conscience solaire, la clarté de l’éveil. Ces couleurs, appliquées en couches épaisses selon la technique de l’ancienne fresque, ne cherchent pas la sophistication chromatique mais l’impact primordial sur la psyché.
Jung observait que “les archétypes apparaissent parfois sous leurs formes les plus primitives et les plus naïves (dans les rêves), parfois aussi sous une forme beaucoup plus complexe due à une élaboration consciente (dans les mythes)”. L’art de De Maria navigue constamment entre ces deux pôles. Ses dessins sur papier conservent la spontanéité du rêve, tandis que ses installations murales atteignent la complexité du mythe élaboré.
Cette dimension psychanalytique explique pourquoi les oeuvres de De Maria produisent un effet si particulier sur le spectateur. Elles ne s’adressent pas seulement à l’oeil mais à cette “mémoire de l’espèce” que Jung situait dans l’inconscient collectif. Face à un Regno dei Fiori, nous ne contemplons pas une simple abstraction décorative mais un mandala contemporain qui active nos structures psychiques les plus profondes. De Maria lui-même l’exprime avec justesse quand il se décrit comme “celui qui écrit des poèmes avec ses mains trempées de couleurs” [3]. Cette formule révèle la conscience qu’a l’artiste de puiser dans un langage universel qui dépasse la simple technique picturale.
L’installation Angeli proteggono il mio lavoro (1986), créée pour sa première exposition américaine, illustre parfaitement cette approche. En peignant directement sur les murs et le plafond de l’espace d’exposition, De Maria transforme l’architecture en un ventre maternel coloré où le spectateur fait l’expérience d’une régression positive vers les archétypes de protection et de renaissance. Cette oeuvre ne se contente pas de décorer l’espace : elle le re-sacralise en activant notre mémoire collective du lieu protégé.
L’architecture comme territoire spirituel
La seconde dimension fondamentale de l’oeuvre de De Maria réside dans son rapport révolutionnaire à l’architecture et à la spatialité. Cette approche trouve ses racines dans la tradition italienne de l’art mural, mais la réinvente selon une logique contemporaine qui fait écho aux recherches architecturales de la Renaissance italienne. Comme Brunelleschi révolutionnait au XVe siècle l’art de construire en soumettant l’architecture “à une règle déterminant les rapports de proportions entre les différentes parties de l’édifice”, De Maria développe un système pictural qui repense entièrement la relation entre l’oeuvre et son environnement spatial.
L’innovation de De Maria consiste à traiter l’architecture non comme un simple support mais comme un partenaire de création. Ses peintures murales ne se contentent pas d’occuper la surface des murs : elles en transforment la nature même. Quand il peint les murs et plafonds d’une galerie, il ne décore pas l’espace mais le re-fonde symboliquement. Cette approche rappelle la révolution de Brunelleschi qui, selon les historiens de l’art, “cultive particulièrement la rigueur et la sobriété des plans” pour “créer un effet d’optique très harmonieux”.
La technique de la fresque que revendique De Maria établit un lien direct avec les maîtres de la Renaissance italienne, mais selon une logique inversée. Là où les fresquistes de la Renaissance cherchaient à créer l’illusion de la profondeur sur une surface plane, De Maria utilise la couleur pure pour abolir la perception traditionnelle de l’espace architectural. Ses murs colorés ne fuient plus vers un point de fuite mais irradient vers le spectateur, créant un effet d’expansion spatiale qui transforme l’architecture en cosmos intérieur.
Cette révolution spatiale trouve son expression la plus aboutie dans ses installations publiques, notamment Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime (2004), créée pour les Luci d’Artista de Turin. En transformant les lampadaires de la place San Carlo en fleurs lumineuses, De Maria accomplit un geste architectural d’une rare audace : il réinvente l’éclairage urbain comme un système poétique qui métamorphose la perception de l’espace public. Cette intervention ne se contente pas d’embellir la place : elle en révèle la dimension spirituelle cachée.
L’approche spatiale de De Maria rejoint les recherches des architectes contemporains italiens qui, selon les analystes, “marient tradition et innovation” en développant “une utilisation audacieuse de matériaux contemporains”. Mais là où l’architecture contemporaine utilise le verre et l’acier, De Maria emploie la couleur pure comme matériau architectural. Ses pigments naturels appliqués selon la technique traditionnelle de la fresque créent des surfaces qui transforment littéralement les propriétés lumineuses et acoustiques de l’espace.
Cette dimension architecturale explique pourquoi De Maria préfère souvent exposer dans des lieux historiques plutôt que dans des white cubes neutres. Il a besoin du dialogue avec une architecture préexistante pour révéler sa propre vision spatiale. Ses interventions dans des palais, des églises ou des espaces industriels reconvertis créent des tensions fécondes entre l’ancien et le contemporain, le sacré et le profane.
La couleur devient chez lui un véritable langage architectural. Chaque teinte possède sa fonction spatiale spécifique : les rouges dilatent l’espace et créent une sensation d’intimité chaleureuse, les bleus l’élèvent vers l’infini spirituel, les jaunes l’illuminent d’une lumière intérieure. Cette utilisation fonctionnelle de la couleur rappelle les recherches de l’architecture moderne sur l’effet psychologique des matériaux, mais l’applique selon une logique purement picturale.
L’installation devient chez De Maria un art total qui englobe peinture, architecture et poésie. Ses titres, souvent longs et poétiques, ne décrivent pas l’oeuvre mais en constituent une extension verbale. “La testa allegra di un angelo bello” ou “Universo senza bombe” fonctionnent comme des mantras qui orientent la perception spatiale du spectateur. Ces mots peints ou écrits sur les murs créent une dimension littéraire de l’espace qui rappelle les inscriptions sacrées des architectures religieuses.
Cette approche globale de l’espace révèle chez De Maria une conception de l’art comme transformation du monde vécu. Ses oeuvres ne se contentent pas d’être regardées : elles modifient physiquement et psychologiquement l’expérience que nous avons du lieu. En ce sens, De Maria accomplit le rêve de l’architecture moderne de créer des espaces qui transforment leurs habitants, mais par des moyens purement artistiques.
La résistance du sensible
Dans un marché de l’art obsédé par la nouveauté et la transgression, De Maria oppose la constance d’une recherche qui approfondit sans cesse les mêmes questions fondamentales. Ses “Teste Orfiche” présentées à la Biennale de Venise de 1990 [4], toiles monumentales de plus de cinq mètres de largeur, révèlent une maturité artistique qui assume pleinement ses obsessions. Ces oeuvres ne cherchent ni la provocation ni l’effet de mode mais creusent inlassablement la question de l’émotion pure en peinture.
La critique américaine a parfois reproché à De Maria son refus de l’ironie post-moderne et de la déconstruction critique. Cette incompréhension révèle plutôt la singularité de sa position : dans un monde artistique dominé par la méfiance envers l’émotion, il maintient une foi inébranlable dans le pouvoir transformateur de l’art. Ses oeuvres des années 2000 et 2010 confirment cette orientation avec des titres explicites comme “Universo senza bombe” ou “Salvezza possibile con l’arte”.
Cette position n’a rien de naïf. Elle procède d’une lucidité particulière sur les enjeux contemporains de l’art. De Maria comprend que la véritable subversion consiste aujourd’hui à réhabiliter des valeurs esthétiques que le cynisme ambiant a disqualifiées. Son usage de couleurs primaires et de formes simples ne relève pas d’un primitivisme régressif mais d’une stratégie sophistiquée de résistance culturelle.
L’évolution récente de son travail confirme cette orientation. Ses oeuvres sur papier multiplient les notations poétiques et les références à la musique, créant des partitions visuelles où chaque couleur correspond à une note, chaque forme à un rythme. Cette synesthésie assumée place De Maria dans la lignée des grands coloristes qui, de Kandinsky à Rothko, ont cherché à faire de la peinture un art total.
Ses installations récentes développent également une dimension écologique qui enrichit son propos sans le trahir. Regno dei fiori musicali. Universo senza bombe (2023) intègre des éléments sonores qui transforment l’espace d’exposition en environnement sensoriel complet. Cette évolution vers l’art total respecte la logique profonde d’un artiste qui a toujours refusé les frontières entre les disciplines.
La longévité de la carrière de De Maria, ses expositions dans les plus grandes institutions internationales, sa présence régulière dans les collections publiques témoignent d’une reconnaissance qui dépasse les phénomènes de mode. Son art traverse les générations parce qu’il s’adresse à des besoins anthropologiques constants : le besoin de beauté, de spiritualité, de connexion avec les forces vitales.
Cette permanence dans un monde de l’art volatil révèle la pertinence prophétique de De Maria. Il y a quarante ans, son choix de la peinture dans le Turin conceptuel paraissait anachronique. Aujourd’hui, alors que les nouvelles générations redécouvrent le besoin de spiritualité et de connexion à la nature, son oeuvre apparaît comme visionnaire. Ses “royaumes de fleurs” offrent des refuges psychiques dans un monde de plus en plus déshumanisé.
L’art comme prière laïque
L’oeuvre de Nicola De Maria accomplit ce tour de force de réhabiliter la dimension spirituelle de l’art sans verser dans le mysticisme de pacotille. Ses installations créent des espaces de recueillement laïc où la contemplation esthétique rejoint l’expérience méditative. Cette dimension spirituelle ne procède d’aucun dogme religieux mais d’une confiance fondamentale dans le pouvoir réparateur de la beauté.
Quand De Maria peint “Regno dei Fiori”, il ne représente pas des fleurs mais crée les conditions d’une floraison psychique chez le spectateur. Ses couleurs pures agissent comme des mantras visuels qui apaisent l’agitation mentale et reconnectent avec les rythmes naturels. Cette fonction thérapeutique de l’art rejoint les recherches contemporaines sur l’art-thérapie, mais l’accomplit par des moyens purement esthétiques.
La répétition obsessionnelle des mêmes motifs, étoiles, maisons et fleurs, crée un effet hypnotique qui facilite l’accès à des états de conscience modifiés. Cette répétition n’est pas monotonie mais ressassement créateur qui approfondit progressivement la compréhension. Chaque nouveau “Regno dei Fiori” révèle des aspects inédits de cet univers poétique qui semble inépuisable.
L’inscription de mots et de phrases poétiques dans ses toiles ajoute une dimension littéraire qui enrichit l’expérience esthétique. Ces textes ne décrivent pas l’image mais créent un contrepoint verbal qui guide la méditation. Quand De Maria écrit “La montagna mi ha nascosto la luna, cosa devo fare?” (La montagne m’a caché la lune, que dois-je faire ?), il ne pose pas une question anecdotique mais formule l’inquiétude existentielle fondamentale de l’homme face à l’immensité cosmique.
Cette dimension spirituelle explique l’attraction qu’exerce l’oeuvre de De Maria sur des publics très divers. Ses installations attirent autant les amateurs d’art contemporain que les chercheurs spirituels, les enfants que les personnes âgées. Cette transversalité révèle la justesse de son intuition : l’art véritable s’adresse à ce qu’il y a d’universel en chaque être humain.
L’art de De Maria propose une alternative concrète au nihilisme contemporain. Face à un monde désenchanté, il maintient vivante la possibilité d’une expérience du sacré par la beauté. Ses “univers sans bombes” ne sont pas des utopies naïves mais des laboratoires d’expérimentation de modes d’être apaisés. Dans ses installations, pendant quelques instants, la violence du monde se trouve suspendue et remplacée par une harmonie fragile mais réelle.
Cette oeuvre nous rappelle que l’art possède encore, malgré sa marchandisation, un pouvoir de transformation spirituelle qui résiste à toutes les récupérations. En maintenant vivante cette dimension sacrée de l’art, Nicola De Maria accomplit un acte de résistance culturelle d’une portée considérable. Il nous prouve qu’il est encore possible, au XXIe siècle, de créer des oeuvres qui élèvent l’âme sans renier l’intelligence.
L’éternel présent de la création
Une évidence s’impose : nous sommes face à un artiste majeur dont l’oeuvre gagnera encore en reconnaissance dans les décennies à venir. Sa capacité à maintenir vivante une tradition picturale millénaire tout en l’adaptant aux enjeux contemporains révèle une maîtrise artistique rare. Son refus des facilités conceptuelles et des provocations gratuites témoigne d’une exigence éthique qui honore l’art contemporain.
L’oeuvre de Nicola De Maria nous enseigne que la véritable avant-garde consiste parfois à préserver ce que la modernité menace de détruire. En maintenant vivant le lien entre art et spiritualité, entre peinture et architecture, entre individuel et collectif, il accomplit un travail de sauvegarde culturelle essentiel. Ses “royaumes de fleurs” constituent autant de refuges où se préservent des valeurs esthétiques et spirituelles que notre époque a trop rapidement abandonnées.
Cette oeuvre nous invite également à repenser nos critères d’évaluation de l’art contemporain. La nouveauté formelle, la transgression critique, la déconstruction ironique ne constituent pas les seuls critères de qualité artistique. L’approfondissement patient d’une recherche, la fidélité à une vision poétique, la capacité à émouvoir et à élever possèdent une légitimité égale et peut-être supérieure.
Nicola De Maria nous prouve qu’il reste possible, même dans le contexte désenchanté de la postmodernité, de créer un art qui réconcilie l’homme avec ses aspirations les plus hautes. Ses installations nous offrent des moments de grâce qui compensent la brutalité du quotidien et nourrissent cette “faim de beauté” que ressentent secrètement la plupart de nos contemporains.
Face à ses oeuvres, nous comprenons que l’art véritable ne se contente pas de représenter le monde : il le transforme en révélant ses potentialités cachées. Les “univers sans bombes” de De Maria ne sont pas des évasions mais des préfigurations d’un monde possible où la beauté l’emporterait sur la violence. En ce sens, cet art accomplit sa fonction prophétique la plus haute : il maintient l’espoir d’un avenir meilleur et nous donne les moyens spirituels de le construire.
L’oeuvre de Nicola De Maria nous rappelle que l’art demeure, malgré toutes les vicissitudes historiques, une voie privilégiée d’accès au sacré. Dans un monde qui a perdu ses repères spirituels traditionnels, ses installations offrent des espaces de recueillement où chacun peut retrouver le contact avec cette dimension transcendante qui constitue le propre de l’humanité. Cette fonction anthropologique de l’art, que les avant-gardes du XXe siècle avaient cru définitivement abolie, retrouve chez De Maria une actualité troublante qui nous interroge sur nos propres besoins spirituels.
Ainsi, bien au-delà des querelles esthétiques de son époque, Nicola De Maria aura accompli cette prouesse de réconcilier l’art contemporain avec sa vocation éternelle : révéler la beauté cachée du monde et offrir aux hommes des raisons d’espérer. Cette oeuvre, qui traverse déjà cinq décennies, nous accompagnera encore longtemps dans notre quête commune d’un art qui soit à la fois contemporain et intemporel, sophistiqué et accessible, local et universel.
- Galerie Lelong & Co., “Nicola De Maria – Regno dei Fiori”, catalogue d’exposition, Paris, 1988
- Carl Gustav Jung, L’Homme et ses symboles, Robert Laffont, Paris, 1964
- ABC-Arte, entretien avec Nicola De Maria, Turin, 2018
- Laura Cherubini, Flaminio Gualdoni, Lea Vergine (dir.), Biennale di Venezia – Padiglione Italia, catalogue officiel, Venise, 1990