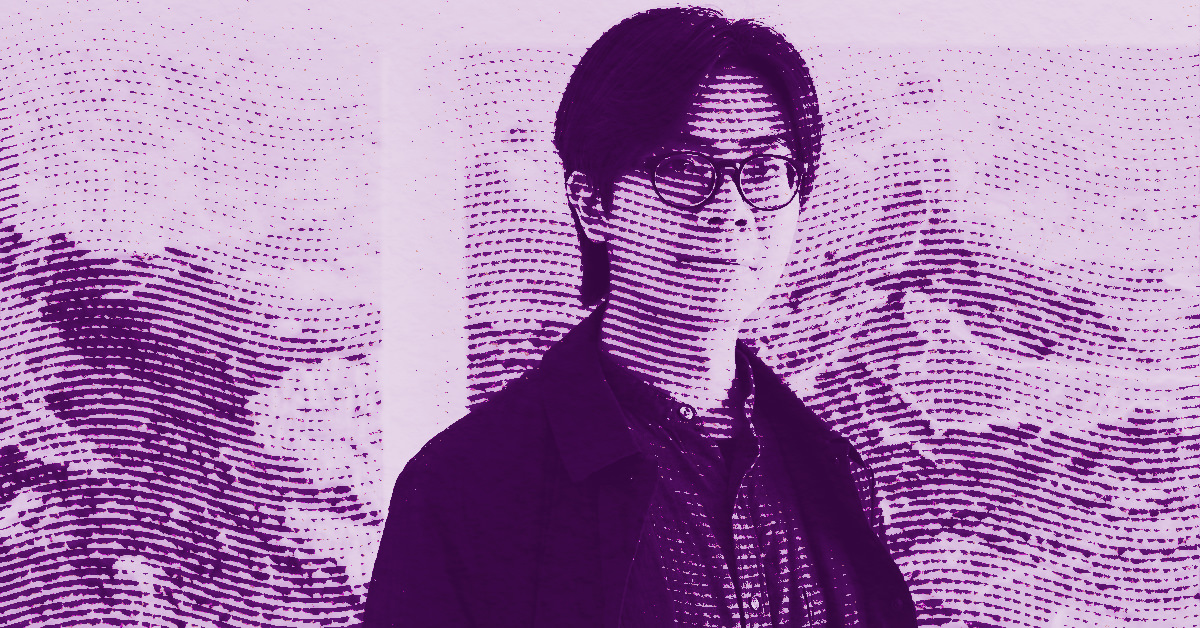Écoutez-moi bien, bande de snobs : si vous croyez encore que la peinture de paysage appartient au passé, que les pinceaux et l’acrylique ne peuvent plus rien nous dire sur notre condition contemporaine, alors vous n’avez manifestement jamais posé les yeux sur le travail de Stephen Wong Chun Hei. Cet artiste de Hong Kong accomplit quelque chose de remarquablement rare dans l’art d’aujourd’hui : il réussit à maintenir vivante une tradition séculaire tout en la projetant violemment dans notre siècle hyperconnecté, saturé d’écrans et de réalités virtuelles.
Wong Chun Hei ne peint pas simplement des montagnes et des vallées. Il construit des univers chromatiques où la nature et la ville de Hong Kong fusionnent dans une synergie électrique, où les teintes ne cherchent jamais à imiter le réel mais plutôt à capturer l’essence subjective d’une expérience vécue, mémorisée, puis recréée sur la toile. Ses paysages vibrent d’une intensité qui évoque simultanément les écrans de jeux vidéo de son enfance et les grands maîtres du paysage occidental. Cette dualité n’est pas une contradiction mais le coeur même de sa démarche artistique.
L’héritage du paysage et sa réinvention
Pour comprendre la singularité de Wong, il faut d’abord reconnaître sa filiation avec une lignée prestigieuse de peintres paysagistes. John Constable arpentait la campagne anglaise du Suffolk au début du XIXe siècle, armé de son carnet et de sa détermination à documenter quotidiennement son environnement immédiat. Cette obsession pour l’observation directe du territoire local a profondément marqué Wong, qui cite Constable comme une influence majeure. Mais là où Constable cherchait une fidélité atmosphérique aux ciels changeants de l’Angleterre, Wong prend une liberté radicale avec la couleur et la composition.
David Hockney, autre référence essentielle pour l’artiste de Hong Kong, a démontré dans ses paysages du Yorkshire que la subjectivité pouvait coexister avec l’observation minutieuse [1]. Wong a absorbé cette leçon et l’a poussée plus loin encore. Ses randonnées dans les collines de Hong Kong, carnet en main, rappellent la pratique du plein air, cette tradition qui exigeait du peintre qu’il affronte directement son sujet dans la nature. Sauf que Wong ne peint jamais sur place. Il esquisse, il absorbe, il mémorise, puis retourne à son atelier de Fo Tan pour reconstruire ces paysages de mémoire.
Cette méthode n’est pas anodine. Elle transforme chaque toile en un témoignage d’une temporalité différente : le moment de la randonnée, le temps de la mémorisation, l’instant de la création en atelier. Wong lui-même l’exprime avec une clarté désarmante : “Je ne cherche jamais à capturer un seul moment dans un paysage. Les couleurs changent constamment dans le temps. C’est la raison pour laquelle les couleurs dans mes peintures ne sont pas réalistes ou naturalistes dans leur apparence. Je veux qu’elles soient plus subjectives” [2].
La tradition du plein air se trouve ainsi réinventée pour l’ère numérique. Wong n’est pas un puriste nostalgique qui rejette la technologie. Au contraire, il l’embrasse pleinement. Ses premières oeuvres reproduisaient littéralement des paysages de jeux vidéo, reconnaissant sans complexe que ces mondes virtuels avaient autant de légitimité visuelle que n’importe quel sommet alpin. Cette honnêteté intellectuelle le distingue de nombreux artistes contemporains qui feignent d’ignorer l’impact de la culture populaire sur leur vision.
Le virtuel comme nouveau territoire
C’est précisément cette aisance avec les mondes virtuels qui rend le travail de Wong si pertinent aujourd’hui. Pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les voyages sont devenus impossibles, l’artiste n’a pas cessé de peindre. Il a simplement déplacé son territoire d’exploration vers Google Earth, créant sa série “A Grand Tour in Google Earth” où il a virtuellement visité et peint le Mont Fuji, le Mont-Saint-Michel et les Dolomites sans quitter son atelier de Hong Kong. Cette série révèle une vérité inconfortable : notre expérience du monde passe désormais autant par les écrans que par la présence physique.
Wong ne hiérarchise pas ces expériences. Pour lui, la randonnée dans les collines de Hong Kong et l’exploration via Google Earth sont deux formes également valides d’engagement avec le paysage. Cette position philosophique reflète notre condition contemporaine où le virtuel et le réel s’entremêlent constamment. Nos souvenirs de voyage se confondent avec les photographies que nous avons prises, les images que nous avons vues en ligne, les reconstitutions vidéoludiques que nous avons explorées.
La perspective en vue aérienne que Wong privilégie provient directement de son expérience des jeux vidéo comme Age of Empires ou Grand Theft Auto. Ce n’est pas le regard romantique du randonneur contemplant le sublime naturel, mais plutôt celui du joueur survolant son territoire, planifiant ses mouvements, construisant mentalement la géographie des lieux. Cette perspective lui permet aussi de se connecter aux peintures chinoises traditionnelles de paysage qui utilisaient également ce point de vue élevé, créant ainsi un pont inattendu entre tradition asiatique et culture vidéoludique contemporaine.
Les couleurs saturées, presque fluo, qui caractérisent ses toiles récentes viennent également de cet univers visuel des jeux et des anime japonais. Wong collectionne plus de deux cents figurines d’anime dans son atelier, et il revendique ouvertement cette influence. Là où ses professeurs d’école d’art lui demandaient de dessiner des sculptures classiques, il se demandait pourquoi il ne pouvait pas dessiner ses figurines d’anime. Cette question apparemment naïve cache une critique profonde de la hiérarchie culturelle qui continue de séparer l’art dit “élevé” de la culture populaire.
La géographie sentimentale de Hong Kong
Hong Kong elle-même devient chez Wong plus qu’un simple sujet. C’est un personnage à part entière, avec ses contradictions vertigineuses : soixante-quinze pour cent du territoire est constitué de campagne, incluant deux cent cinquante îles et vingt-quatre parcs naturels, pourtant l’imaginaire mondial de la ville reste dominé par ses gratte-ciels entassés. Wong capture cette dualité essentielle. Dans ses toiles, les tours d’habitation surgissent entre les collines verdoyantes, les tunnels percent les montagnes, les sentiers de randonnée serpentent à proximité immédiate du béton urbain.
Cette proximité entre nature et urbanité n’est pas traitée comme un conflit mais comme une conversation. Wong s’intéresse particulièrement à “l’intervention des humains dans la nature. Par exemple, les randonneurs marchant sur des sentiers au loin ou les tunnels apparaissant entre deux montagnes” [3]. Ces minuscules figures humaines qui parsèment ses paysages ne dominent jamais la composition mais créent une échelle, rappelant notre insignifiance face à la magnitude naturelle tout en soulignant notre présence inévitable.
Le projet MacLehose Trail de 2022 illustre parfaitement cette approche. Wong a peint l’intégralité des cent kilomètres de ce sentier emblématique de Hong Kong, le découpant en dix étapes correspondant aux divisions officielles du parcours. Plus de quarante toiles documentent cette traversée, créant une sorte de cartographie subjective du territoire. Mais contrairement à une carte, ces peintures ne prétendent pas à l’exactitude. Wong réarrange les éléments, change l’orientation des points de repère, invente des couleurs impossibles pour les nuages et les arbres. “Je m’intéresse à la façon dont j’interprète la nature, plutôt qu’à l’exactitude de la capture du paysage”, affirme-t-il [4].
Cette liberté compositionnelle transforme chaque toile en un acte de mémoire créative. Wong compare son processus à la construction avec des Lego : assembler un paysage à partir de compositions, de lignes et de couleurs. Cette métaphore ludique cache une sophistication technique remarquable. Ses coups de pinceau lâches et gestuels capturent le mouvement, la lumière du soir ornant un pic montagneux ou les vagues s’écrasant sur le rivage, tout en maintenant une cohérence structurelle impressionnante.
L’urgence documentaire
Il y a également chez Wong une urgence documentaire qui confère à son travail une dimension quasi-archiviste. Hong Kong change à une vitesse vertigineuse. Les paysages qu’il peint aujourd’hui pourraient être méconnaissables demain. L’artiste exprime cette anxiété avec une franchise désarmante : “J’ai vraiment le sentiment que tout change. Je ne peux pas être sûr que tout sera encore là demain.” Cette conscience de l’impermanence ajoute une couche mélancolique à ses compositions apparemment joyeuses.
La série “The Star Ferry Tale” de 2024 pousse cette idée encore plus loin en transformant l’iconique ferry qui traverse le port de Victoria en un vaisseau spatial miniature voyageant à travers le cosmos, Hong Kong scintillant en contrebas comme une constellation de lumières acryliques. Cette vision onirique née pendant les années COVID de confinement reflète l’expérience de milliers de Hongkongais qui, incapables de voyager, regardaient leur ville depuis Google Earth, la voyant littéralement d’un point de vue extraterrestre.
L’accueil que reçoit le travail de Wong à Hong Kong même est révélateur. Lors d’Art Basel Hong Kong, des milliers de visiteurs se pressaient pour voir sa peinture nocturne de Tai Tam Tuk, comme s’ils contemplaient la Joconde au Louvre. Ce n’était pas simplement de l’admiration artistique mais une reconnaissance viscérale. Les spectateurs identifiaient des lieux précis, partageaient des anecdotes personnelles sur ces endroits : “Ma fille va à l’école juste là”, “Je conduis sur cette route deux fois par jour”. Cette connexion émotionnelle intense suggère que Wong ne peint pas seulement des paysages mais capture l’âme collective d’une ville.
Alors que faire de Stephen Wong Chun Hei ? Comment situer cet artiste qui refuse les catégories faciles, qui mélange allègrement Constable et PlayStation, plein air et Google Earth, tradition chinoise et anime japonais ? La réponse réside peut-être dans ce refus même de choisir. Wong représente une génération d’artistes pour qui ces dichotomies, virtuel versus réel, tradition versus modernité, local versus global, n’ont plus aucun sens. Il ne cherche pas à résoudre ces tensions mais à les habiter pleinement.
Sa pratique suggère que la peinture de paysage n’est pas morte mais simplement en mutation, s’adaptant à un monde où nos expériences du territoire passent par une multitude de médiums différents. Un paysage n’est plus seulement ce que nous voyons lors d’une randonnée, mais aussi ce que nous explorons dans un jeu vidéo, ce que nous survolons sur Google Earth, ce que nous reconstruisons dans notre mémoire défaillante. Wong peint tous ces paysages à la fois, créant des synthèses impossibles qui ressemblent étrangement à la vérité.
Ce qui rend son travail particulièrement puissant, c’est qu’il n’est jamais cynique. Malgré toute son immersion dans les mondes virtuels, malgré sa conscience aiguë de l’artificialité de ses couleurs saturées, Wong peint avec un amour évident pour son sujet. On sent dans chaque coup de pinceau la joie du randonneur découvrant une nouvelle vue, l’excitation du joueur explorant un territoire inconnu, l’affection du citoyen pour sa ville imparfaite.
Les petites figurines humaines qui parsèment ses compositions, randonneurs sur des sentiers lointains, parachutistes flottant au-dessus des vallées et peintres installés avec leur chevalet, sont peut-être des autoportraits spirituels. Wong se place lui-même dans ces paysages, non pas comme un conquérant romantique mais comme un participant humble, un témoin parmi d’autres de la beauté précaire du monde. Cette humilité, combinée à son ambition formelle et son innovation technique, fait de lui l’un des peintres les plus intéressants de sa génération.
Dans un marché de l’art souvent obsédé par le conceptuel et le provocateur, Wong ose être simplement beau. Mais cette beauté n’est pas naïve. Elle est construite sur une compréhension sophistiquée de la façon dont nous voyons aujourd’hui, de la façon dont les écrans ont reconfiguré notre perception, de la façon dont la mémoire et l’imagination collaborent pour créer notre expérience du réel. Ses paysages impossibles, avec leurs roses électriques et leurs verts fluo, nous montrent que la vérité subjective peut être plus révélatrice que n’importe quelle fidélité documentaire.
Wong Chun Hei ne nous demande pas de choisir entre la randonnée et le jeu vidéo, entre la contemplation et l’écran, entre la tradition et l’innovation. Il nous montre qu’un artiste contemporain peut et doit embrasser toutes ces contradictions, les transformer en quelque chose de nouveau, de vibrant, d’authentiquement personnel. Et dans ses meilleurs moments, regarder ses peintures procure exactement la sensation qu’il décrit : celle d’être transporté, de flotter au-dessus d’un territoire familier qui semble soudainement étranger, merveilleux, digne d’être préservé sur une toile avant qu’il ne disparaisse à jamais.
- David Hockney (né en 1937) est connu notamment pour ses paysages du Yorkshire réalisés à partir de 2004, caractérisés par une approche subjective de la couleur et de la composition tout en maintenant un lien fort avec l’observation directe de la nature.
- Citation de Stephen Wong Chun Hei, in “Memories Emerge in Stephen Wong Chun Hei’s Paintings as Vivid Saturated Landscapes”, This is Colossal, 25 janvier 2023.
- Citation de Stephen Wong Chun Hei, in “Stephen Wong”, Unit London.
- Citation de Stephen Wong Chun Hei, in “Stephen Wong: The painter who builds up landscapes ‘like Lego'”, CNN Style, 14 mars 2022.