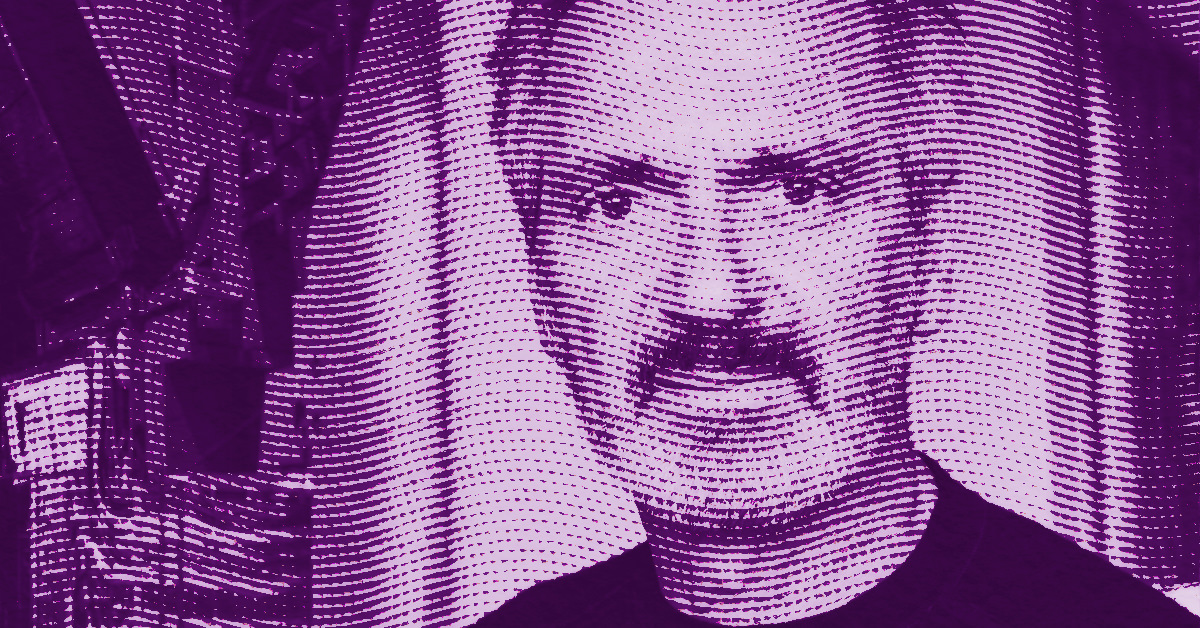Écoutez-moi bien, bande de snobs, Thomas Struth n’est ni le chroniqueur froid que certains prétendent voir ni le simple héritier des Becher qu’on s’obstine à décrire. Cet homme de soixante et onze ans nous offre depuis près de cinq décennies une oeuvre d’une cohérence implacable, construite comme une cathédrale de l’image contemporaine où chaque série dialogue avec les autres selon une logique aussi rigoureuse qu’un système philosophique. Son appareil photo devient l’instrument d’une enquête permanente sur les structures qui organisent notre existence collective, des rues désertes de Düsseldorf aux laboratoires du CERN, en passant par ces troublants portraits de famille et ces scènes de musée où se joue le théâtre éternel du regard.
L’enquête urbaine
Dès la fin des années 1970, Struth développe une approche photographique qui rompt avec les conventions documentaires de son époque. Ses photographies urbaines en noir et blanc révèlent moins la surface visible des villes que leur structure profonde, cette géométrie cachée qui organise nos déplacements et nos rencontres. Dans Düsselstrasse, Düsseldorf (1979), l’artiste ne se contente pas de documenter un paysage urbain : il révèle la stratification temporelle d’une société, ces couches d’intentions successives qui s’accumulent dans l’espace public comme les strates géologiques témoignent du temps long de la Terre.
Cette méthode trouve une résonance particulière avec l’oeuvre de Robert Musil [1], cet écrivain autrichien qui décrivait l’homme moderne comme façonné par “les contre-formations de ce qu’il a créé”. Dans L’Homme sans qualités, Musil observait que “les murs de la rue rayonnent des idéologies”, formule qui semble écrite pour les photographies urbaines de Struth. L’artiste allemand saisit précisément ces radiations idéologiques dans ses cadrages frontaux et ses perspectives centrales. Chaque façade, chaque fenêtre, chaque trace d’usure raconte l’histoire d’une décision collective, d’un choix architectural, d’une adaptation pragmatique aux contraintes du réel.
La ville selon Struth devient un témoignage géant où se superposent les intentions de multiples acteurs historiques. Architectes, urbanistes, habitants, commerçants, autorités publiques : tous ont laissé leur empreinte dans ces espaces que l’objectif révèle comme autant de “lieux inconscients” où se cristallisent les rapports de force d’une époque. Cette approche dépasse largement le simple constat sociologique pour atteindre une véritable archéologie du présent, où chaque détail architectural témoigne des tensions qui travaillent le corps social.
L’absence systématique de figures humaines dans ces images renforce leur dimension d’enquête sur les structures plutôt que sur les individus. Struth nous invite à comprendre comment l’environnement bâti conditionne nos comportements, nos circulations, nos possibilités de rencontre ou d’isolement. Ces rues vides ne sont pas dépeuplées : elles sont saturées de la présence fantomatique de tous ceux qui les ont parcourues, transformées et habitées. Le photographe révèle ainsi la dimension profondément politique de l’espace urbain, cette capacité du cadre architectural à orienter nos gestes et nos pensées selon des logiques qui nous dépassent.
Les portraits de famille
L’évolution vers la photographie de famille marque un tournant décisif dans l’oeuvre de Struth. Ces portraits, commencés dans les années 1980 en collaboration avec le psychanalyste Ingo Hartmann, explorent les mécanismes par lesquels se transmettent les structures sociales élémentaires. Loin des conventions du portrait bourgeois, ces images révèlent la complexité des dynamiques familiales contemporaines, ces jeux subtils de proximité et de distance qui organisent les rapports entre générations.
La référence aux théories de Jacques Lacan [2] s’impose ici pour saisir toute la portée de ces compositions. Le psychanalyste français avait montré comment la famille constitue le premier lieu de structuration symbolique de l’individu, cet espace où se noue le rapport à l’autorité, à la différence des sexes, à la transmission intergénérationnelle. Les portraits de Struth donnent à voir précisément ces mécanismes à l’oeuvre dans l’organisation spatiale des corps, la distribution des regards, la gestuelle qui trahit les enjeux inconscients de chaque configuration familiale.
Dans The Richter Family (1989), par exemple, l’arrangement des personnages révèle bien plus qu’une simple composition esthétique : il cartographie les rapports de pouvoir, les alliances tacites, les distances affectives qui structurent ce microcosme social. La présence du fils dans les bras du père, l’écart maintenu avec l’épouse, la disposition des objets dans l’espace domestique : chaque détail participe d’une grammaire relationnelle que l’objectif de Struth décrypte avec une précision clinique.
Ces images fonctionnent comme autant de “scènes primitives” au sens où l’entendait Lacan, ces moments fondateurs où se cristallise l’organisation psychique du sujet. En photographiant ses proches et leurs familles, Struth ne verse jamais dans l’intimisme complice : il maintient cette distance analytique qui permet de saisir les mécanismes universels à l’oeuvre dans ces configurations singulières. Ses portraits révèlent comment chaque famille reproduit, adapte ou subvertit les modèles relationnels hérités de l’histoire collective.
La technique photographique elle-même participe de cette approche psychanalytique. Les temps de pose relativement longs, la nécessité de maintenir une position statique, l’attente partagée face à l’objectif : tous ces éléments créent une situation artificielle qui révèle les tensions habituellement masquées par la fluidité des interactions quotidiennes. Struth transforme ainsi l’acte photographique en dispositif révélateur, capable de faire affleurer les structures inconscientes qui organisent les liens familiaux.
L’artiste évite soigneusement l’écueil du voyeurisme en maintenant ses modèles dans leur dignité. Ces familles posent avec gravité, conscientes de participer à une entreprise qui les dépasse. Elles deviennent les représentants de configurations sociales plus larges, permettant au spectateur de reconnaître dans ces visages inconnus quelque chose des mécanismes qui organisent sa propre histoire familiale. Cette universalisation du particulier constitue l’un des grands enjeux esthétiques de cette série, qui transforme l’anecdote personnelle en révélation anthropologique.
Les photographies de musée
La série des photographies de musée, développée depuis la fin des années 1980, constitue peut-être l’accomplissement le plus abouti de la démarche de Struth. Ces images, qui montrent des visiteurs contemplant des oeuvres d’art, mettent en scène la complexité de l’expérience esthétique contemporaine tout en interrogeant les conditions de possibilité du regard artistique dans notre époque saturée d’images.
Art Institute of Chicago II (1990) est un exemple parfait de cette approche. Une femme avec une poussette se tient devant Rue de Paris, temps de pluie de Gustave Caillebotte. Sa silhouette contemporaine fait écho aux figures du tableau impressionniste, créant un dialogue temporel saisissant entre deux époques de la modernité urbaine. Struth révèle ainsi comment l’art du passé continue d’éclairer notre présent, mais aussi comment notre regard contemporain transforme rétroactivement la signification des oeuvres anciennes.
Ces photographies fonctionnent selon une logique de mise en abîme vertigineuse : nous regardons des gens qui regardent des oeuvres qui représentent d’autres gens regardant le monde. Cette multiplication des niveaux de regard révèle la dimension fondamentalement réflexive de l’expérience artistique. Struth ne se contente pas de documenter la fréquentation des musées : il interroge les mécanismes par lesquels se constitue notre rapport collectif à l’art et à l’histoire.
L’influence de la pensée de Hans Belting sur cette série mérite d’être soulignée. L’historien de l’art allemand avait montré comment les images fonctionnent comme des “labyrinthes” où se perdent nos tentatives de maîtrise rationnelle du visible. Les photographies de Struth actualisent cette intuition en révélant la complexité des processus perceptifs à l’oeuvre dans la contemplation artistique. Chaque visiteur apporte son histoire, ses références, ses attentes, créant une polyphonie interprétative que l’objectif du photographe parvient à saisir dans sa dynamique collective.
L’organisation spatiale de ces images révèle également une réflexion approfondie sur les enjeux politiques de la diffusion culturelle. Ces masses de touristes qui se pressent devant La Joconde ou les fresques de Raphaël témoignent de la démocratisation de l’accès à l’art, mais aussi de sa transformation en spectacle de consommation. Struth évite soigneusement le piège de la dénonciation facile : ses images révèlent plutôt la persistance du désir esthétique au coeur même de cette économie de l’attention qui caractérise notre époque.
Nature et Politique : L’enquête technologique
La série Nature et Politique (2008-2015) marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’oeuvre de Struth. Ces photographies de laboratoires scientifiques et d’installations technologiques révèlent l’envers du décor de notre civilisation technique, ces lieux habituellement invisibles où s’élabore notre avenir collectif. L’artiste y poursuit son enquête sur les structures contemporaines selon une méthode qui synthétise les acquis de ses recherches précédentes.
Dans Tokamak Asdex Upgrade Periphery (2009), Struth nous confronte à la complexité vertigineuse des dispositifs de fusion nucléaire développés à l’Institut Max Planck. Ces enchevêtrements de cables, de tubes et d’appareillages divers révèlent l’existence d’un monde technique qui échappe largement à notre compréhension commune. L’artiste ne cherche pas à expliquer ou à vulgariser : il révèle plutôt l’écart croissant entre la sophistication de nos outils et notre capacité collective à en saisir les enjeux.
Ces images fonctionnent comme des allégories de notre condition contemporaine, prise entre les promesses technologiques et notre incapacité à maîtriser leurs conséquences. Struth révèle la beauté plastique de ces installations tout en maintenant leur caractère énigmatique. Ces laboratoires deviennent les cathédrales de notre époque, lieux de culte d’une rationalité technique qui prétend résoudre les défis écologiques et énergétiques de l’humanité.
La série s’achève sur une méditation troublante avec les photographies d’animaux morts réalisées à l’Institut Leibniz de Berlin. Ces images de zèbres, d’ours ou de renards saisis dans leur dernier repos révèlent la fragilité universelle du vivant face aux promesses d’éternité technologique. Struth établit ainsi un dialogue poignant entre nos ambitions prométhéennes et la réalité immuable de la mortalité, rappelant que toute politique demeure inscrite dans les limites de la condition naturelle.
L’architecture d’une oeuvre totale
L’oeuvre de Thomas Struth résiste aux tentatives de classification par séries distinctes. Elle fonctionne plutôt comme un système complexe où chaque ensemble d’images dialogue avec les autres selon une logique d’ensemble qui révèle progressivement sa cohérence. Cette architecture globale transforme chaque photographie individuelle en élément d’une recherche plus vaste sur les conditions contemporaines du regard et de la représentation.
Cette approche systémique place Struth dans la lignée des grands enquêteurs de la modernité, de Charles Dickens décrivant les transformations de Londres industriel à James Joyce cartographiant Dublin dans Ulysse. Comme ces écrivains, le photographe allemand construit une oeuvre-monde capable de saisir les mutations profondes de son époque selon une méthode qui allie rigueur analytique et sensibilité esthétique.
L’influence de son passage par la peinture demeure perceptible dans cette conception architecturale de l’oeuvre photographique. Struth compose ses séries comme un peintre organise les éléments d’un retable : chaque panneau possède son autonomie tout en participant d’un projet d’ensemble qui le dépasse. Cette approche lui permet d’éviter l’écueil du documentaire illustratif pour atteindre une véritable poétique du contemporain.
La temporalité particulière de cette construction est intéressante. Contrairement aux logiques de l’actualité médiatique, Struth développe ses recherches selon un rythme lent qui lui permet d’approfondir progressivement sa compréhension des phénomènes étudiés. Cette patience révèle sa dette envers la tradition allemande de la Bildung, cette formation progressive de la conscience par l’accumulation raisonnée des expériences et des connaissances.
L’oeuvre de Struth témoigne d’une ambition rare dans l’art contemporain : celle de construire un système de représentation capable de saisir la complexité du monde contemporain sans sacrifier ni la rigueur analytique ni l’exigence esthétique. Cette synthèse place le photographe allemand parmi les créateurs indispensables pour comprendre les transformations de notre époque et les défis qu’elles posent à notre capacité collective de représentation et d’action.
Dans un monde saturé d’images instantanées, Thomas Struth nous rappelle que la photographie peut encore servir d’instrument de connaissance et de révélation. Son oeuvre prouve que la patience du regard peut révéler des structures invisibles, que la rigueur de la composition peut révéler des vérités cachées, que l’art peut encore prétendre éclairer notre condition commune sans renoncer à sa dimension esthétique. Cette leçon demeure plus actuelle que jamais dans notre époque de confusion visuelle et de surproduction d’images.
- Robert Musil, L’Homme sans qualités, Seuil, 1956-1957
- Jacques Lacan, Écrits, Seuil, 1966