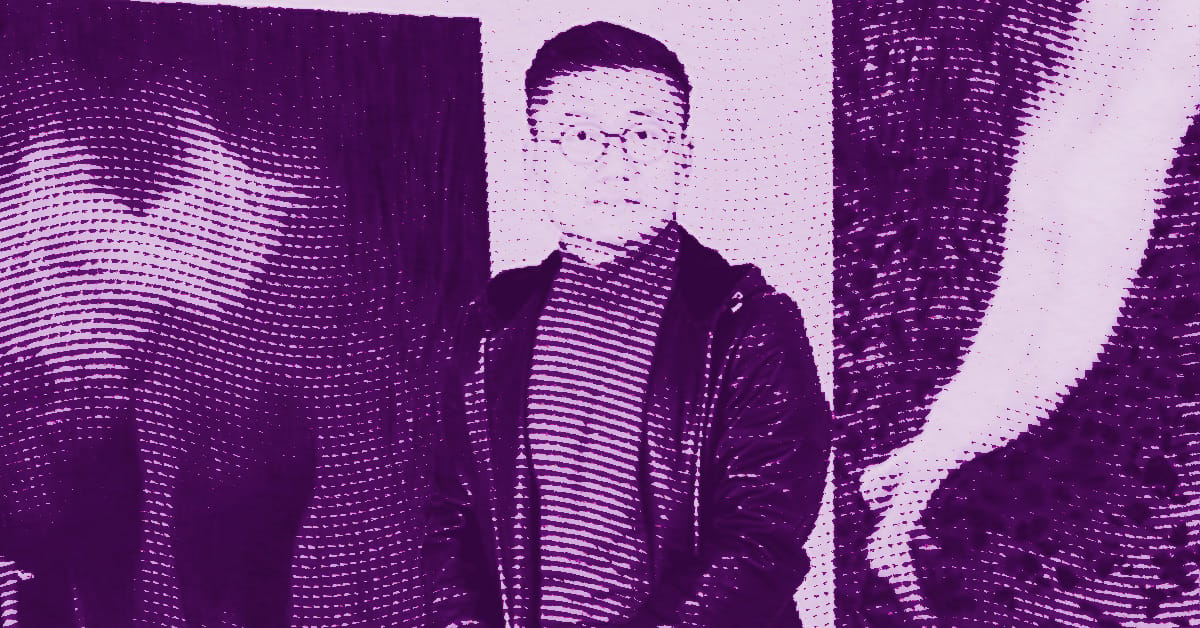Écoutez-moi bien, bande de snobs : pendant que vous vous extasiez devant les dernières installations conceptuelles qui transforment les galeries en salles d’attente d’aéroport, un peintre chinois installé à Paris depuis vingt ans tisse patiemment une oeuvre qui questionne l’existence avec une acuité qui devrait vous faire rougir de vos certitudes. Xie Lei vient de remporter le Prix Marcel Duchamp 2025, et ce couronnement n’est pas un hasard : il récompense une pratique picturale qui sonde les abîmes de l’ambiguïté humaine avec une rigueur intellectuelle que peu osent encore revendiquer dans le paysage artistique contemporain.
Né à Huainan en 1983, formé aux Beaux-Arts de Pékin puis de Paris où il a soutenu le premier doctorat en pratique plastique de l’institution parisienne, Xie Lei appartient à cette lignée d’artistes qui n’ont jamais renoncé au médium pictural malgré les sirènes de l’art conceptuel. Son doctorat s’intitulait “Entre chien et loup : Poétique de l’étrange pour un peintre d’aujourd’hui”, formule qui résume admirablement son projet artistique. Car c’est bien dans cette heure incertaine, cet instant où le jour bascule dans la nuit sans que l’on sache exactement où se situe la frontière, que se loge toute la puissance de son travail.
Pour le Prix Marcel Duchamp 2025, Xie Lei a présenté sept toiles monumentales d’un vert phosphorescent où des corps spectraux semblent flotter dans un liquide amniotique cosmique. Chute libre ou ascension ? Le peintre refuse de trancher, préférant maintenir ses figures dans cet état d’apesanteur métaphysique qui caractérise son oeuvre. Les silhouettes, délibérément floues et dépourvues de traits identifiables, irradient une lumière presque surnaturelle au sein d’un décor végétal qui évoque autant les profondeurs marines que les forêts nocturnes. Cette indétermination n’est pas paresse formelle mais projet esthétique revendiqué : en refusant de fixer l’identité, le genre ou même l’humanité complète de ses figures, Xie Lei ouvre un espace de projection universel.
La littérature française a nourri son imaginaire de manière déterminante. Parmi ses références majeures figure Albert Camus, dont le premier roman inachevé “La Mort heureuse” (1971) [1] a donné son titre à une récente exposition personnelle chez Semiose en 2025. Cet oxymore camusien (comment peut-on être à la fois mort et heureux ?) résonne profondément avec la démarche picturale de Xie Lei. Dans ce roman écrit entre 1936 et 1938 mais abandonné par Camus lui-même, le personnage de Patrice Mersault cherche désespérément le bonheur, quitte à commettre un meurtre pour s’approprier l’argent qui lui permettra de vivre pleinement. Cette quête existentielle se termine par une acceptation sereine de la mort, dans une fusion avec la nature méditerranéenne qui préfigure les thèmes de L’Étranger.
Xie Lei s’approprie cette tension entre la vie et la mort, ce moment suspendu où Mersault, malade et lucide, accepte son destin avec une forme d’euphorie tragique. Ses peintures cultivent exactement cette zone d’indécidabilité : les corps qu’il représente sont-ils des agonisants ou des êtres en lévitation mystique ? Sont-ils en train de sombrer dans l’abîme ou de renaître dans une dimension spirituelle ? Cette ambiguïté structurelle s’inscrit dans la tradition de la philosophie de l’absurde développée par Camus, où l’homme doit créer son propre sens face à un monde dépourvu de signification intrinsèque. Les figures de Xie Lei semblent incarner cet instant précis où la conscience humaine affronte le non-sens de l’existence sans pour autant sombrer dans le désespoir nihiliste.
L’oxymore “mort heureuse” trouve son équivalent pictural dans les choix chromatiques du peintre. Ces verts aquatiques, ces bleus profonds, ces jaunes orangés qui nimbent ses personnages ne correspondent à aucune carnation naturelle. Xie Lei compose ses palettes sans recourir au noir ni au blanc, superposant une dizaine de couches de bleus et de verts pour obtenir cette tonalité irréelle, presque psychédélique. Le résultat produit un effet de présence spectrale : les corps semblent à la fois terriblement charnels et complètement éthérés, comme si la matière était en train de se dissoudre dans la lumière. Cette dualité chromatique matérialise l’intuition de Camus selon laquelle le bonheur le plus intense peut surgir au moment même où l’on accepte la finitude de l’existence.
Lorsque Xie Lei intitule ses tableaux d’un seul mot, “Embrace”, “Breath”, “Possession” ou “Rescue”, il procède comme Camus nommant son roman : par une condensation maximale du sens qui laisse ouvertes toutes les interprétations. Un baiser peut être une étreinte amoureuse ou un étouffement vampirique. Une respiration peut signifier la vie qui persiste ou le dernier souffle qui s’échappe. Cette économie lexicale force le spectateur à confronter sa propre projection sur l’oeuvre, à reconnaître que le sens n’est jamais donné mais toujours construit par celui qui regarde. Dans “La Mort heureuse”, Mersault accède au bonheur non pas en trouvant des réponses mais en acceptant les contradictions inhérentes à l’existence humaine. Les peintures de Xie Lei proposent une expérience similaire : elles ne résolvent rien mais offrent un espace de contemplation où les paradoxes peuvent coexister.
L’artiste a confié dans un entretien : “Mes sujets sont des chimères, des combinaisons d’éléments tirés de ma mémoire. Des scènes banales où quelque chose d’extraordinaire arrive toujours” [2]. Cette déclaration révèle une proximité avec l’univers de Camus où le quotidien bascule soudainement dans l’absurde, où un employé de bureau peut devenir meurtrier sous un soleil algérien aveuglant. Les “chimères” de Xie Lei sont ces moments où le réel se fissure et laisse entrevoir une autre dimension de l’existence, ni tout à fait vivante ni tout à fait morte, ni tout à fait présente ni tout à fait absente. C’est dans cet entre-deux que se loge la “mort heureuse” : non pas un état définitif mais un passage, une zone de transition où les contraires se touchent.
Le rapport que Xie Lei entretient avec la psychanalyse, et particulièrement avec les travaux de Julia Kristeva, éclaire une autre dimension essentielle de son oeuvre. Parmi les références théoriques qu’il cite explicitement figure cette écrivaine française d’origine bulgare, dont les recherches sur l’abjection, l’étrangeté et les états limites de l’identité trouvent des échos frappants dans sa peinture. Kristeva a développé dans “Étrangers à nous-mêmes” (1988) [3] une réflexion profonde sur la figure de l’étranger, non pas comme l’autre qu’on rejette, mais comme cette part de nous-mêmes que nous refoulons. Elle écrit que “l’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre demeure”. Cette idée selon laquelle l’altérité la plus radicale se trouve en nous-mêmes irrigue puissamment le travail de Xie Lei.
Ses figures sans visage, sans genre identifiable, sans appartenance ethnique claire, incarnent précisément cette étrangeté constitutive de toute identité. En refusant de donner à ses personnages des traits qui permettraient de les assigner à une catégorie sociale, raciale ou sexuelle, Xie Lei les maintient dans un état de “fugitivité identitaire”. Ces corps flottants, aux contours estompés, semblent en perpétuelle métamorphose, comme si l’identité n’était jamais fixe mais toujours en devenir. Kristeva insistait sur le fait que reconnaître l’étranger en soi permet de ne pas le haïr chez l’autre. Les peintures de Xie Lei opèrent selon ce même principe : en représentant des êtres qui échappent à toute catégorisation stable, elles nous confrontent à notre propre indétermination fondamentale.
Le concept d’abjection chez Kristeva trouve également une résonance dans l’oeuvre de Xie Lei, notamment dans son traitement de la dissolution des corps. L’abjection, selon Kristeva dans “Pouvoirs de l’horreur” (1980) [4], désigne ce qui perturbe l’identité, le système, l’ordre, ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles. Or les figures peintes par Xie Lei sont précisément abjectives en ce sens : elles perturbent les frontières entre le vivant et le mort, entre le matériel et l’immatériel, entre le moi et l’autre. Leurs chairs semblent se dissoudre dans l’environnement pictural, leurs contours se fondent dans les halos de lumière qui les entourent, créant une confusion volontaire entre le sujet et son fond. Cette instabilité ontologique produit un malaise fécond chez le spectateur, qui ne parvient pas à stabiliser son regard sur des formes qui se dérobent constamment.
Le processus pictural de Xie Lei, couches successives de peinture à l’huile suivies de grattages au pinceau, au papier, voire à la main, participe de cette esthétique de la dissolution. On devine parfois ses empreintes digitales dans la matière picturale, traces d’une présence physique qui semble elle-même en voie d’effacement. Cette technique crée des surfaces d’une grande complexité tactile où la lumière semble émaner de l’intérieur de la toile plutôt que se réfléchir à sa surface. Les corps deviennent des sources lumineuses autonomes, phosphorescentes, comme habités par une énergie vitale qui persiste alors même que leur forme se désagrège. C’est peut-être là que la pensée de Kristeva sur la mélancolie entre en résonance avec le travail du peintre.
Dans “Soleil noir : Dépression et mélancolie” (1987), Kristeva explore les états psychiques où le sujet fait l’expérience d’une perte qui ne peut être symbolisée par le langage. La mélancolie se caractérise par une incapacité à faire le deuil, par un attachement paradoxal à l’objet perdu qui devient une part inséparable du moi. Les figures spectrales de Xie Lei pourraient être comprises comme des incarnations picturales de cet état mélancolique : ni tout à fait présentes ni tout à fait absentes, elles hantent l’espace pictural comme des revenants qui ne parviennent pas à quitter le monde des vivants. Leur luminescence fantomatique évoque cette persistance de ce qui a disparu, cette présence insistante de l’absence qui définit l’expérience mélancolique. Le vert aquatique qui domine ses récentes séries pourrait d’ailleurs être lu comme une métaphore liquide de cet état psychique fluide, sans contours nets, où le sujet se perd dans une rêverie mortifère.
Kristeva a également développé une réflexion sur la dimension maternelle du psychisme, sur ce lien primordial à la mère qui précède toute construction identitaire. Les espaces verts et aquatiques que peint Xie Lei, avec leurs qualités enveloppantes et immersives, évoquent immanquablement le liquide amniotique, cet environnement originel où le foetus ne faisait pas encore la différence entre lui-même et le monde extérieur. Les corps en chute libre ou en lévitation qui peuplent ses toiles semblent retourner vers cet état fusionnel prénatal, cherchant à retrouver une complétude perdue. Cette régression vers l’indifférenciation première serait alors une tentative désespérée d’échapper aux souffrances de l’individuation, aux blessures que provoque inévitablement la séparation d’avec la mère.
La pratique de Xie Lei se nourrit explicitement de ses rêves nocturnes, ce que le peintre a maintes fois affirmé en entretien. Pour son projet du Prix Marcel Duchamp, il est parti d’un songe récurrent : le rêve de voler qui bascule en cauchemar de chute. Kristeva, formée à la psychanalyse freudienne et lacanienne, accordait une importance capitale au travail du rêve dans la production artistique. Le rêve permet d’accéder à des zones du psychisme inaccessibles à la conscience diurne, de donner forme à des angoisses et des désirs qui ne peuvent s’exprimer autrement. Les peintures de Xie Lei fonctionnent comme des rêves visuels : elles obéissent à une logique onirique où les lois de la physique et de l’identité se trouvent suspendues, où les corps peuvent flotter sans pesanteur, où les couleurs n’ont plus besoin de correspondre au réel. Cette dimension onirique explique en partie l’effet hypnotique de ses toiles : elles nous plongent dans un état second, entre veille et sommeil, comparable à celui que Xie Lei lui-même cherche à atteindre pour créer.
L’artiste a décrit sa méthode de travail en deux étapes : d’abord mentale et conceptuelle, puis physique et gestuelle. Cette dualité rappelle la distinction de Kristeva entre le symbolique et le sémiotique, entre l’ordre du langage structuré et celui des pulsions corporelles qui le débordent. Si la première phase correspond au symbolique, sélection d’une image, recherche de ses significations multiples, étude de ses résonances culturelles, la seconde relève du sémiotique : l’artiste laisse place au hasard, aux “accidents heureux”, à une spontanéité gestuelle qui échappe au contrôle rationnel. Cette dialectique entre maîtrise et lâcher-prise produit des oeuvres où l’intellect et le corps dialoguent constamment, où la pensée philosophique s’incarne dans la matière picturale sans jamais se réduire à une simple illustration d’idées.
La question que pose Xie Lei dans sa pratique pourrait se formuler ainsi : comment représenter l’ambiguïté en peinture ? Comment donner forme visible à ce qui par définition refuse toute fixation, toute détermination stable ? Kristeva avait identifié une dimension “révoltante” dans l’art véritable, c’est-à-dire sa capacité à remettre en question les ordres établis, à perturber les classifications rassurantes, à révéler la complexité cachée sous l’apparente simplicité. Les peintures de Xie Lei sont révoltantes en ce sens précis : elles résistent à toute lecture univoque, frustrent le désir spectatoriel d’un sens transparent, imposent l’expérience déroutante d’une beauté qui ne se laisse pas posséder. Elles nous obligent à accepter qu’il existe des zones d’indétermination irréductibles, que tous les paradoxes ne peuvent pas être résolus, que certaines questions doivent demeurer ouvertes.
Cette acceptation de l’ambiguïté n’est pas relativisme facile mais exigence éthique et esthétique. Dans un monde contemporain obsédé par la clarté, l’efficacité et l’immédiateté, où chaque phénomène doit pouvoir s’expliquer en quelques secondes sur les réseaux sociaux, Xie Lei défend une complexité assumée. Ses toiles exigent du temps, de la patience, une disponibilité contemplative devenue rare. Elles ne se livrent pas au premier regard mais se déploient lentement, révélant progressivement leurs strates de significations. Cette lenteur constitue en soi un geste politique : contre l’accélération généralisée de nos existences, contre la tyrannie du “scroll” infini, le peintre impose un rythme méditatif qui permet au spectateur de se reconnecter avec sa propre intériorité.
Le directeur du Musée d’Art Moderne de Paris, Fabrice Hergott, a salué dans l’oeuvre de Xie Lei “une expression particulièrement aboutie de ce qu’est ce début de XXIe siècle”, où “l’absence de repères et le vertige sont devenus les sensations les plus communément ressenties”. Cette lecture sociologique ne doit pas nous faire oublier que la puissance de ces peintures réside précisément dans leur refus de l’anecdotique contemporain. Xie Lei ne peint pas notre époque comme un journaliste la décrirait, il en saisit la structure affective profonde, cette angoisse existentielle qui dépasse les circonstances historiques particulières. Ses figures spectrales parlent autant de notre présent que de la condition humaine en général, de cette solitude métaphysique que chaque génération doit affronter à sa manière.
Voilà donc un peintre qui n’a renoncé ni à la figuration ni à l’ambition philosophique de l’art, qui refuse les facilités du premier degré comme celles de l’abstraction totale, qui construit patiemment une oeuvre exigeante dans un contexte peu favorable à l’exigence. Son couronnement au Prix Marcel Duchamp ne doit pas être lu comme une simple reconnaissance institutionnelle mais comme le symptôme d’un besoin collectif : celui de retrouver, face aux toiles de Xie Lei, une profondeur de questionnement que le marché de l’art contemporain a trop souvent évacuée au profit du spectaculaire et du scandaleux. Ces corps suspendus entre chute et envol, entre présence et absence, entre vie et mort, nous rappellent que l’art digne de ce nom ne résout rien mais approfondit nos questions, ne nous console pas mais nous rend plus lucides face à l’énigme de notre propre existence. Dans un monde saturé d’images instantanées et d’émotions préfabriquées, Xie Lei nous offre quelque chose qui est devenu précieux : le silence nécessaire pour entendre le murmure anxieux de nos propres abîmes. C’est peut-être cela, finalement, qu’on pourrait appeler une mort heureuse : accepter de regarder en face ce qui nous effraie, et découvrir dans cette confrontation non pas la terreur mais une forme étrange de sérénité. Le peintre ne nous promet pas le bonheur mais il nous montre comment habiter poétiquement nos contradictions, comment transformer nos vertiges en matière picturale, comment faire de notre incertitude constitutive non pas une faiblesse mais la source même d’une beauté troublante et nécessaire.
- Albert Camus, “La Mort heureuse”, Gallimard, collection Cahiers Albert Camus, 1971
- Citation de Xie Lei publiée dans le catalogue de l’exposition du Prix Marcel Duchamp 2025, Musée d’Art Moderne de Paris
- Julia Kristeva, “Étrangers à nous-mêmes”, Fayard, 1988
- Julia Kristeva, “Pouvoirs de l’horreur : Essai sur l’abjection”, Éditions du Seuil, 1980