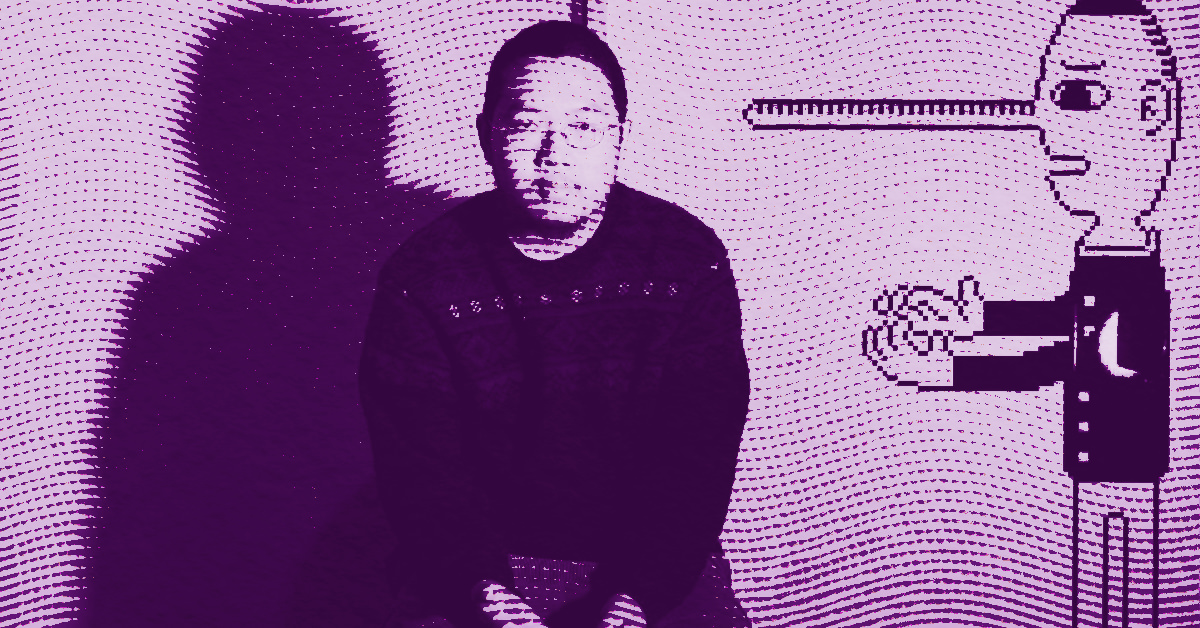Écoutez-moi bien, bande de snobs : pendant que vous vous extasiez devant les éternelles redites du marché de l’art contemporain occidental, un homme dessine des cheminées fumantes sur les ruines industrielles de la Chine. Yan Cong, né en 1983 dans la province du Hubei sous le nom de Peng Han, a choisi comme pseudonyme le mot chinois pour “cheminée”, un choix qui n’a rien d’anodin pour qui veut comprendre son oeuvre. Cette cheminée qu’il évoque constamment, celle qui crache sa fumée noire sur les paysages périurbains délabrés de l’Empire du Milieu, devient sous son pinceau le symbole d’une beauté âpre et d’une esthétique du déclin.
Diplômé de la Central Academy of Fine Arts de Pékin où il a étudié la peinture traditionnelle chinoise, Yan Cong a rapidement abandonné les sentiers convenus pour se tourner vers la bande dessinée, ce médium méprisé que la Chine considère encore comme une littérature pour enfants. Mais voilà le tour de force : cet homme ne fait pas de bandes dessinées. Il crée des récits graphiques qui empruntent autant à la peinture acrylique qu’au collage, autant à l’art brut qu’à l’expressionnisme allemand, et qui refusent obstinément de se plier aux catégories établies. Représenté par la Star Gallery à Pékin et la Leo Gallery à Hong Kong, il navigue entre les galeries d’art contemporain et les publications underground, entre les expositions muséales et les fanzines photocopiés vendus sous le manteau.
Ce qui frappe d’emblée dans l’univers de Yan Cong, c’est cette filiation inattendue avec l’expressionnisme allemand, héritage qu’il revendique lui-même en citant l’influence déterminante d’Anke Feuchtenberger sur son travail. L’artiste allemande, née à Berlin-Est en 1963, a développé depuis les années 1990 une esthétique qui puise dans les traditions de la gravure sur bois et du cinéma expressionniste allemand. Professeure à l’Université des Sciences Appliquées de Hambourg depuis 1997, Feuchtenberger a redéfini le potentiel de la bande dessinée en tant que forme d’art à travers son engagement avec diverses sources et techniques nouvelles de narration graphique [1]. Yan Cong confesse : “C’est probablement sous l’influence des travaux d’Anke Feuchtenberger que je dessine des gens à tête d’animaux. En fait, je n’avais jamais vraiment dessiné d’animaux avant de voir ses travaux… Elle a vraiment eu une énorme influence sur moi !” [2].
Cette connexion entre un artiste chinois contemporain et l’avant-garde allemande n’est pas qu’une simple question d’influence stylistique. Elle révèle une parenté profonde dans l’approche du médium et dans la volonté de subvertir les conventions établies. Tout comme Feuchtenberger et le collectif PGH Glühende Zukunft ont utilisé l’esthétique de la gravure sur bois expressionniste pour se différencier à la fois du néo-expressionnisme est-allemand et du réalisme socialiste imposé par l’État, Yan Cong emploie des personnages aux têtes d’animaux et des décors industriels désolés pour créer un langage visuel qui échappe aux catégories traditionnelles de la bande dessinée chinoise. Ses créatures hybrides, mi-hommes mi-bêtes, errent dans des paysages urbains décomposés où les usines abandonnées et les structures métalliques rouillées créent une atmosphère qui n’est ni tout à fait réaliste ni franchement fantastique.
L’expressionnisme allemand, avec ses corps déformés et ses espaces claustrophobiques, a toujours été un art de la critique sociale et du malaise existentiel. Les artistes comme George Grosz et Otto Dix, dont l’esthétique se retrouve dans le travail de Feuchtenberger, utilisaient la distorsion formelle pour révéler les tensions sous-jacentes de la société allemande de l’entre-deux-guerres. Yan Cong, sans tomber dans l’imitation servile, s’approprie cette tradition pour documenter sa propre réalité : celle d’une Chine en mutation rapide où les zones périurbaines deviennent des no man’s lands entre modernité et tradition, entre développement et délabrement. Ses décors, souvent trouvés sur internet plutôt que photographiés directement, acquièrent par ce processus de médiation numérique une qualité particulière d’étrangeté. Il explique : “J’aime ces décors péri-urbains délabrés. Ils me donnent un sentiment d’étrange fraîcheur… Quand je regarde ces paysages, j’espère toujours qu’il va s’y passer quelque chose” [2].
Cette attente du quelque chose qui pourrait advenir dans ces espaces désolés constitue peut-être le coeur même de la démarche artistique de Yan Cong. Ses récits, loin d’être des narratives linéaires conventionnelles, fonctionnent comme des explorations poétiques de l’espace et du temps. Ses bandes dessinées, publiées en Chine mais aussi en Europe par des éditeurs comme Canicola en Italie et Atrabile en Suisse, résistent à la classification facile. Sont-elles autobiographiques ? Fictionnelles ? La frontière demeure volontairement floue, l’artiste se mettant lui-même en scène dans des récits qui mêlent expériences vécues et fantasmes imaginaires.
Le rapport de Yan Cong à la narration révèle une conception particulière de la bande dessinée comme forme d’art. Contrairement à la tradition manga japonaise qui domine le marché chinois, ou aux super-héros américains qui structurent l’imaginaire occidental du médium, son travail privilégie une approche proche de la poésie graphique. Ses planches ne cherchent pas à raconter une histoire au sens traditionnel du terme, mais plutôt à créer une atmosphère, à suggérer des connexions émotionnelles entre les images. Cette approche fait écho à ce qu’il dit du travail du dessinateur : “Une part importante du travail du dessinateur est de guider le public à travers l’oeuvre”. Dans son oeuvre exposée au Shanghai MoCA Pavilion intitulée “What to Do When You’re Feeling Dispirited”, il rassemble des travaux créés durant des périodes de mélancolie, transformant l’humeur dépressive en matériau artistique.
Cette dimension narrative non-conventionnelle se retrouve dans sa pratique protéiforme qui refuse de s’enfermer dans un seul médium. Yan Cong travaille la bande dessinée, certes, mais aussi la peinture acrylique, le collage, la couture. En 2014, influencé par l’artiste japonais Shinro Ohtake, il s’est lancé dans une série de collages réalisés sans design préalable, simplement en collectant et en assemblant des matériaux trouvés. Cette pratique du collage, qui produit environ 120 pièces en deux mois, témoigne de sa recherche constante de nouvelles méthodes pour échapper à l’inertie créative. Comme il l’explique : “Je cherche toujours à explorer et à profiter d’un sentiment de perte de contrôle, j’essaie d’éviter l’inertie qui me ferait produire de vieilles choses”.
Le positionnement de Yan Cong vis-à-vis du marché de l’art révèle également les tensions particulières qui traversent la scène artistique chinoise contemporaine. Membre du collectif Special Comix, anthologie de bande dessinée alternative imprimée entre 1.000 et 2.000 exemplaires, il évolue dans un environnement où la censure gouvernementale reste omniprésente. En 2014, il organise l’anthologie “Naked Body”, réponse directe à l’interdiction de la nudité dans les publications imprimées en Chine : un appel ouvert pour des bandes dessinées de cinq pages où tous les personnages principaux devaient être nus. Ce geste de résistance culturelle, à la fois subversif et ludique, illustre comment les artistes chinois indépendants naviguent entre contraintes politiques et expression créative.
Yan Cong incarne cette génération d’artistes chinois qui refusent la dichotomie entre art contemporain et culture populaire. Ses oeuvres originales se vendent dans des galeries d’art, mais ses bandes dessinées circulent aussi en ligne, dans des publications pirates, dans des fanzines photocopiés. Il travaille avec des galeries commerciales tout en maintenant son indépendance éditoriale, créant même sa propre publication “Narrative Addiction” après s’être retiré de l’équipe éditoriale de Special Comix. Cette position interstitielle, inconfortable mais fertile, lui permet de questionner les frontières entre les médiums et les circuits de distribution.
Dans un entretien, Yan Cong déclare vouloir “renforcer la relation entre la bande dessinée et l’art contemporain” et espère “subvertir la compréhension du public sur la bande dessinée à travers la combinaison de la bande dessinée et de la peinture de chevalet”. Il ajoute : “Je veux juste qu’ils sachent que la bande dessinée ne peut pas être absente de la communauté de l’art contemporain, parce que je pense toujours que la bande dessinée fait partie de l’art contemporain, même si les habitudes de vision de tout le monde n’ont pas changé” [3].
Voilà donc le projet : forcer les institutions artistiques à reconnaître la bande dessinée comme forme légitime d’expression contemporaine, non pas en abandonnant les spécificités du médium mais au contraire en les affirmant. Les personnages hybrides de Yan Cong, ses paysages industriels désolés, ses récits non-linéaires ne sont pas des compromis entre bande dessinée et art contemporain, mais des oeuvres qui existent pleinement dans les deux domaines simultanément. Cette double appartenance, loin d’affaiblir son travail, en constitue la force principale.
Yan Cong nous rappelle que les hiérarchies entre médiums artistiques restent des constructions sociales arbitraires qui disent plus sur nos préjugés culturels que sur la valeur intrinsèque des oeuvres. Ses cheminées fumantes, ses animaux à visages humains, ses usines abandonnées proposent une poétique du déclin et de la transformation qui résonne bien au-delà des frontières chinoises. Dans un monde où l’art contemporain s’épuise souvent dans la répétition de ses propres codes, où la bande dessinée peine à sortir du ghetto culturel qui l’enferme, le travail de Yan Cong ouvre des perspectives nouvelles. Il ne s’agit pas de célébrer naïvement une prétendue fusion des genres, mais de reconnaître qu’il existe des artistes capables de travailler simultanément dans plusieurs registres sans se soumettre aux logiques dominantes d’aucun.
La leçon est simple mais salutaire : l’art ne se définit ni par son support ni par ses circuits de distribution, mais par la capacité de l’artiste à créer des formes qui nous forcent à repenser nos catégories. Yan Cong, depuis son atelier pékinois, continue de dessiner ses cheminées fumantes sur les décombres de nos certitudes esthétiques. Et pendant que vous vous demandez encore si c’est de la bande dessinée ou de l’art contemporain, lui est déjà passé à autre chose.
- Elizabeth Nijdam, “‘Drawing for me means communication’: Anke Feuchtenberger and German Art Comics after 1989”, dissertation, University of Michigan, 2017.
- Entretien avec Yan Cong par Voitachewski, 2012.
- Sixi Museum, “Yan Cong – Overview”, documentation d’artiste, consulté en octobre 2025.