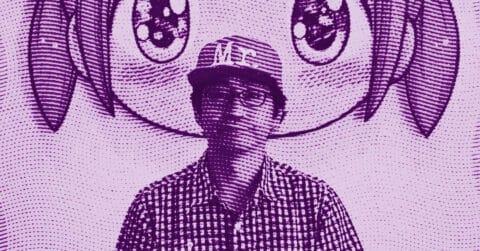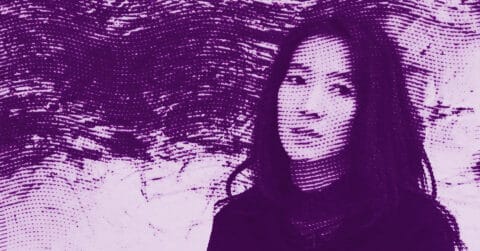Écoutez-moi bien, bande de snobs : Antony Gormley, c’est l’homme qui a osé transformer nos corps en architecture et nos villes en théâtres existentiels. Depuis plus de quarante ans, ce sculpteur britannique né en 1950 martèle une vérité que l’art contemporain feint d’ignorer : nous sommes des créatures spatiales, condamnées à habiter l’espace autant qu’à être habitées par lui. Face à ses armées de fer coulé qui peuplent nos plages, nos toits et nos musées, on ne peut rester indifférent. Gormley ne nous propose pas des objets d’art, mais des expériences phénoménologiques qui interrogent notre rapport au monde avec une urgence que peu d’artistes contemporains parviennent à égaler.
L’oeuvre de Gormley s’élève contre la dictature du regard qui domine notre époque hypervisualisée. Ses sculptures ne se contentent pas d’être vues, elles exigent d’être vécues. Quand il déclare [1] : “Notre apparence appartient aux autres, nous vivons dans l’obscurité du corps”, il pose les fondements d’une esthétique de l’intériorité qui subvertit tous nos codes. Ces mots résonnent avec une profondeur troublante dans une société où l’image règne en maître absolu. Le sculpteur nous rappelle que notre véritable expérience du monde naît dans cette “obscurité du corps” que nous partageons tous, cette chambre noire de la conscience où se forge notre humanité commune.
L’architecture comme métaphore du corps : La poétique des espaces habités
L’exploration de Gormley trouve ses racines les plus profondes dans une conception architecturale du corps humain qui révolutionne notre compréhension de la sculpture contemporaine. Cette vision s’épanouit pleinement dans sa série des “Blockworks”, initiée au début des années 2000, où l’anatomie traditionnelle cède la place à des volumes architectoniques qui transforment le corps en édifice. Ces oeuvres ne représentent pas simplement des corps, elles constituent de véritables architectures corporelles qui interrogent notre rapport à l’espace bâti. L’artiste développe ce qu’il nomme lui-même la dialectique entre le “premier corps” (notre enveloppe biologique) et le “second corps” (notre environnement construit), établissant une continuité troublante entre chair et béton, peau et façade.
Cette approche architecturale trouve sa manifestation la plus spectaculaire dans des oeuvres comme “Model” (2012), construction de cent tonnes d’acier qui permet aux visiteurs de pénétrer dans un corps transformé en bâtiment. L’expérience devient alors littéralement celle d’habiter un autre, de parcourir ses espaces internes comme on déambule dans les couloirs d’un édifice. Cette inversion vertigineuse, où le corps devient architecture et l’architecture devient corps, révèle l’intuition géniale de Gormley : nous ne vivons pas simplement dans des bâtiments, nous sommes nous-mêmes des constructions spatiales. Ses “Blockworks” poussent cette logique jusqu’à ses conséquences les plus radicales, remplaçant la courbe organique par l’angle architectural, substituant à la sensualité de la chair l’austérité géométrique de la construction.
L’intelligence de cette démarche se révèle dans sa capacité à faire du spectateur un habitant temporaire de ces corps-bâtiments. Quand Gormley installe “Critical Mass II” dans différents contextes, de la station de tramway viennoise au musée Rodin parisien, il démontre comment l’architecture influence notre perception des corps qu’elle abrite. Ces soixante figures de fonte, articulées autour de douze positions fondamentales du corps humain, transforment chaque espace d’exposition en cité métaphysique où se négocient les rapports entre individu et collectif, entre solitude et communauté. L’architecture cesse d’être un simple contenant pour devenir un acteur de la dramaturgie sculpturale.
Cette poétique architecturale révèle également une dimension politique souvent négligée de l’oeuvre. En transformant le corps en bâtiment, Gormley interroge nos modes d’habitation contemporains et questionne l’urbanisation galopante qui définit notre époque. Ses installations comme “Time Horizon” à Houghton Hall révèlent comment nos corps s’inscrivent dans le paysage architectural, comment ils en épousent les rythmes et les contraintes. L’artiste ne se contente pas de placer des sculptures dans l’espace, il révèle l’espace comme sculpteur de nos identités. Cette approche trouve sa formulation théorique la plus aboutie dans ses collaborations avec les architectes, notamment lors de ses interventions dans des sites historiques où ses corps de métal dialoguent avec les pierres séculaires.
L’oeuvre récente “Body Buildings”, présentée à Pékin en cette fin d’année, pousse cette réflexion vers de nouveaux territoires conceptuels. Utilisant l’argile cuite et le fer, matériaux fondamentaux de la construction, Gormley explore ce qu’il appelle “penser et ressentir le corps dans cette condition”. L’exposition interroge notre relation à l’environnement bâti dans un monde de plus en plus vertical, questionnant notre humanité dans des mégalopoles qui semblent nous dépasser. Chaque figure devient alors un “pixel physique” selon les mots de l’artiste, unité élémentaire d’une humanité pixellisée par l’architecture contemporaine.
Cette vision architecturale du corps culmine dans des oeuvres comme “Alert” (2022), corps accroupi construit en porte-à-faux avec des dalles d’acier corten, qui matérialise la précarité de nos équilibres urbains. L’architecture n’est plus ici métaphore du corps, elle devient le langage même par lequel le corps exprime sa vulnérabilité dans l’environnement bâti contemporain. Gormley révèle ainsi que nous sommes tous des architectures précaires, des édifices corporels soumis aux mêmes lois de gravité et d’équilibre que nos constructions urbaines. Cette poétique de l’instabilité architecturale résonne avec une époque où nos villes semblent défier les lois de la physique autant que celles de l’habitabilité humaine.
L’espace littéraire du corps : Une écriture sculpturale du silence
L’oeuvre de Gormley entretient avec la littérature une relation qui va bien au-delà de la simple inspiration thématique : elle constitue une véritable écriture sculpturale qui emprunte à l’art des mots ses stratégies narratives les plus profondes. Cette dimension littéraire s’épanouit d’abord dans la conception même de ses installations comme des récits spatiaux où chaque figure devient un personnage muet d’une dramaturgie silencieuse. L’artiste développe ce qu’on pourrait appeler une grammaire corporelle qui s’apparente aux structures narratives de la littérature moderne, où le non-dit prime sur l’explicite, où le silence devient plus éloquent que la parole. Cette approche trouve ses racines dans sa formation en archéologie et anthropologie, disciplines qui l’ont familiarisé avec la lecture des traces humaines comme autant de fragments textuels à déchiffrer.
La série “Event Horizon”, déployée successivement à Londres, New York, São Paulo et Hong Kong, illustre parfaitement cette conception littéraire de l’espace sculptural. Ces trente et une figures perchées sur les toits constituent un véritable roman urbain où chaque silhouette raconte une histoire d’isolement et de connexion dans la métropole contemporaine. Comme les personnages de Virginia Woolf dans “Mrs Dalloway”, elles habitent simultanément leur solitude individuelle et participent d’un tissu narratif collectif qui englobe la ville entière. L’artiste transforme l’horizon urbain en page d’écriture où se déploie une poésie de la distance et de la proximité, du visible et de l’invisible.
Cette dimension littéraire se révèle également dans la façon dont Gormley conçoit le temps sculptural. Ses oeuvres ne représentent pas des instants figés mais des durées narratives qui s’étalent dans l’expérience du spectateur. L’installation “Another Place” sur la plage de Crosby fonctionne comme un roman fleuve où cent figures de fonte subissent les marées dans une temporalité cyclique qui évoque les grandes sagas littéraires. Chaque figure porte en elle l’histoire de ses métamorphoses, cirripèdes, lichens et érosion, constituant une archive vivante comparable aux strates temporelles que déploient les romans de Claude Simon ou de W.G. Sebald. L’artiste révèle ainsi que la sculpture peut porter une mémoire narrative aussi complexe que celle des oeuvres littéraires.
La conception de Gormley du silence sculptural emprunte directement aux stratégies narratives de la littérature moderne. Comme Samuel Beckett transforme les silences en matière dramatique dans ses pièces, Gormley fait du mutisme de ses figures une forme d’éloquence sculpturale inédite. Ses corps de métal ne parlent pas mais ils racontent, par leur simple présence spatiale, des histoires d’attente, d’endurance, de résistance face à l’érosion du temps. Cette poétique du silence trouve sa formulation la plus radicale dans des oeuvres comme “Still Standing”, où l’immobilité devient un acte narratif qui révèle la dimension épique de la simple persistance dans l’existence.
L’artiste développe également une conception topographique de la narration qui s’apparente aux innovations de la littérature contemporaine. Ses installations fonctionnent comme des cartes narratives où le spectateur devient explorateur d’un territoire sculptural chargé de récits potentiels. “Asian Field”, avec ses deux cent mille figurines d’argile, constitue ainsi une véritable bibliothèque spatiale où chaque forme minuscule porte sa part d’humanité, créant un récit collectif qui évoque les fresques romanesques de Roberto Bolaño ou de Don DeLillo. L’artiste révèle que l’espace peut être porteur de récits aussi denses et complexes que ceux de la littérature.
Cette dimension littéraire s’exprime enfin dans la façon dont Gormley conçoit la lecture de ses oeuvres. Comme un texte littéraire, chaque installation exige une temporalité de découverte qui transforme le spectateur en lecteur spatial. L’oeuvre “Resting Place”, avec ses deux cent quarante-quatre figures de terre cuite disposées au sol, invite à une déambulation qui s’apparente à la lecture d’un poème épique où chaque stance révèle de nouvelles harmoniques de sens. L’artiste transforme ainsi l’espace d’exposition en espace de lecture, révélant que la sculpture contemporaine peut développer des stratégies narratives aussi sophistiquées que celles de la littérature d’avant-garde. Cette conception littéraire de la sculpture révèle finalement que Gormley ne se contente pas de sculpter des formes, il écrit avec l’espace une poésie corporelle inédite qui renouvelle autant l’art sculptural que notre compréhension de ce que peut être un récit dans l’art contemporain.
La révélation de l’espace intérieur
Ce qui saisit chez Gormley, c’est sa capacité à matérialiser l’immatériel, à donner forme à cette expérience universelle de l’intériorité que nous portons tous. Ses oeuvres comme “Blind Light” (2007) ou “Cave” (2019) ne se contentent pas de représenter des espaces, elles créent des conditions expérientielles qui révèlent l’espace infini qui existe en nous. Cette approche transforme radicalement le rapport traditionnel entre sculpteur et spectateur. Ici, pas de contemplation distante : l’oeuvre exige l’immersion, elle réclame que nous y entrions physiquement pour en saisir le sens.
L’intelligence de Gormley réside dans sa compréhension intuitive que notre époque souffre d’une crise de l’espace intérieur. Submergés par les flux d’informations, écrasés par l’accélération du temps social, nous avons perdu le contact avec cette dimension contemplative que ses sculptures révèlent avec une urgence particulière. Quand il affirme “Je questionne la notion que la réponse rétinienne soit le seul canal de communication dans l’art”, il formule un programme esthétique révolutionnaire qui remet le corps au centre de l’expérience artistique.
Pourtant, cette oeuvre n’est pas sans poser de questions troublantes. L’utilisation systématique de son propre corps comme matrice sculpturale peut interroger : quelle universalité peut revendiquer un homme blanc, britannique, formé à Cambridge et issu de la bourgeoisie pharmaceutique ? Cette critique, régulièrement adressée à l’artiste, révèle les tensions de l’art contemporain face aux questions identitaires. Mais réduire l’oeuvre de Gormley à cette dimension biographique serait passer à côté de son intuition fondamentale : l’expérience de l’incarnation dépasse les catégories sociales et culturelles.
Les corps de Gormley ne sont jamais des portraits mais des archétypes, des formes vides prêtes à accueillir la projection de qui les rencontre. Cette qualité universalisante de son travail, loin d’être une faiblesse, constitue peut-être sa force principale dans un monde fragmenté par les particularismes identitaires. Ses sculptures offrent un territoire commun, un langage partagé de l’humanité incarnée qui résiste aux divisions contemporaines.
L’art public de Gormley révèle une ambition politique souvent sous-estimée. “L’Angel of the North”, avec ses vingt mètres de hauteur et ses cinquante-quatre mètres d’envergure, ne se contente pas de marquer le paysage : cette oeuvre transforme la relation des habitants du nord de l’Angleterre à leur territoire. Elle offre un nouveau récit collectif à une région marquée par la désindustrialisation, proposant une mythologie contemporaine qui réconcilie passé ouvrier et avenir post-industriel.
Cette dimension politique s’exprime également dans des oeuvres comme “One & Other” (2009), où Trafalgar Square devient pendant cent jours le théâtre d’une performance démocratique inédite. En invitant deux mille quatre cents volontaires à occuper tour à tour le quatrième socle de la place, Gormley transforme l’art public en expérience citoyenne. L’oeuvre révèle que la sculpture contemporaine peut renouveler les formes de participation démocratique, offrir de nouveaux espaces de représentation dans une société en quête de lieux d’expression collective.
La matérialité contemporaine
L’évolution des matériaux dans l’oeuvre de Gormley raconte l’histoire de nos mutations contemporaines. Du plomb des premières oeuvres à l’acier corten des dernières créations, en passant par la fonte et l’aluminium, chaque matériau porte sa charge symbolique et technique. Cette attention à la matérialité révèle un sculpteur profondément ancré dans son époque, conscient que les matériaux industriels contemporains expriment notre condition autant que les marbres exprimaient celle de l’Antiquité.
Ses dernières oeuvres, construites en terre cuite et organisées selon des logiques modulaires, révèlent une attention nouvelle aux questions écologiques et à la crise de l’habitat contemporain. “Resting Place” (2023) transforme la galerie en camp de réfugiés métaphorique où deux cent quarante-quatre figures cherchent leur place dans un monde en migration permanente. L’artiste révèle ainsi que la sculpture peut porter un diagnostic sociologique aussi précis que celui de la sociologie contemporaine.
L’oeuvre de Gormley constitue finalement un antidote nécessaire à l’accélération contemporaine. Dans un monde qui privilégie la vitesse sur la profondeur, la surface sur l’intériorité, la connexion sur la contemplation, ses sculptures imposent un autre tempo. Elles réclament du temps, exigent la lenteur, révèlent que l’art véritable ne peut naître que dans la durée et la patience. Cette temporalité sculpturale devient un acte de résistance face à l’urgence permanente de notre époque.
Face aux sculptures de Gormley, nous redécouvrons cette expérience fondamentale de l’art : la rencontre avec l’altérité. Ses figures de métal nous renvoient notre propre image tout en nous révélant notre étrangeté constitutive. Elles matérialisent cette intuition troublante que nous sommes des inconnus pour nous-mêmes, des architectures corporelles mystérieuses habitées par un espace infini que nous ne cessons d’explorer. En cela, Gormley ne nous propose pas seulement des sculptures, mais des instruments de connaissance de soi d’une efficacité rare dans l’art contemporain.
- Antony Gormley, cité dans de nombreux entretiens et catalogues d’exposition, notamment dans “BBC Forum Questions And Answers”, 2002.