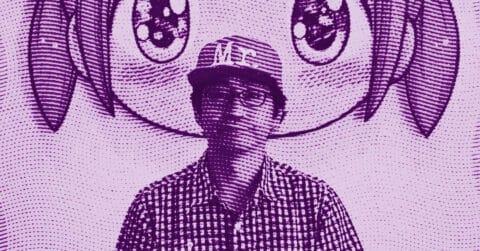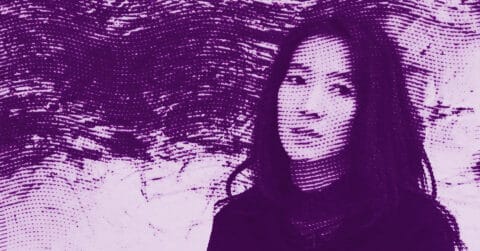Écoutez-moi bien, bande de snobs ! Mark Bradford (né en 1961 aux Etats-Unis) est l’un des rares artistes qui me donne encore espoir dans ce monde saturé d’ego et de vacuité conceptuelle. Pendant que certains s’extasient devant des carrés blancs en pensant faire preuve d’intelligence, Bradford, lui, creuse littéralement dans la chair de Los Angeles pour en extraire l’essence.
Je vais vous parler de deux aspects fondamentaux de son travail qui transcendent la simple notion d’esthétique pour atteindre quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Quelque chose qui ferait probablement s’évanouir les petits bourgeois qui confondent art moderne et art contemporain dans leurs salons dorés.
D’abord, sa technique d’excavation urbaine. Bradford ne peint pas, il arrache. Il ne compose pas, il décompose. Ses oeuvres monumentales, certaines atteignant plus de 3 mètres de hauteur, sont créées à partir de couches successives d’affiches publicitaires, de prospectus et de papiers trouvés dans les rues de South Central Los Angeles. Il les accumule, les colle, puis les arrache partiellement avec des outils électriques, créant ainsi une archéologie du présent. Cette approche fait écho à la pensée de Walter Benjamin sur les ruines de la modernité, où chaque strate révèle une histoire cachée de la ville.
Mais Bradford va plus loin que Benjamin. Il ne se contente pas d’observer les ruines, il les crée activement pour révéler ce qui se cache derrière la façade policée de la société américaine. Quand il utilise une ponceuse électrique pour attaquer la surface de ses oeuvres, c’est comme s’il effectuait une dissection urbaine, révélant les tissus cicatriciels d’une ville marquée par les émeutes, la pauvreté et la ségrégation. Ce n’est pas sans rappeler le concept de “société du spectacle” de Guy Debord, où la réalité sociale est médiatisée par des images. Bradford déconstruit littéralement ce spectacle, couche après couche.
Le deuxième aspect de son travail est sa cartographie sociale. Ses oeuvres, vues de loin, évoquent souvent des vues aériennes de zones urbaines, des cartes abstraites de territoires imaginaires. Mais approchez-vous, et vous découvrirez que ces “cartes” sont composées d’annonces de prêts sur gages, de publicités pour des tests ADN de paternité, d’offres de solutions de relogement… C’est un atlas de la précarité urbaine qu’il nous présente, une géographie de la survie quotidienne.
Cette approche cartographique n’est pas sans rappeler la “psychogéographie” des situationnistes, mais Bradford la réinvente complètement. Là où Guy Debord et ses camarades dérivaient dans Paris pour en révéler les zones d’attraction et de répulsion émotionnelles, Bradford cartographie les zones de tension sociale, les lignes de fracture économiques, les frontières invisibles qui segmentent nos villes.
Prenez son oeuvre “Scorched Earth” (2006), une cartographie abstraite du massacre racial de Tulsa en 1921. L’oeuvre ressemble à première vue à une vue satellite d’une zone urbaine dévastée. Mais en réalité, c’est une méditation profonde sur la violence systémique et la mémoire collective. Les couches de papier brûlé et arraché deviennent une métaphore puissante de l’histoire effacée, des vies détruites, des cicatrices qui ne guérissent jamais vraiment.
Et pendant que je vois certains collectionneurs s’extasier devant ses oeuvres en ne parlant que de leur “beauté formelle”, comme si la beauté était le seul critère pertinent dans l’art contemporain, Bradford continue son travail d’archéologue social. Il creuse, il gratte, il révèle. Chaque coup de ponceuse est un acte de résistance contre l’amnésie collective, chaque couche de papier arrachée est une strate de vérité mise à nu.
Ses oeuvres sont des témoignages urbains qui nous rappellent que l’histoire n’est jamais vraiment effacée, juste recouverte de nouvelles couches de mensonges et d’oubli. C’est ce que Derrida appelait la “trace”, cette présence-absence qui hante nos sociétés. Bradford rend ces traces visibles, tangibles, impossibles à ignorer.
Bradford transforme des matériaux ordinaires en documentaires extraordinaires. Ces publicités bon marché, ces affiches déchirées deviennent entre ses mains des documents historiques, des preuves matérielles de la lutte quotidienne pour la survie dans les quartiers défavorisés. Il y a quelque chose de profondément foucaldien dans cette approche, une archéologie du savoir appliquée à l’art contemporain.
Ses oeuvres monumentales, certaines atteignant les dimensions impressionnantes de 15 mètres de long, nous forcent à confronter la réalité sociale à une échelle qui défie toute tentative de minimisation ou d’évitement. C’est de l’art qui refuse d’être ignoré, qui exige d’être vu, qui force la confrontation.
Quand Bradford a représenté les États-Unis à la Biennale de Venise en 2017, certains critiques ont parlé de lui comme du “Pollock de notre époque”. Quelle idiotie ! Bradford n’est pas Pollock, il est Bradford. Il n’a pas besoin d’être comparé aux grands maîtres blancs pour être légitimé. Son travail se suffit à lui-même, dans sa puissance brute et sa pertinence sociale.
Son installation “Mithra” (2008) à la Nouvelle-Orléans, une arche monumentale de 21 mètres de long construite avec des panneaux de contreplaqué récupérés, était bien plus qu’une simple sculpture. C’était un monument aux survivants de l’ouragan Katrina, une accusation silencieuse contre l’abandon institutionnel, un rappel que l’art peut et doit être un témoin de son temps.
Ce qui me plaît chez Bradford, c’est qu’il crée des oeuvres qui fonctionnent à la fois comme des documents sociaux et comme des objets esthétiques autonomes. Il ne sacrifie jamais l’un à l’autre. La beauté formelle de ses compositions n’atténue pas leur mordant politique ; au contraire, elle le renforce, le rend plus percutant.
Son utilisation des end-papers, ces petits papiers utilisés pour les permanentes dans les salons de coiffure, comme matériau artistique n’est pas qu’une référence autobiographique à son passé de coiffeur. C’est une transformation alchimique du banal en extraordinaire, une élévation du quotidien au rang d’art qui aurait fait sourire Marcel Duchamp.
Bradford prouve que l’art contemporain peut encore avoir du sens, qu’il peut encore nous parler de notre monde, de nos luttes, de nos espoirs. Il n’a pas besoin de se réfugier dans l’hermétisme conceptuel ou dans la provocation facile pour être pertinent.
Alors oui, ses oeuvres se vendent pour des millions d’euros. Et alors ? L’ironie du marché de l’art qui transforme la critique sociale en marchandise de luxe n’enlève rien à la puissance de son travail. Au contraire, elle ne fait que renforcer la pertinence de sa critique.
Bradford est l’artiste dont nous avons besoin en ces temps de confusion et d’amnésie collective. Ses oeuvres sont des rappels constants que l’art peut encore être un outil de résistance, un moyen de préserver la mémoire, une façon de rendre visible l’invisible.
Et pendant que certains continueront à s’extasier sur Jonone dans leurs conversations de salon, Bradford continuera à creuser dans les entrailles de nos villes, à révéler leurs histoires cachées, à nous forcer à regarder ce que nous préférons ignorer. C’est ça, le véritable art contemporain. Tout le reste n’est que distraction esthétique pour bourgeois ennuyés.