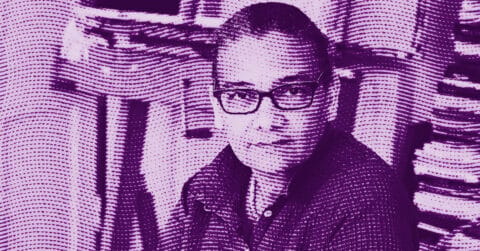Écoutez-moi bien, bande de snobs : pendant que vous vous extasiez devant des toiles monumentales et des installations tapageuses, Alison Knowles a passé six décennies à composer une oeuvre d’une radicalité si discrète qu’elle en devient presque invisible. Cette artiste américaine, figure fondatrice de Fluxus disparue le mois dernier, a érigé le quotidien en partition, le haricot en instrument de musique, et la salade en événement poétique. Son legs artistique ne se mesure pas en coups d’éclat mais en gestes répétés, en attentions portées, en présences partagées.
Née à New York en 1933, Alison Knowles suit d’abord les chemins balisés de la peinture expressionniste abstraite au Pratt Institute, sous la tutelle d’Adolph Gottlieb et Josef Albers. Mais très vite, la jeune artiste comprend ce qu’elle formulera plus tard avec une lucidité désarmante : “Ce que j’ai appris là-bas, c’est que je suis une artiste. Ce que j’aurais dû apprendre, c’est que je ne suis pas une peintre” [1]. Cette prise de conscience la conduit à détruire toutes ses toiles dans un feu de joie derrière la maison de son frère, geste inaugural qui préfigure son entrée dans l’univers du mouvement d’avant-garde Fluxus. L’année 1962 marque son baptême européen lors du premier festival Fluxus à Wiesbaden, en Allemagne, aux côtés de George Maciunas, Nam June Paik et Dick Higgins, qui deviendra son époux.
La partition comme poésie du geste
L’apport d’Alison Knowles à l’histoire de la poésie du XXe siècle demeure largement sous-estimé, probablement parce que sa pratique refuse les ornements du vers traditionnel pour épouser la forme de ce que Fluxus nomme les “partitions événementielles” (event scores). Ces textes, d’une brièveté saisissante, constituent des protocoles d’action plutôt que des oeuvres closes. Knowles elle-même les définit comme “une recette en une ou deux lignes pour une action” [2]. Cette définition, d’une simplicité apparente, masque une sophistication conceptuelle considérable.
Prenons Make a Salad, créé en 1962 à l’Institute of Contemporary Arts de Londres. La partition se résume à ces trois mots : “Faire une salade”. Pourtant, cette directive laconique génère des performances d’une richesse sensorielle et sociale inépuisable. L’artiste découpe des légumes au rythme d’une musique live, amplifie les sons du hachage par des microphones, mélange les ingrédients en les lançant en l’air, puis sert la salade au public. Au fil des décennies, cette pièce s’est métamorphosée : à la Tate Modern en 2008, Knowles prépare une salade pour 1900 personnes, utilisant des râteaux pour mélanger et des pelles pour servir. L’oeuvre croît, se transforme, mais conserve son essence : celle d’un acte domestique élevé au rang de rituel collectif.
La poétique de Knowles s’inscrit dans une lignée distincte de la poésie concrète européenne, tout en s’en démarquant par son attention au corps et au tactile. Là où la poésie concrète travaille la matérialité du langage sur la page, Knowles l’inscrit dans l’espace et le temps de la performance. Ses partitions ne sont pas des oeuvres à contempler mais des invitations à l’expérience vécue. The Identical Lunch, débuté en 1969, exemplifie cette démarche : l’artiste mange le même repas chaque jour, “un sandwich au thon sur pain de blé grillé avec de la laitue et du beurre, pas de mayonnaise, et un verre de babeurre ou une tasse de soupe”, et invite d’autres à partager ce rituel. Le geste répétitif devient méditation, le banal devient remarquable.
Cette approche trouve un prolongement inattendu dans The House of Dust, poème généré par ordinateur en 1967 en collaboration avec le compositeur James Tenney. Knowles établit quatre listes de mots décrivant les matériaux, les lieux, les sources lumineuses et les habitants d’une maison. Tenney traduit ces listes en langage FORTRAN, et un ordinateur IBM produit des milliers de quatrains par combinaisons aléatoires. Cette oeuvre pionnière de la poésie numérique révèle l’ambition de Knowles : explorer de nouveaux médias tout en maintenant une dimension profondément collaborative et humaine.
Les partitions de Knowles fonctionnent selon une économie de moyens qui rappelle la tradition haïku, sans pour autant s’y réduire. Elles partagent avec la forme japonaise une attention extrême au moment présent, une capacité à extraire le singulier du quotidien. Shoes of Your Choice, créé en 1963, demande simplement aux participants de décrire les chaussures qu’ils portent. Cette directive minimaliste ouvre un espace narratif où se déploient des histoires personnelles, des souvenirs, des affects. La chaussure devient métonymie de l’existence, support d’une parole qui se dévoile. En 2011, Knowles performe cette pièce à la Maison-Blanche devant le président Barack Obama et la Première Dame Michelle Obama, prouvant que la simplicité formelle n’exclut pas la reconnaissance institutionnelle.
La dimension sonore occupe une place centrale dans l’oeuvre poétique de Knowles. Les haricots, motif récurrent qu’elle affectionne pour leur caractère “abordable et disponible partout”, deviennent instruments de musique. Bean Garden, présenté en 1971, consiste en une large plateforme amplifiée couverte de haricots secs que les visiteurs foulent, produisant ainsi une musique aléatoire par leurs déplacements. Cette attention au son comme matériau poétique l’éloigne de ses contemporains du mouvement Fluxus pour qui la musique constituait souvent la cible privilégiée de leurs interventions iconoclastes. Knowles, elle, ne cherche pas à détruire la musique mais à en élargir les frontières, à faire entendre la musicalité latente des objets ordinaires.
L’architecture comme livre habitable
Si la poésie structure l’approche de Knowles du langage et du geste, l’architecture offre le cadre conceptuel de sa réflexion sur l’espace et le corps. Ses “livres-objets” renversent la hiérarchie traditionnelle entre contenant et contenu, entre support et texte. The Big Book, réalisé en 1967, mesure 2,4 mètres de haut et se compose de huit pages mobiles fixées à une colonne vertébrale métallique. Chaque page, équipée de roulettes, peut être tournée physiquement, créant différents espaces et parcours pour le lecteur. L’oeuvre contient une galerie, une bibliothèque, un tunnel d’herbe, une fenêtre, ainsi que des objets domestiques récupérés : toilettes, cuisinière, téléphone. Le livre devient architecture, l’architecture devient narration.
Cette pièce monumentale voyage à travers l’Europe, se détériorant progressivement avant de se désintégrer complètement à San Diego. La fragilité matérielle de l’oeuvre participe de son sens : The Big Book n’est pas conçu pour durer éternellement mais pour être vécu, manipulé, usé par les corps qui le traversent. Cette conception anti-monumentale de l’architecture artistique s’oppose frontalement à la tradition sculpturale moderniste et à sa recherche de permanence. Knowles préfère l’éphémère au pérenne, le processus au résultat.
The House of Dust prolonge cette réflexion en donnant forme architecturale au poème informatique homonyme. En 1970, Knowles construit une structure en fibre de verre sur le campus du California Institute of the Arts, basée sur le quatrain “une maison de poussière / en plein air / éclairée par la lumière naturelle / habitée par des amis et des ennemis”. Cette maison-sculpture accueille des cours, des projections de films, des pique-niques, des échanges de cadeaux. Elle fonctionne comme un espace social actif plutôt que comme une oeuvre contemplative. Une première version, installée près d’un immeuble HLM à Chelsea, avait été détruite par un incendie criminel en 1968, rappelant la vulnérabilité des propositions artistiques qui s’aventurent hors des espaces protégés des institutions culturelles.
L’approche architecturale de Knowles s’enracine dans une critique implicite de la séparation moderne entre art et vie. Ses livres habitables proposent une alternative à l’architecture fonctionnaliste : ils ne répondent à aucun programme précis, ne visent aucune efficacité mesurable. Ils créent des situations plutôt que des solutions. The Boat Book, variation récente de The Big Book dédiée à son frère pêcheur, incorpore des filets, des coquillages, une canne à pêche, une bouilloire, autant d’objets personnels chargés de mémoire. L’architecture devient ainsi dépositaire d’histoires individuelles, support de transmissions affectives.
Les “pages libres” (Loose Pages), série débutée en 1983 en collaboration avec la papetière Coco Gordon, radicalise cette exploration. Knowles crée des pages pour chaque partie du corps : la colonne vertébrale humaine remplace la reliure traditionnelle du livre. Dans d’autres sculptures de pages, le visiteur entre littéralement dans la page avec une partie de son corps. Mahogany Arm Rest (1989) et We Have no Bread (No Hai Pan) (1992) invitent les spectateurs à s’engager physiquement dans des formats de quatre à cinq mètres. Le corps devient outil de lecture, l’architecture devient texte somatique.
Cette conception tactile de l’espace architectural distingue Knowles de ses contemporains. Là où l’architecture conceptuelle des années 1960-1970 privilégie souvent la dimension visuelle et théorique, Knowles insiste sur l’expérience haptique. Elle déclare : “Je ne veux pas que les gens regardent passivement mon travail, mais qu’ils y participent activement en le touchant, en le mangeant, en suivant des instructions d’écoute, en fabriquant ou en prenant physiquement quelque chose” [3]. Cette insistance sur la participation active anticipe ce que les théoriciens nommeront plus tard l’esthétique relationnelle, sans jamais tomber dans le piège du spectaculaire ou du didactique.
Les livres-architectures de Knowles questionnent également notre rapport à la connaissance et à sa transmission. En rendant le livre praticable, elle suggère que la lecture n’est pas une activité passive de réception mais une exploration active, un parcours physique et mental. Cette métaphore spatiale de la lecture dialogue avec les théories contemporaines de la réception tout en les incarnant littéralement. Le lecteur n’est plus face au texte mais dedans, entouré par lui, traversé par lui.
Une éthique du partage
L’oeuvre d’Alison Knowles dessine les contours d’une pratique artistique fondée sur la générosité et l’attention. À rebours du mythe romantique de l’artiste solitaire, elle a constamment privilégié la collaboration : avec John Cage pour le livre Notations en 1969, avec Marcel Duchamp pour la sérigraphie Coeurs Volants en 1967, avec d’innombrables performeurs à travers les décennies. Ses filles jumelles, Jessica et Hannah Higgins, ont participé à ses performances dès leur enfance. Cette dimension collaborative ne dilue pas l’oeuvre mais la renforce, créant un réseau de relations et d’échanges qui en constituent la substance même.
L’usage récurrent du haricot dans son travail illustre cette éthique. Knowles choisit cet aliment non pour sa valeur symbolique abstraite mais pour ses qualités concrètes : disponible partout, abordable, source de subsistance universelle. Bean Rolls (1963), l’un de ses premiers livres-objets, consiste en une boîte de conserve remplie de haricots secs et de minuscules rouleaux de textes trouvés. En secouant la boîte, les haricots produisent un son de hochet. L’objet fonctionne simultanément comme livre, instrument de musique et sculpture. Cette convergence des médiums illustre le concept d'”intermedia” théorisé par Dick Higgins, son époux, mais Knowles l’incarne avec une grâce particulière.
La modestie apparente de ses moyens, salades, sandwiches, haricots ou papier fait main, ne doit pas masquer la radicalité de son propos. En choisissant des matériaux et des gestes ordinaires, Knowles ne recherche pas une esthétique de la pauvreté mais affirme une position politique : l’art n’appartient pas aux élites, ne requiert pas de matériaux précieux, ne doit pas intimider. Ses partitions peuvent être performées par n’importe qui, n’importe où. Cette démocratisation de la pratique artistique s’oppose aux systèmes de marchandisation qui dominent le monde de l’art contemporain.
Knowles a vécu et travaillé dans son loft de SoHo depuis 1972, transformant cet espace en laboratoire permanent où vie et art se confondent. Son galeriste James Fuentes note que “ses oeuvres les plus puissantes étaient ses oeuvres les plus éphémères” [4], soulignant ainsi le paradoxe d’une pratique qui résiste à l’archivage et à la conservation. Comment exposer une salade mangée, un sandwich consommé, des sons disparus ? Cette question hante les institutions qui tentent de patrimonialiser le mouvement Fluxus. La rétrospective présentée en 2022 au Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive, première exposition d’envergure consacrée à l’artiste, témoigne de cette difficulté : comment montrer une oeuvre dont l’essence réside dans l’acte même de sa performance ?
Alison Knowles s’est éteinte le 29 octobre 2025 dans son appartement new-yorkais, laissant une oeuvre qui continue de poser des questions essentielles sur la nature de l’art, ses fonctions, ses publics. Sa pratique, d’une cohérence remarquable sur six décennies, offre une alternative aux logiques de spectacularisation et de marchandisation. Elle nous rappelle que l’art peut surgir des gestes les plus simples, qu’une salade partagée ou un haricot secoué peuvent ouvrir des espaces de contemplation et de communion. Dans une époque saturée d’images et d’informations, son invitation à ralentir, à toucher, à écouter, à participer, résonne avec une acuité particulière. L’héritage de Knowles ne se mesure pas en oeuvres vendues ou en expositions prestigieuses, mais dans les innombrables artistes qu’elle a inspirés à chercher la poésie dans l’ordinaire, à composer avec le quotidien, à faire de chaque geste une partition possible. Sa discrétion même constitue son élégance suprême, son refus du spectacle sa plus grande audace. Écoutez bien le bruissement des haricots : c’est la musique d’un monde où l’art et la vie ne font qu’un, où le partage prime sur la possession, où la présence compte davantage que la permanence.
- Ruud Janssen, “Interview with Alison Knowles”, Fluxus Heidelberg Center, 2006
- Ellen Pearlman, “Interviews With Alison Knowles, July-October 2001, New York City”, Brooklyn Rail, janvier-février 2002
- Jori Finkel, “When Making a Salad Felt Radical”, The New York Times, 18 juillet 2022
- Alex Greenberger, “Her Ordinary Materials: Fluxus Artist Alison Knowles on Her Carnegie Museum Show”, ARTnews, 30 juin 2016