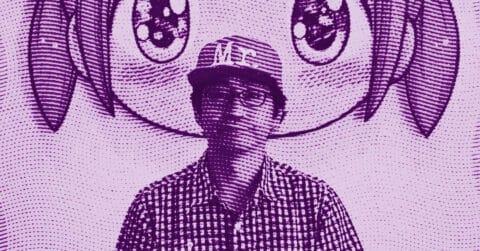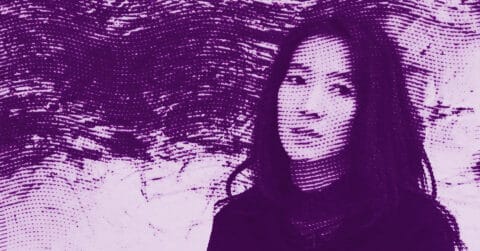Écoutez-moi bien, bande de snobs : Marlene Dumas ne peint pas des portraits, elle écorche l’âme humaine avec une précision chirurgicale qui devrait vous tenir éveillés la nuit. Née en 1953 au Cap, cette Sud-Africaine installée à Amsterdam depuis 1976 a construit une oeuvre qui refuse systématiquement de nous conforter dans nos certitudes esthétiques. Là où vous cherchez la beauté, elle vous sert la vérité, et la vérité, mes chers amis, n’est jamais jolie à regarder.
L’artiste travaille à partir d’images de seconde main, photographies de magazines, clichés pornographiques ou polaroids d’amis, qu’elle soumet à une métamorphose radicale. Ses coups de pinceau liquides, sa technique du mouillé sur mouillé, ses couleurs improbables créent des visages qui semblent se dissoudre sous nos yeux. Ces figures ne représentent pas des individus mais des états émotionnels, des tensions psychiques, des violences contenues. Voilà ce qui distingue Dumas de la cohorte des portraitistes contemporains : elle ne cherche pas à capter une ressemblance mais à révéler ce qui grouille sous la surface polie de l’humanité.
Sa relation à la poésie baudelairienne mérite qu’on s’y attarde longuement, car elle éclaire d’un jour particulièrement vif la démarche de l’artiste. En 2021, le Musée d’Orsay a célébré le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire en invitant Dumas à créer une série inspirée du Spleen de Paris [1]. Cette collaboration posthume entre deux esprits également épris de la beauté du terrible n’avait rien d’anecdotique. Baudelaire, ce poète qui voyait dans la modernité un mélange inextricable de splendeur et de misère, trouve en Dumas une héritière spirituelle qui partage son obsession pour l’ambivalence du beau.
Les quatorze tableaux nés de ce projet montrent Dumas au sommet de son art, naviguant entre portraits précisément exécutés du poète et de sa maîtresse Jeanne Duval, et représentations plus abstraites de motifs tirés des poèmes, le rat, la bouteille, le joujou du pauvre. Comme Baudelaire décrivait dans ses poèmes en prose les paradoxes d’une société prise entre progrès et décadence, Dumas peint les contradictions d’une humanité qui porte simultanément l’innocence et la cruauté. L’artiste elle-même a confié la difficulté de cette entreprise, cherchant à “peindre un portrait d’homme qui montre quelque chose de tout cela, dans son visage” face aux “émotions contradictoires et sauts poétiques” du texte baudelairien [2].
Cette parenté avec le poète des Fleurs du mal s’enracine dans une vision partagée de l’art comme révélateur de vérités dérangeantes. Là où Baudelaire dénonçait “la stupidité et la vanité des dames oisives et des soi-disant gentilshommes”, Dumas démonte les mécanismes de pouvoir qui se cachent derrière chaque représentation. Ses tableaux inspirés par Le Spleen de Paris ne sont pas de simples illustrations, ils constituent une réponse picturale aux questionnements du poète sur la condition humaine moderne. Le visage de Baudelaire qu’elle peint deux fois apparaît spectral, presque effacé, comme si le poète continuait depuis l’au-delà à porter son regard impitoyable sur nos âmes collectives.
La série créée pour le Musée d’Orsay explore particulièrement le thème de la solitude et du désespoir qui traverse l’oeuvre baudelairienne. Dans Le Désespoir de la vieille, Dumas représente une femme presque entièrement effacée par le pigment noir, recroquevillée dans un coin, image d’une détresse si absolue qu’elle en devient presque abstraite. Cette capacité à condenser l’émotion poétique en pure sensation visuelle rapproche Dumas de l’esthétique baudelairienne où le laid et le beau, le sublime et l’abject coexistent dans une tension productive. Le poète écrivait que l’art devait extraire la beauté du mal ; Dumas, elle, affirme qu'”il n’y a pas de beauté si elle ne montre pas une partie de l’horreur de la vie” [3].
Cette affinité avec Baudelaire révèle aussi l’importance de la littérature dans le processus créatif de Dumas. Son oeuvre se nourrit de lectures “passionnées et parcellaires” de poésie et de littérature. Elle ne cherche pas à illustrer des textes mais à établir avec eux un dialogue où peinture et mots s’enrichissent mutuellement. Ses toiles deviennent alors des espaces où résonnent les échos d’autres voix, d’autres époques, créant une polyphonie qui refuse la simple contemplation pour exiger l’engagement intellectuel et émotionnel du spectateur.
La dimension psychanalytique de son travail constitue le second pilier de sa démarche artistique, et ce n’est pas un hasard si Dumas a étudié la psychologie à l’université d’Amsterdam entre 1978 et 1980. Cette formation a profondément marqué sa manière d’aborder le portrait, qu’elle conçoit moins comme une représentation physique que comme une carte des territoires inconscients. Ses tableaux fonctionnent comme des séances analytiques où le refoulé remonte à la surface, où les masques sociaux se fissurent pour laisser entrevoir ce que nous préférerions garder caché.
Dumas s’intéresse particulièrement aux zones troubles de la psyché humaine : la sexualité dans ses manifestations les plus crues, la violence latente qui sommeille en chacun, la culpabilité héritée de structures sociales oppressives. Son enfance sous l’apartheid en Afrique du Sud a nourri une réflexion permanente sur les mécanismes psychologiques de la domination et de l’exclusion. Des oeuvres comme Evil is Banal (1984), où elle se représente avec un visage et une main noircis, interrogent sa propre complicité en tant que femme blanche dans un système raciste. Cette capacité à retourner le scalpel analytique contre elle-même témoigne d’une honnêteté intellectuelle rare.
La question de l’identité sexuelle et de la représentation du désir traverse également son oeuvre avec une intensité particulière. Dumas peint des nus qui n’ont rien de l’érotisme conventionnel, ce sont des corps exposés dans leur vulnérabilité, leur étrangeté et leur potentiel de menace. Elle travaille souvent à partir de matériel pornographique qu’elle détourne pour créer des images qui oscillent entre révélation et dissimulation, entre exhibition et pudeur. Cette ambivalence reflète les tensions inhérentes à la sexualité humaine, ce mélange de pulsion et de censure que Freud plaçait au coeur de l’inconscient.
Ses portraits d’enfants, notamment ceux de sa propre fille Helena, troublent par leur refus du sentimentalisme. Les bébés qu’elle peint apparaissent souvent verdâtres, presque monstrueux, comme dans Die Baba (1985) où l’enfant aux traits évoquant Hitler pose la question insupportable : à quel moment l’innocence bascule-t-elle dans la cruauté ? Ces images défient notre besoin de voir l’enfance comme un état de grâce, nous forçant à reconnaître que la violence et la destructivité sont aussi des composantes de la condition humaine dès le plus jeune âge.
Le rapport de Dumas aux images photographiques qu’elle utilise comme matériau premier révèle également une compréhension aigüe des mécanismes psychiques de la projection et de l’identification. Elle ne copie jamais servilement ses sources, elle les soumet à un processus de distanciation qui permet à l’inconscient de l’artiste d’infiltrer la représentation. Cette méthode fait écho aux théories sur l’écran du fantasme, cette surface où se projettent nos désirs et nos angoisses. Les visages qu’elle peint deviennent ainsi des miroirs déformants où nous reconnaissons quelque chose de nous-mêmes, même, et surtout, quand l’image nous répugne.
La série Models (1994) ou le portrait de Naomi Campbell (1995) interrogent les mécanismes de la construction identitaire à travers le regard de l’autre. En peignant ces icônes de beauté, Dumas ne célèbre pas leur glamour mais dévoile la violence symbolique qui les constitue comme objets du désir masculin. Ses coups de pinceau liquides font littéralement couler les visages, comme si l’identité elle-même n’était qu’une construction précaire, toujours menacée de dissolution. Cette instabilité fondamentale de l’image du moi résonne profondément avec les conceptions psychanalytiques du sujet comme foncièrement divisé, fragmenté, en perpétuelle reconstruction.
Ses portraits de figures politiques controversées, comme celui d’Oussama ben Laden (2010), poussent encore plus loin cette investigation des zones d’ombre de la psyché collective. En humanisant le terroriste, Dumas ne fait pas l’apologie de la violence mais nous confronte à une vérité dérangeante : le monstre nous ressemble. Cette capacité à refuser la facilité du manichéisme, à explorer l’humanité commune qui persiste même dans les figures les plus repoussantes, témoigne d’une profondeur analytique qui dépasse largement le simple exercice pictural.
La question du regard et de la reconnaissance, centrale dans les théories psychanalytiques sur la formation du sujet, traverse toute l’oeuvre de Dumas. Ses figures nous fixent souvent avec une intensité troublante, nous transformant en voyeurs complices. Ce jeu du voir et de l’être vu, cette dialectique du regard qui constitue le sujet tout en le menaçant, structure la relation que Dumas établit entre l’oeuvre et le spectateur. Nous ne pouvons pas contempler passivement ses tableaux, ils nous impliquent, nous accusent, nous forcent à reconnaître notre propre implication dans les structures de pouvoir et de désir qu’elle représente.
Le travail de Dumas sur la représentation des corps, qu’il s’agisse de nus, de portraits ou de scènes érotiques, refuse systématiquement l’idéalisation. Ses personnages portent les stigmates de leur histoire psychique : la détresse se lit dans la distorsion des traits, la violence dans l’empâtement de la matière picturale, le désir dans la fluidité des couleurs qui saignent au-delà des contours. Cette matérialité même de la peinture devient le véhicule d’une exploration de la matérialité du corps et de l’inconscient qui l’habite.
Sa technique du mouillé sur mouillé, où les couleurs se mêlent et se contaminent mutuellement, fonctionne comme une métaphore des processus psychiques eux-mêmes. Rien n’est fixe, tout circule, se transforme, échappe au contrôle. Cette liquidité de l’image reflète la fluidité de l’inconscient tel que le concevait la psychanalyse : un flux continu d’associations, de condensations, de déplacements qui défie toute tentative de fixation définitive.
L’influence qu’elle reconnaît d’artistes comme Edvard Munch ou Francis Bacon n’est pas fortuite. Ces peintres partageaient avec elle une obsession pour les manifestations visuelles de la détresse psychique, pour ces moments où l’intériorité déborde sur l’apparence et déforme le visible. Mais là où Bacon enfermait ses figures dans des cages architecturales et Munch les plongeait dans des paysages expressionnistes, Dumas préfère les isoler sur des fonds neutres, concentrant toute l’intensité émotionnelle dans le traitement du visage et du corps eux-mêmes.
Ce qui frappe dans l’ensemble de son oeuvre, c’est le refus absolu de la consolation. Dumas ne nous offre aucun réconfort, aucune échappatoire face aux vérités qu’elle met au jour. Ses tableaux fonctionnent comme des symptômes au sens psychanalytique du terme : ils révèlent ce qui doit rester caché, ils font retour du refoulé sous une forme déguisée mais reconnaissable. Cette dimension symptomale de son art explique peut-être le malaise qu’il suscite souvent, nous sommes confrontés à des aspects de nous-mêmes et de notre société que nous préférerions ignorer.
Alors que nous arrivons au terme de cette réflexion, il apparaît que l’oeuvre de Marlene Dumas défie toute tentative de classification commode. Elle n’est ni simplement portraitiste, ni expressionniste, ni néo-romantique, elle est tout cela à la fois et rien de cela entièrement. Son art fonctionne comme un miroir brisé qui nous renvoie des fragments de vérité impossibles à recomposer en un tout harmonieux. Cette fragmentation même constitue peut-être son apport le plus précieux : dans une époque saturée d’images lissées et de représentations formatées, Dumas nous rappelle que l’humain est fondamentalement irreproductible, irréductible et insaisissable.
Sa capacité à unir dans une même démarche l’héritage de la grande poésie européenne et les intuitions de la pensée psychanalytique sur les profondeurs de la psyché humaine fait d’elle bien plus qu’une simple artiste contemporaine. Elle se pose en archéologue de l’âme, en cartographe des territoires intérieurs que nous n’osons pas explorer. Ses toiles ne décorent pas les murs, elles les percent, créant des ouvertures vertigineuses sur des abîmes que nous préférerions ne pas contempler.
L’honneur que lui a fait le Musée d’Orsay en 2021, en faisant d’elle la première artiste vivante à exposer dans la galerie des impressionnistes, reconnaît implicitement cette stature exceptionnelle. Mais au-delà des consécrations institutionnelles, c’est dans l’inconfort que ses oeuvres provoquent que réside leur véritable valeur. Car l’art qui nous plaît simplement n’est qu’un divertissement ; celui qui nous dérange profondément est le seul qui mérite qu’on s’y attarde. Marlene Dumas ne crée pas pour plaire, elle crée pour réveiller, pour déranger, pour forcer à penser et à ressentir ce que nous voudrions éviter.
Dans cette époque où l’image prolifère jusqu’à l’insignifiance, où tout se consomme et s’oublie à la vitesse de la connexion internet, le travail de Dumas nous rappelle que certaines images résistent, insistent, reviennent nous hanter. Ses portraits sont de ceux qu’on ne peut pas oublier, précisément parce qu’ils ne nous laissent pas tranquilles. Ils continuent de travailler en nous longtemps après qu’on les a quittés, comme des échardes plantées dans la conscience, comme des questions sans réponse qui nous poursuivent dans le sommeil.
C’est là, finalement, le signe distinctif du grand art : non pas qu’il nous émerveille sur le moment, cela, n’importe quel spectacle bien ficelé peut l’accomplir, mais qu’il continue d’opérer en nous, qu’il modifie notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Marlene Dumas peint des visages, certes, mais ce faisant, elle refaçonne les nôtres. Elle nous force à nous voir comme nous ne voulions pas nous voir, et c’est précisément pour cela que son oeuvre restera quand tant d’autres auront sombré dans l’oubli. La beauté, disait-elle, n’existe pas sans montrer l’horreur de la vie. Et nous, spectateurs malgré nous de notre propre déliquescence, nous ne pouvons qu’acquiescer face à ses tableaux qui nous tendent ce miroir impitoyable : oui, c’est bien nous, dans toute notre splendeur misérable, que vous avez peints.
- Exposition “Marlene Dumas : Le Spleen de Paris”, Musée d’Orsay, Paris, 12 octobre 2021 – 30 janvier 2022, projet conçu en collaboration avec Donatien Grau
- Entretien avec Marlene Dumas, Artnet News, novembre 2021
- Marlene Dumas, Sweet Nothings: Notes and Texts, 1982-2014, D.A.P., 2014