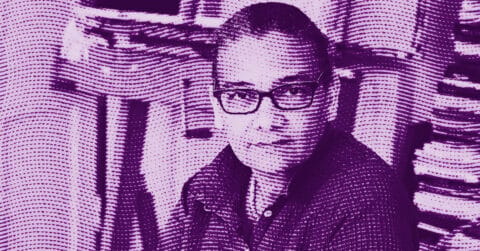Écoutez-moi bien, bande de snobs : il existe dans l’art contemporain une jeune artiste libyenne qui refuse les certitudes faciles, préférant tisser son langage dans les interstices où se rencontrent le textile et l’architecture, la mémoire et le déplacement. Nour Jaouda, née en 1997, travaille entre Londres et Le Caire, créant des tapisseries et des installations qui interrogent les notions de lieu, d’identité et de spiritualité avec une acuité rare. Son oeuvre, présentée à la 60ème Biennale de Venise en 2024 et actuellement exposée à Spike Island (Bristol) jusqu’en janvier 2026, pose des questions essentielles sur ce que signifie habiter le monde contemporain dans un état de mobilité perpétuelle.
La poésie comme cartographie de l’exil
L’oeuvre de Jaouda trouve l’un de ses ancrages les plus profonds dans la poésie palestinienne de Mahmoud Darwish. Les trois tapisseries présentées à Venise s’inspirent directement de la personnification des oliviers chez Darwish, ces arbres qui incarnent à la fois l’enracinement et la dépossession. Darwish écrivait depuis une position d’exil, cherchant dans le langage poétique une patrie portable. Jaouda fait de même avec le textile, créant ce qu’elle nomme “un paysage de mémoire qui existe dans un espace liminal”. La référence aux figuiers de sa grand-mère à Benghazi, matérialisée dans Where the fig tree cannot be fenced (2023), prolonge cette méditation sur l’arbre comme métaphore de l’appartenance impossible. Les formes végétales sont déconstruites jusqu’à devenir presque méconnaissables, condensées dans un paysage de verts superposés où les lacunes fonctionnent comme des silences poétiques.
Ce qui est remarquable, c’est la manière dont Jaouda traduit la syntaxe poétique en vocabulaire textile. Chaque découpe, chaque assemblage, chaque teinture fonctionne comme une métaphore matérialisée. Les théoriciens postcoloniaux Edward Said et Stuart Hall, que Jaouda cite comme influences intellectuelles, ont analysé comment l’identité culturelle se forme de manière fluide plutôt que fixe. Jaouda adopte cette perspective théorique mais la transpose dans le domaine du sensible, créant des oeuvres qui incarnent littéralement ce processus de devenir. Ses textiles ne représentent pas l’identité, ils la performent.
L’écrivaine libanaise Etel Adnan, dont Jaouda reprend une citation, “les lieux géographiques deviennent des concepts spirituels” [1], offre un autre point d’ancrage. Adnan, qui a elle aussi vécu entre plusieurs langues et plusieurs géographies, comprenait que le déplacement n’est pas seulement physique mais ontologique. Les lieux deviennent des concepts, les cartes deviennent des méditations. Dust that never settles (2024), avec ses bleus océaniques et ses verts qui se fondent, matérialise cette idée d’une géographie qui refuse de se fixer. La lenteur du processus de création, teinture végétale qui prend vingt-quatre heures pour s’imprégner dans le tissu, puis vingt-quatre heures supplémentaires pour sécher, impose une temporalité méditative proche de celle de l’écriture poétique. Chaque pli du tissu transporté dans les valises devient partie intégrante de l’oeuvre, inscription matérielle du voyage, archive tactile du déplacement.
L’architecture comme seuil du sacré
Si la poésie fournit le cadre conceptuel, c’est l’architecture qui structure formellement le travail de Jaouda. Son intérêt pour l’architecte égyptien AbdelWahed El-Wakil, connu pour son utilisation de l’architecture vernaculaire et de la géométrie divine, n’est pas fortuit. El-Wakil défendait l’idée que les bâtiments n’ont pas besoin d’être permanents. Cette vision trouve un écho direct dans la pratique de Jaouda, pour qui les textiles peuvent être roulés, transportés, réinstallés dans de nouveaux contextes.
L’installation Before the Last Sky (2025), présentée à la Biennale d’art islamique, est un exemple de cette approche. L’oeuvre comprend trois larges tapisseries suspendues depuis le plafond et s’écoulant jusqu’au sol, représentant les postures de la prière islamique, sujud, ruqu’ et julus. Ces textiles sont suspendus à des portails métalliques déconstruits, créant une inversion de perspective : les portes descendent du ciel plutôt que de s’élever du sol. L’installation utilise les motifs des créneaux islamiques, ces formes architecturales ornementales qui couronnent les mosquées. Les créneaux intéressent Jaouda parce qu’ils constituent un espace liminal, alternant pleins et vides, terre et ciel, matériel et spirituel. Elle se concentre sur les espaces négatifs entre les créneaux, créant du sens à partir de ce qui est absent. Cette approche révèle une compréhension sophistiquée de l’esthétique islamique, qui évite la représentation figurative pour exprimer le divin à travers la répétition géométrique.
Le tapis de prière, forme récurrente dans l’oeuvre de Jaouda, constitue son paradigme architectural par excellence. Ce morceau de textile ordinaire devient un espace sacré à travers l’acte de la prière. Il crée un “troisième espace” temporaire, un seuil qui peut être déployé n’importe où. Cette portabilité du sacré résonne profondément avec l’expérience de la mobilité qui caractérise la vie de l’artiste. Les structures en acier qu’elle incorpore, portails et arches récupérées dans les marchés du Caire, fonctionnent comme des squelettes architecturaux. Elles créent une structure sans interrompre l’espace, invitant le spectateur à circuler autour, à travers. Pour The Shadow of every tree à Art Basel 2024, Jaouda a construit un large portail en acier qui s’étendait sur toute la largeur de l’espace, obligeant les visiteurs à franchir ce seuil. Le portail refusait l’accès direct tout en invitant à l’exploration.
Cette attention aux structures qui organisent l’espace sans le cloisonner rappelle les moucharabiehs, ces écrans de bois ajourés qui permettent de voir sans être vu. Les textiles de Jaouda fonctionnent de manière similaire : ils créent des espaces mais restent perméables. L’installation The iris grows on both sides of the fence (2025) à Spike Island, conçue comme une tente en collaboration avec les artisans de Chariah-el-Khayamia au Caire, crée un lieu de deuil collectif pour les paysages déracinés. Le choix de l’iris de Faqqua, fleur nationale de Palestine, pour orner cette tente n’est pas innocent. Cette fleur, symbole de résistance et d’espoir, pousse des deux côtés de la barrière. L’architecture textile de Jaouda refuse les divisions binaires : elle crée des espaces où coexistent multiples histoires, multiples géographies. Ses oeuvres ne sont ni peintures ni sculptures, elles habitent l’entre-deux, refusant les classifications rigides.
Le processus comme philosophie
Le processus créatif de Jaouda incarne philosophiquement sa vision. Elle commence par esquisser les formes géométriques et organiques qu’elle rencontre : treillis de mosquées cairotes, motifs floraux, éléments architecturaux victoriens. Ces formes plates sont transformées en objets qu’elle découpe, moule, déchire, reconstruit et coud. Le vocabulaire qu’elle utilise est révélateur : “déconstruction”, “destruction”, “décollage”. Cette approche paradoxale, construire par la déconstruction, trouve sa justification chez les penseurs postcoloniaux qu’elle mentionne. Hall et Said ont démontré que les identités culturelles se forment de manière fluide à travers le mouvement.
La teinture végétale, processus lent et imprévisible, confère aux pigments une agentivité propre. Les couleurs s’infiltrent dans les fibres, transforment la matérialité du tissu. Au Caire, ses oeuvres se parent de jaunes chauds, de bleus profonds. À Londres, les couleurs refroidissent, verts sourds, bruns, violets. La couleur devient une langue qui dépasse le langage verbal. Cette pratique nomade inscrit physiquement le déplacement dans l’oeuvre. Jaouda affirme que cette “existence sans racines” [2] constitue le coeur de sa recherche. Les oeuvres possèdent cette qualité rare d’être simultanément complètes et inachevées. Cette indétermination reflète la conviction de l’artiste que l’identité culturelle est “un processus constant de devenir” [3]. Les textiles n’ont ni début ni fin, ils participent d’une continuité qui dépasse l’objet individuel.
Habiter l’entre-deux
Arrivés au terme de cette exploration, que retenir ? Le travail de Jaouda résiste aux simplifications, refuse les appartenances nettes, cultive l’ambiguïté productive. La cohérence entre sa démarche conceptuelle et sa mise en oeuvre matérielle frappe : la mobilité n’est pas un thème qu’elle illustre, c’est la condition même de sa pratique. Les textiles qui se plient, se transportent, se réinstallent incarnent littéralement l’idée d’une identité portable. Le tapis de prière qui crée un espace sacré partout où il se dépose devient métaphore de cette possibilité de porter avec soi son lieu, son histoire.
Dans un monde où les flux migratoires s’intensifient, où des millions de personnes vivent entre plusieurs pays, plusieurs langues, plusieurs cultures, l’oeuvre de Jaouda offre un modèle pour penser cette condition non comme un déficit mais comme une richesse, comme la capacité à habiter plusieurs mondes simultanément. La dimension spirituelle mérite qu’on y insiste. Dans un milieu de l’art contemporain souvent allergique aux questions religieuses, Jaouda assume pleinement cette dimension sans tomber dans l’illustration pieuse. Son intérêt pour la prière islamique, pour les espaces sacrés, ne relève pas d’une démarche identitaire défensive mais d’une interrogation sincère sur ce qui constitue un lieu sacré.
La qualité poétique de ses oeuvres, cette capacité à condenser des réalités complexes dans des formes évocatrices plutôt que descriptives, les distingue d’un certain art conceptuel qui privilégie le discours sur l’expérience sensible. Les textiles de Jaouda fonctionnent à plusieurs niveaux : ils peuvent être appréciés pour leur beauté formelle, leurs couleurs somptueuses ; mais ils s’offrent également à des lectures plus profondes pour qui accepte de ralentir. Cette polysémie est une force. Il serait tentant de voir dans cette oeuvre une simple réaction à la crise géopolitique contemporaine. Ce serait la réduire. Certes, la présence de l’iris palestinien, le titre Before the Last Sky qui fait référence à Said, la référence aux figuiers de Benghazi ancrent l’oeuvre dans l’actualité tragique. Mais Jaouda refuse l’art comme illustration directe du politique. Elle opère à un niveau plus subtil, créant des espaces où peuvent coexister la beauté et le deuil.
Ce qui rend son travail nécessaire, c’est cette capacité à maintenir la complexité, à résister aux simplifications binaires. À une époque où les discours se nourrissent de divisions tranchées, nous contre eux, ici contre là-bas, Jaouda propose des formes qui habitent délibérément l’espace intermédiaire. Ses textiles ne sont ni orientaux ni occidentaux, ni traditionnels ni contemporains. Ils existent dans cet espace du “ni ni” qui est aussi un “et et”, affirmant la possibilité d’appartenances multiples. L’oeuvre de Jaouda nous rappelle que l’art n’a pas pour vocation de fournir des réponses définitives mais de maintenir ouvertes les questions essentielles. Que signifie appartenir à un lieu quand on vit entre plusieurs mondes ? Comment porter avec soi sa culture sans la figer en folklore ? Comment créer du sacré ? Comment construire par la déconstruction ?
Ces interrogations traversent ses textiles sans jamais se résoudre en certitudes confortables. C’est précisément cette tension productive, cet équilibre précaire entre enracinement et déracinement, présence et absence, matériel et spirituel qui fait la force de son travail. Dans un siècle qui s’annonce dominé par les migrations, où la question de ce que signifie avoir ou ne pas avoir de lieu se posera avec une acuité croissante, l’oeuvre de Jaouda offre bien plus qu’une réflexion esthétique. Elle propose un mode d’existence, une manière d’habiter le monde qui réconcilie la mobilité avec le besoin d’appartenance. Ses textiles ne sont pas des objets à contempler passivement mais des propositions existentielles, des invitations à repenser notre rapport au lieu, à l’identité, au sacré. Voilà pourquoi Nour Jaouda compte parmi les voix artistiques les plus importantes de sa génération.
- Etel Adnan, Journey to Mount Tamalpais, The Post-Apollo Press, 1986
- Sofia Hallström, “Artist Nour Jaouda’s landscapes of memory”, Art Basel, mars 2024
- Lu Rose Cunningham, “In Conversation with Nour Jaouda”, L’Essenziale Studio Vol.08, avril 2025