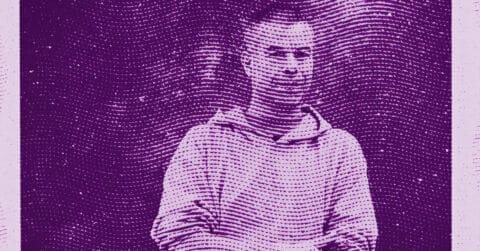Écoutez-moi bien, bande de snobs : si vous pensez encore que la peinture figurative est une affaire classée, un vestige poussiéreux du siècle dernier, alors vous n’avez manifestement pas posé les yeux sur le travail de Danielle Mckinney. Cette artiste née en 1981 à Montgomery, Alabama, formée à la photographie avant de se réapproprier la peinture pendant les confinements de 2020, ne produit pas de simples portraits. Elle construit des sanctuaires, des chambres closes où le temps se suspend, où les femmes noires qu’elle représente s’octroient enfin ce luxe scandaleux : ne rien faire du tout.
Car c’est précisément là que réside le génie discret de Mckinney. Dans un monde saturé d’images qui hurlent, qui revendiquent, qui performent l’identité jusqu’à l’épuisement, elle choisit le murmure. Ses toiles de petit format, souvent guère plus grandes qu’une feuille de papier, dégagent une puissance inversement proportionnelle à leur dimension. Elles ne crient pas leur présence ; elles l’imposent par la densité de leur silence. Les femmes qu’elle peint fument, dorment, lisent, rêvassent, occupent des espaces domestiques baignés d’ombres épaisses d’où émergent des touches de couleur saturée : un ongle rouge sang, un coussin ocre, une lumière verte qui filtre à travers des stores. Ces détails ne sont jamais gratuits. Ils constituent les coordonnées émotionnelles d’une cartographie intime que l’artiste dresse avec une précision de chirurgienne.
Mckinney travaille à partir d’un fond noir, renversant ainsi la convention académique de la toile blanche. Ce choix technique n’est pas qu’esthétique : il est philosophique. Le noir devient la matrice d’où surgissent les figures, comme des apparitions photographiques dans une chambre noire. L’artiste, qui a obtenu sa maîtrise en photographie à la Parsons School of Design en 2013, ne peut défaire cette formation initiale. Elle peint avec l’oeil du photographe, construisant ses compositions à partir de collages d’images glanées dans des magazines vintage des années 1930 aux années 1970, sur Pinterest ou dans des photographies anciennes. Cette méthode de travail rappelle les boîtes à chaussures qu’elle confectionnait enfant, y installant des figurines féminines dans des décors minutieusement peints. L’artiste n’a jamais quitté ce territoire ludique et protecteur de la construction de mondes miniatures. Elle y demeure, transformant chaque toile en diorama psychologique où se jouent des drames intérieurs d’une subtilité remarquable.
Sociologiquement, l’oeuvre de Mckinney s’inscrit dans un moment historique précis et nécessaire. Lorsqu’elle affirme : “Je n’ai jamais vu une femme noire à la peau noire dans un magazine” [1], elle pointe du doigt une absence structurelle dans la représentation visuelle occidentale. Cette absence n’est pas anodine ; elle constitue une violence symbolique que Pierre Bourdieu aurait qualifiée de domination douce, celle qui s’exerce par l’invisibilisation plutôt que par la contrainte explicite. Les femmes noires, quand elles apparaissent dans l’iconographie dominante, sont souvent cantonnées à des rôles codifiés : la servante dans l’Olympia de Manet, reléguée aux marges du cadre et de l’attention critique, ou bien l’héroïne sacrificielle porteuse de tous les fardeaux collectifs. Mckinney refuse ces deux écueils avec une élégance désarmante. Ses figures ne sont ni subordonnées ni héroïques. Elles sont, tout simplement. Elles s’octroient le privilège bourgeois de l’ennui, du repos, de la contemplation oisive, territoires historiquement réservés aux corps blancs dans l’histoire de l’art occidental.
La sociologue Tina Campt, dans son ouvrage fondamental “Listening to Images”, développe le concept d’images silencieuses, qu’elle définit comme “ni silencieuses ni inaudibles”, mais vibrant “juste en dessous du seuil de l’audition” [2]. Cette notion s’applique avec une justesse troublante aux peintures de Mckinney. Elles ne parlent pas, mais ne sont pas muettes. Elles produisent une résonance haptique, une qualité tactile qui convoque le sens du toucher autant que celui de la vue. On ressent la texture crémeuse de la peinture à l’huile, l’épaisseur des coups de pinceau, la chaleur moite des chambres représentées. Cette dimension sensorielle transforme l’acte de regarder en acte d’immersion. Le spectateur n’observe pas ces femmes ; il partage leur atmosphère. Cette intimité forcée peut générer un malaise productif. Elle interroge les limites du voyeurisme, la légitimité du regard, la responsabilité de celui qui regarde. Mckinney maîtrise parfaitement cette tension. Ses figures détournent souvent le regard, refusant le contact visuel direct qui établirait une relation de pouvoir trop explicite. Elles nous accordent le privilège d’entrer dans leur espace, mais pas celui de les posséder du regard.
Le contexte d’émergence de Mckinney mérite également qu’on s’y attarde. En 2020, après le meurtre de George Floyd et l’amplification du mouvement Black Lives Matter, le monde de l’art a connu ce qu’on pourrait pudiquement appeler un “moment de conscience”. Les galeries et institutions, soudainement soucieuses de leur bilan moral, se sont précipitées pour exposer des artistes noirs. Cette frénésie du rattrapage a produit des effets ambivalents. Mckinney elle-même a posé la question frontalement à sa galeriste Marianne Boesky : “Me représentez-vous parce que vous aimez mon art, ou parce que vous avez besoin d’une artiste noire ?” Cette lucidité critique l’honore. Elle refuse d’être instrumentalisée, même au profit de sa propre carrière. Elle exige que son travail soit regardé pour ce qu’il est, non pour ce qu’il permet de signaler vertueusement. Cette exigence est politique au sens le plus noble du terme. Elle réclame le droit à la complexité, à l’ambiguïté, à l’exploration formelle sans avoir à justifier en permanence sa légitimité par le prisme racial. Ses peintures ne sont pas des manifestes. Elles sont des propositions sensibles, des invitations à la rêverie, des moments de grâce capturés dans la pénombre.
Sur le plan strictement pictural, Mckinney s’inscrit dans une généalogie qu’elle revendique sans complexe. Henri Matisse demeure pour elle la référence cardinale, celui qui lui a permis de comprendre qu’il ne faut pas “peindre ce que l’on voit, mais ce que l’on ressent” [3]. Cette maxime de Matisse irrigue toute sa pratique. Les couleurs chez Mckinney ne sont jamais naturalistes. Elles sont émotionnelles. Un vert émeraude envahit une salle de bain comme une présence liquide et inquiétante. Un orange brûlé drape un corps féminin avec une sensualité palpable. Ces choix chromatiques construisent des ambiances qui dépassent la simple description d’un lieu. Elles génèrent des états psychologiques, des climats affectifs où le spectateur peut se perdre. L’influence de Matisse se manifeste également dans la liberté du geste, dans cette façon de laisser le pinceau tracer sa propre voie, de ne pas tout contrôler, d’accueillir l’accident heureux. Mckinney raconte qu’elle a dû apprendre à lâcher prise, à accepter l’imperfection d’un oiseau mal proportionné dans une composition par ailleurs réussie. Cette acceptation de la faille est une leçon d’humilité que peu d’artistes contemporains s’autorisent.
L’autre référence majeure dans le panthéon personnel de Mckinney est Edward Hopper, maître américain de la solitude urbaine et des lumières de cinéma. Comme lui, elle capture des instants suspendus où le temps semble arrêté. Comme lui, elle maîtrise l’art de la fenêtre qui laisse filtrer une lumière oblique, créant des jeux d’ombre et de clarté qui découpent l’espace en zones d’intimité et de révélation. Mais là où Hopper cultivait une froideur quasi clinique, une distance émotionnelle qui rendait ses figures inaccessibles, Mckinney injecte de la chaleur. Ses intérieurs sont accueillants malgré leur obscurité. Ils invitent à s’y blottir, à y trouver refuge. Cette différence tient peut-être au genre. Les femmes de Hopper semblent prisonnières de leur solitude ; celles de Mckinney l’habitent comme un choix, comme un territoire reconquis. Cette nuance est capitale. Elle transforme la mélancolie en émancipation discrète, le retrait du monde en stratégie de préservation de soi.
Johannes Vermeer, maître hollandais du XVIIe siècle, hante également ces toiles. Mckinney reprend à son compte le dispositif du seuil, cette façon de cadrer une scène comme si on venait de pousser une porte entrebâillée. Dans plusieurs de ses compositions, le spectateur découvre l’intérieur par fragments, à travers un encadrement de porte ou une ouverture qui découpe le champ visuel. Cette stratégie produit un effet de surprise et de discrétion. On a l’impression de surprendre un moment qui ne nous était pas destiné, ce qui accentue le sentiment d’intimité volée. Vermeer peignait des servantes et des bourgeoises hollandaises vaquant à leurs occupations domestiques dans une lumière laiteuse du Nord. Mckinney transpose ce vocabulaire visuel dans un contexte afro-américain contemporain, prouvant que ces compositions classiques peuvent accueillir des corps historiquement exclus du canon occidental sans perdre leur force plastique. Au contraire, cette réappropriation les revitalise, les charge de significations nouvelles et les sauve de la fossilisation muséale.
La dimension spirituelle du travail de Mckinney, bien que discrète, traverse néanmoins son oeuvre. Élevée dans une famille baptiste du Sud profond, elle parsème ses intérieurs de symboles religieux : des crucifix, des images de la Vierge Marie, des icônes chrétiennes qui flottent dans les arrière-plans flous. Mais ces références sont traitées avec ambivalence. Elles apparaissent souvent floues, comme des présences incertaines, des vestiges d’une foi questionnée. Mckinney raconte avoir grandi en voyant des représentations de Jésus blanc chez sa grand-mère, situation absurde pour une enfant noire. Cette incongruité nourrit une réflexion sur la construction des images sacrées, sur leur violence symbolique, sur la façon dont elles imposent des normes esthétiques qui excluent. En incluant ces symboles tout en les rendant flous, Mckinney ne les rejette pas complètement. Elle les maintient dans l’espace pictural comme des questions ouvertes, comme des irritants productifs qui empêchent toute lecture univoque.
Ce qui frappe chez Mckinney, c’est également sa capacité à créer des oeuvres universellement résonnantes sans diluer leur spécificité. Ses peintures parlent de l’expérience particulière des femmes noires tout en touchant des cordes émotionnelles communes à l’humanité entière. Cette dialectique du particulier et de l’universel est difficile à tenir. Trop de particularisme enferme l’oeuvre dans une niche identitaire ; trop d’universalisme abstrait efface les aspérités qui font la richesse du vécu singulier. Mckinney trouve un équilibre rare. Elle peint des femmes noires, mais elle peint surtout la fatigue, la rêverie, le désir, l’ennui, le repli sur soi. Ces affects traversent les frontières raciales et genrées. C’est pourquoi ses tableaux attirent des publics divers. Des femmes blanches y voient des miroirs de leur propre épuisement. Des hommes y reconnaissent une vulnérabilité qu’ils s’interdisent d’exprimer. Cette polysémie n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’une intelligence compositionnelle qui sait doser les marqueurs identitaires et les laisser ouverts à l’identification empathique.
La trajectoire fulgurante de Mckinney pose également des questions inconfortables sur les mécanismes du marché de l’art contemporain. En quelques années, elle est passée de l’anonymat à la reconnaissance institutionnelle. Ses oeuvres figurent désormais dans les collections du Metropolitan Museum of Art, du Hirshhorn Museum et du Dallas Museum of Art, entre autres. Cette ascension rapide peut susciter le scepticisme. Est-ce le talent qui explique ce succès, ou simplement le timing favorable d’une artiste noire émergeant au moment où les institutions cherchent désespérément à diversifier leurs collections ? La réponse est probablement un mélange des deux, et c’est précisément ce qui rend l’affaire intéressante. Le talent seul ne suffit jamais. Il faut que les conditions sociales, économiques et politiques soient réunies pour qu’il soit reconnu. Mckinney a eu la lucidité de comprendre cela. Elle ne se berce pas d’illusions sur la pérennité de l’attention qu’on lui porte. Elle se demande : “Dans cinq ans, peut-être que personne ne cherchera une Danielle Mckinney”. Cette clairvoyance la protège de l’hubris qui guette tout artiste soudainement célébré.
Reste une question fondamentale : pourquoi ces peintures nous touchent-elles autant ? Qu’est-ce qui, dans ces petites toiles sombres représentant des femmes immobiles, génère une émotion si forte qu’elle peut faire pleurer des collectionneurs aguerris dans les foires d’art ? La galeriste Marianne Boesky raconte avoir vu une acheteuse en larmes devant une oeuvre de Mckinney. En vingt-huit ans de carrière, elle n’avait jamais assisté à une telle scène. Ce pouvoir émotionnel de la peinture demeure un mystère. On peut invoquer la qualité de la touche, l’intelligence des compositions, la résonance des thèmes. Mais au fond, quelque chose échappe à l’analyse rationnelle. C’est peut-être simplement que Mckinney peint avec honnêteté, sans pose, sans calcul. Elle peint ce qu’elle ressent, et cette authenticité se transmet. Ses figures deviennent des êtres vivants sous nos yeux. Elles respirent, elles pensent, elles existent au-delà du cadre. Cette animation de la matière inerte, cette insufflation de vie dans la peinture, relève d’un don rare que possèdent seuls les grands peintres.
Alors, que retenir de Danielle Mckinney ? Une artiste qui refuse les facilités, qui interroge en permanence sa légitimité sans pour autant s’effondrer sous le poids du doute. Une peintre qui prouve que la figuration n’est pas morte, qu’elle peut encore dire des choses neuves sur notre époque tourmentée. Une femme qui offre à d’autres femmes noires le luxe de se voir représentées dans des postures de repos, brisant ainsi des siècles d’iconographie qui les cantonnait au labeur ou à l’héroïsme sacrificiel. Mais surtout, une créatrice qui nous rappelle que l’art n’a pas à justifier son existence par son utilité sociale immédiate. Il peut simplement être beau, troublant, silencieux. Il peut créer des zones de respiration dans un monde étouffant. Il peut nous apprendre, comme le font les peintures de Mckinney, que ne rien faire est parfois l’acte le plus politique qui soit. Dans la lenteur de ses figures alanguies, dans le silence épais de ses chambres closes, dans la fumée qui monte paresseusement des cigarettes, se déploie une résistance tranquille au diktat de la productivité, à l’injonction de la performance permanente. Ces femmes qui dorment, qui rêvassent, qui s’ennuient magnifiquement, nous enseignent une leçon essentielle : parfois, exister suffit.
- Danielle Mckinney, interview avec Alison Gingeras, Mousse Magazine, mai 2021
- Tina Campt, Listening to Images, Duke University Press, Durham, 2017
- Danielle Mckinney, interview avec Alyssa Gaines, Boston Art Review, octobre 2025