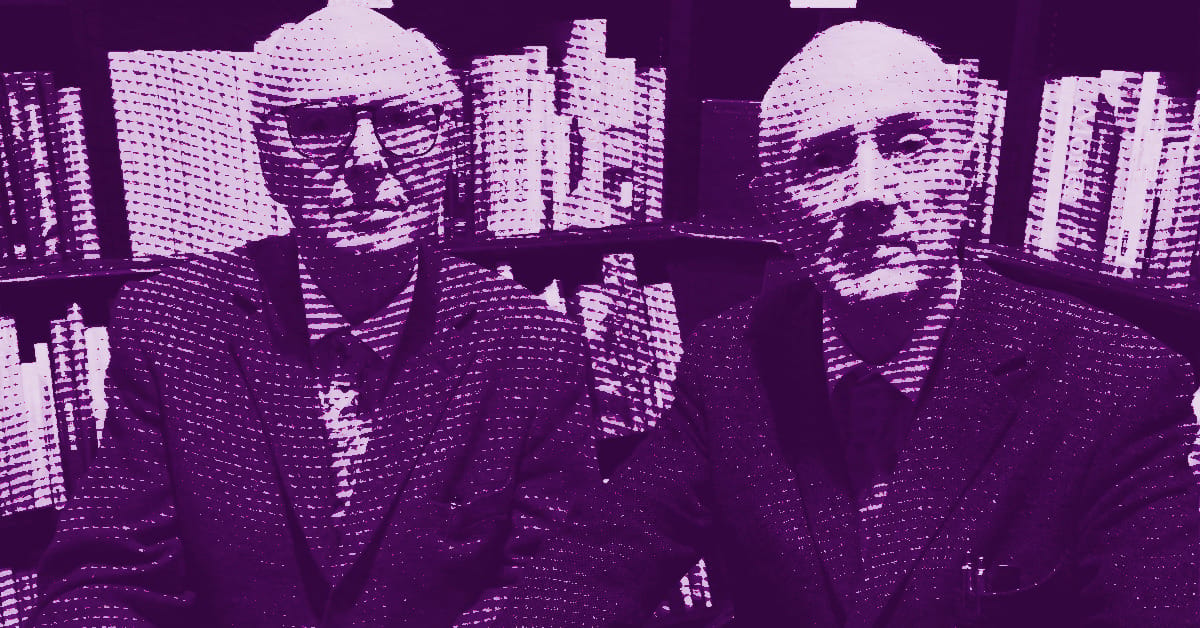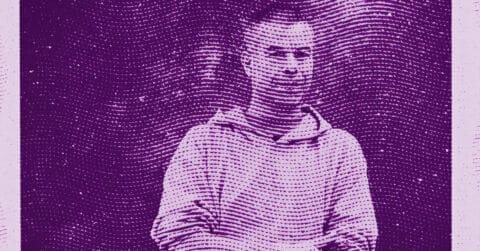Écoutez-moi bien, bande de snobs : Gilbert & George ne sont pas des artistes ordinaires, et prétendre les comprendre à travers le prisme convenu de l’histoire de l’art contemporain serait une erreur aussi grossière que de juger une cathédrale par la couleur de ses vitraux. Ce duo improbable, formé en 1967 à la Saint Martin’s School of Art, a méthodiquement construit une oeuvre qui défie toute classification hâtive, toute tentative de réduction à un mouvement, à une école ou à une tendance passagère.
Gilbert Prousch, né dans le Tyrol du Sud italien en 1943, et George Passmore, né à Plymouth en 1942, incarnent depuis plus d’un demi-siècle une singularité artistique qui mérite qu’on s’y arrête avec rigueur. Leur démarche s’inscrit dans une temporalité longue, presque architecturale, où chaque oeuvre constitue une pierre supplémentaire dans l’édifice qu’ils érigent patiemment. La dimension architecturale de leur travail ne relève pas de la métaphore commode mais d’une réalité structurelle profonde. Leur maison de Fournier Street à Spitalfields, cette demeure géorgienne du XVIIIe siècle qu’ils habitent depuis 1968, n’est pas simplement un lieu de résidence mais le creuset même de leur pratique artistique. L’architecture devient chez eux langage, méthode, philosophie. La restauration minutieuse qu’ils ont entreprise de cette bâtisse, lui rendant son décor originel, témoigne d’une conscience aiguë du rapport entre structure et contenu, entre forme et existence. Cette maison n’est pas un décor mais une extension de leur corps artistique, un espace où la vie et l’art fusionnent jusqu’à l’indistinction.
Les grilles noires qui structurent leurs photomontages depuis les années 1970 évoquent immédiatement l’ordonnancement des vitraux médiévaux, ces compositions fragmentées qui racontent des histoires sacrées à travers des panneaux colorés. Mais là où le vitrail gothique élève l’âme vers le divin, les grilles de Gilbert & George la ramènent brutalement vers le terrestre, le corporel, l’obscène même. Leur série des Pictures, inaugurée au début des années 1970, impose un système de composition rigoureux où chaque oeuvre se déploie comme une fenêtre ouverte sur l’East End londonien. Cette structuration géométrique, loin d’être un simple choix esthétique, établit un ordre dans le chaos de la vie urbaine qu’ils documentent avec une constance presque maniaque. Les couleurs saturées, souvent criardes, emprisonnées derrière ces barreaux noirs, créent une tension entre contention et débordement, entre l’apollinien de la structure et le dionysiaque du contenu. L’architecture de leurs oeuvres mime celle de la ville elle-même, avec ses fenêtres, ses façades, ses divisions spatiales qui organisent la promiscuité humaine.
La question sociologique traverse leur oeuvre avec une acuité qui surprend chez des artistes souvent accusés de frivolité. Gilbert & George ne se contentent pas d’observer leur quartier, ils en font un laboratoire d’étude des mutations sociales contemporaines. Leur affirmation selon laquelle “rien ne se passe dans le monde qui ne se passe pas dans l’East End” [1] pourrait sembler présomptueuse si elle ne s’accompagnait pas d’une production d’images qui documente méthodiquement les strates sociales de ce territoire. L’East End londonien, avec son histoire d’immigration successive, de pauvreté endémique et de gentrification galopante, offre effectivement un concentré des tensions qui traversent les métropoles occidentales. Les artistes s’y positionnent comme des ethnographes en costume trois-pièces, collectant les détritus de la modernité urbaine : cartouches de protoxyde d’azote, graffitis, petites annonces de travailleurs du sexe, titres sensationnalistes de journaux. Cette accumulation n’est pas gratuite mais procède d’une méthodologie quasi scientifique. Chaque élément prélevé dans leur environnement immédiat devient un symptôme, un indice des rapports de classe, de race, de genre qui structurent la société britannique.
Leur usage du langage, notamment dans les séries comme Ages de 2001 ou les Jack Freak Pictures de 2009, révèle une compréhension fine des mécanismes de domination symbolique. En reproduisant des annonces de prostitution masculine, ils exposent crûment la marchandisation des corps dans l’économie néolibérale. En collectant les manchettes hystériques de l’Evening Standard, ils mettent à nu la fabrique de la peur et du ressentiment qui alimente le populisme. La répétition obsessionnelle des mots “Murder”, “Victim”, “Gangs” dans leurs compositions souligne la fonction idéologique du discours médiatique qui construit une réalité où la violence devient le mode d’appréhension dominant du social. Gilbert & George ne dénoncent pas explicitement ces mécanismes, leur neutralité affichée les préserve de tout didactisme, mais leur montage produit une distanciation critique. Le spectateur se trouve confronté à la matérialité brute du langage social, décontextualisé et réifié dans l’espace de l’oeuvre d’art.
La question de la classe sociale traverse souterrainement leur pratique. Leur uniforme vestimentaire, ces costumes démodés qu’ils arborent depuis The Singing Sculpture en 1969, constitue un geste sociologique autant qu’esthétique. Le costume représente historiquement le vêtement de la respectabilité petite-bourgeoise, celui du commis, de l’employé de bureau, du fonctionnaire subalterne. En s’y enfermant quotidiennement, Gilbert & George performent une identité de classe ambiguë, ni prolétaire ni aristocratique, qui correspond exactement à leur position dans le champ artistique. Ils revendiquent une accessibilité populaire avec leur slogan “Art for All” (L’art pour tous) [2], mais produisent des oeuvres vendues à prix d’or aux collectionneurs internationaux. Cette contradiction n’est pas une hypocrisie mais le reflet honnête de la position impossible de l’artiste contemporain, pris entre aspiration démocratique et intégration au marché du luxe. Leur quartier de Spitalfields incarne d’ailleurs cette tension : ancien territoire ouvrier de l’industrie textile, il est devenu l’un des secteurs les plus embourgeoisés de Londres, où les maisons géorgiennes atteignent plusieurs millions de livres. Gilbert & George habitent physiquement et symboliquement cette contradiction.
Leur traitement de la religion comme institution sociale est particulièrement intéressant. Les oeuvres de la série Sonofagod Pictures de 2005 ne se contentent pas de blasphémer pour le plaisir de choquer. Elles interrogent la persistance du fait religieux dans les sociétés sécularisées et la manière dont les symboles sacrés continuent d’exercer une emprise sur l’imaginaire collectif. En juxtaposant des croix chrétiennes, des motifs islamiques et leurs propres corps dans des postures christiques, ils soulignent la fonction anthropologique universelle du religieux tout en en démystifiant les prétentions transcendantes. La religion apparaît comme un système de signes parmi d’autres, ni plus ni moins légitime que le langage publicitaire ou pornographique. Cette équivalence généralisée des systèmes symboliques, caractéristique de la condition postmoderne, trouve dans leur travail une expression particulièrement explicite.
La question raciale, omniprésente dans leur oeuvre des années 1980 et 2000, soulève des ambiguïtés que les artistes assument avec une forme de provocation calculée. Des titres comme Paki pour désigner le portrait d’un homme asiatique ont suscité des accusations de racisme, accusations qu’ils balaient d’un revers de main en invoquant leur fonction de miroir social. Ils ne créent pas le racisme, argumentent-ils, ils le documentent. Cette posture de neutralité ethnographique est évidemment problématique, car elle occulte le fait que la reproduction, même critique, de stéréotypes raciaux contribue à leur circulation. Néanmoins, leur insistance à représenter la diversité ethnique de l’East End, à donner une visibilité à des populations marginalisées, participe d’une forme d’inclusivité, fût-elle maladroite. Leurs derniers travaux, exposés jusqu’au 11 janvier 2026 à la Hayward Gallery de Londres, continue d’interroger les lignes de fracture identitaires qui traversent la société britannique post-Brexit, cette société qu’ils observent depuis plus d’un demi-siècle avec une constance admirable.
Le geste artistique de Gilbert & George consiste fondamentalement à transformer leur existence même en sculpture vivante. Cette décision prise à la fin des années 1960 de ne jamais apparaître séparés, de porter constamment le même type de costume, de refuser la distinction entre temps de travail et temps de vie privée, relève d’une radicalité dont on mesure mal l’exigence. Ils se sont littéralement construits comme des monuments, des figures publiques dont l’identité artistique prime sur toute identité personnelle. Cette auto-monumentalisation trouve son aboutissement logique dans l’ouverture en 2023 du Gilbert & George Centre à Heneage Street, espace dédié exclusivement à leur oeuvre, préfiguration d’un mausolée où leur mémoire sera conservée après leur mort. Car la mort rôde désormais dans leurs compositions récentes. La série The Corpsing Pictures de 2023 les montre allongés sur des ossements, habillés de costumes rouge sang. À plus de quatre-vingts ans, ils affrontent leur finitude avec la même absence d’affectation qu’ils ont appliquée à tous les autres sujets.
Leur rapport à la sexualité mérite qu’on s’y attarde. Mariés civilement en 2008 après quarante ans de vie commune, ils ont fait de leur relation homosexuelle un élément constitutif de leur oeuvre bien avant que cela ne devienne socialement acceptable. Les Naked Shit Pictures de 1994, qui les montrent nus au milieu de représentations d’excréments, affirment la dimension charnelle, corporelle, triviale de l’existence humaine. Ils refusent la sublimation romantique de l’amour comme de la sexualité, préférant les montrer dans leur matérialité prosaïque. Cette approche désenchantée peut sembler cynique, mais elle porte aussi une forme de tendresse. Leur affirmation que leurs oeuvres sont “une sorte de lettre d’amour visuelle de notre part au spectateur” [3] suggère que derrière la provocation et l’obscénité se cache un désir de connexion humaine, une volonté de partager une expérience du monde sans fard ni mensonge.
L’oeuvre de Gilbert & George résiste à toute récupération facile. Conservateurs autoproclamés, admirateurs de Margaret Thatcher, soutiens du Brexit et de la monarchie, ils déjouent les attentes politiques du milieu de l’art contemporain généralement progressiste. Cette position hétérodoxe leur a valu l’hostilité d’une partie de la critique qui les accuse de complaisance envers les forces réactionnaires. Pourtant, leurs oeuvres sur le fascisme ou l’homophobie témoignent d’un engagement sans ambiguïté contre l’oppression. Cette contradiction apparente révèle surtout la pauvreté des catégories politiques binaires pour appréhender la complexité du réel. Gilbert & George échappent aux cases, et c’est précisément ce qui rend leur travail nécessaire. Ils nous rappellent que la vie sociale ne se laisse pas réduire à des slogans, que les individus ne sont pas des abstractions idéologiques mais des êtres de chair traversés de contradictions.
Leur legs dépasse largement le cadre de l’histoire de l’art britannique. Ils ont influencé des générations d’artistes, de Kraftwerk qui s’inspira de leur apparence pour créer son esthétique robotique, à Grant Morrison qui les pastichera dans sa série de bandes dessinées The Filth. Leur longévité exceptionnelle, plus de cinquante-cinq ans de collaboration ininterrompue, constitue en soi une performance remarquable dans un monde de l’art caractérisé par l’éphémère et la course à la nouveauté. Ils ont méthodiquement construit une oeuvre-cathédrale, pierre après pierre, image après image, avec une discipline monacale. Cette patience, cette fidélité à une vision, cette obstination à creuser le même sillon décennie après décennie force le respect, même si l’on peut contester certains aspects de leur travail.
Au terme de ce parcours dans l’univers de Gilbert & George, une évidence s’impose : leur oeuvre ne se laisse pas apprivoiser par les grilles d’analyse conventionnelles. Elle exige qu’on l’aborde avec les instruments de l’architecture pour comprendre sa structure, avec ceux de la sociologie pour saisir son ancrage dans le réel, avec ceux de l’anthropologie pour apprécier sa dimension documentaire. Mais elle requiert aussi qu’on accepte sa part irréductible de mystère, cette zone opaque où deux vies se sont fondues en une seule entité artistique dont la logique intime nous échappe nécessairement. Leur maison de Fournier Street, temple et laboratoire, archive et sanctuaire, deviendra après leur disparition un lieu de pèlerinage pour ceux qui chercheront à percer le secret de cette fusion. Mais peut-être que ce secret n’existe pas, peut-être que Gilbert & George ont simplement choisi de vivre leur art plutôt que de le produire, et que cette décision originelle contient déjà toute la clé de leur énigme. Dans une époque saturée de discours théoriques et de justifications conceptuelles, ils offrent le spectacle rare d’une pratique artistique qui se suffit à elle-même, qui n’a pas besoin qu’on la traduise ou qu’on l’explique parce qu’elle est là, massive, incontournable, irritante parfois, mais indéniablement vivante. Et c’est peut-être là leur victoire ultime : avoir réussi à survivre à toutes les modes, à tous les mouvements, à toutes les théories, en restant obstinément eux-mêmes, deux hommes en costume regardant le monde défiler depuis leur rue de Spitalfields, collectant ses débris pour en faire des cathédrales de lumière et de boue.
- Anna van Praagh, “Gilbert and George: ‘Margaret Thatcher did a lot for art'”, The Daily Telegraph, 5 juillet 2009
- Slogan adopté par les artistes dès leurs débuts, mentionné notamment dans Wolf Jahn, The art of Gilbert & George, or, An aesthetic of existence, Thames & Hudson, 1989
- Citation des artistes rapportée dans “Gilbert & George deshock at Rivoli”, ITALY Magazine, archive du 28 janvier 2013