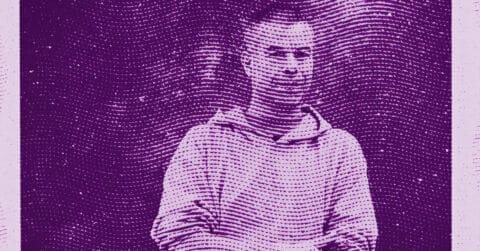Écoutez-moi bien, bande de snobs, voici un peintre qui a passé sa vie à nous mentir avec une honnêteté désarmante. Howard Hodgkin, cet Anglais né en 1932 et mort en 2017, ce baronet du pinceau qui récoltait les honneurs comme d’autres ramassent les feuilles mortes, n’a cessé de prétendre qu’il ne faisait pas de l’art abstrait. Quelle audace. Regardez ses tableaux : des éclaboussures de turquoise, des traînées d’orange, des masses de vert qui débordent sur les cadres comme une marée indisciplinée. Et pourtant, il protestait. Non, disait-il, je peins des situations émotionnelles. Je peins la mémoire. Comme si la mémoire avait jamais ressemblé à une tache de peinture sur du contreplaqué.
Mais justement, c’est là que réside toute la perversité de son entreprise. Hodgkin nous a donné des tableaux qui sont à la fois tout et rien, qui promettent des récits et ne livrent que des sensations, qui portent des titres comme Waking up in Naples ou In a French Restaurant et qui ne montrent rien d’autre que l’impossibilité de montrer quoi que ce soit. Il a construit une oeuvre entière sur le fossé entre ce qui peut être dit et ce qui peut être peint, entre le souvenir et sa représentation, entre le désir et sa satisfaction. Un peintre du manque, donc, déguisé en coloriste joyeux.
Sa technique elle-même trahit cette obsession du contrôle et de la perte. Il peignait sur du bois, jamais sur toile. Pourquoi ? Parce que, disait-il, “le bois répond” [1]. La toile céderait, se déformerait, s’affaisserait sous le poids de ses repentirs. Car Hodgkin était un peintre lent, terriblement lent. Un seul tableau pouvait lui prendre des années, des couches successives de peinture appliquées, grattées, recouvertes, jusqu’à ce que l’objet devienne un empilement de temps écoulé. Chaque surface porte la trace de cette lutte, de cette recherche éperdue de quelque chose qui fuit toujours.
Et puis il y a ces cadres. Hodgkin ne se contentait pas d’encadrer ses oeuvres : il les débordait, les envahissait, les colonisait. La peinture coulait sur le cadre, le transformait en partie intégrante de l’image. Certains y ont vu une métaphore de l’émotion qui déborde, de la passion qui ne peut être contenue. D’autres, plus pragmatiques, y ont vu un procédé décoratif, une coquetterie. Mais ce geste révèle surtout une angoisse profonde : celle de la délimitation, de la frontière entre l’oeuvre et le monde, entre le dedans et le dehors. Comme s’il cherchait à protéger ses images d’une intrusion, d’un regard qui viendrait imposer ses propres cadres.
Car Howard Hodgkin était un homme habité par la nostalgie et le secret. Homosexuel marié pendant des années, père de famille avant d’oser vivre avec son compagnon Antony Peattie, collectionneur de miniatures indiennes, lecteur compulsif de romans policiers d’Agatha Christie, il menait une existence cloisonnée, compartimentée. Ses tableaux, prétendument autobiographiques, ne révèlent rien. Ou plutôt, ils révèlent l’impossibilité de révéler. Ils sont des portes fermées, des fenêtres embuées, des volets mi-clos sur des intérieurs qu’on ne verra jamais vraiment.
La poésie du presque-dit
Hodgkin était un grand lecteur de poésie, et c’est dans ce rapport qu’il entretenait avec la littérature que se dessine peut-être le mieux la nature de son projet pictural. Quand on lui demandait quels poètes il fréquentait, il répondait Stevie Smith, cette Anglaise décalée du XXe siècle qui écrivait des vers d’une simplicité apparente, presque enfantine, mais chargés d’une mélancolie déchirante. Le parallèle est éclairant. Stevie Smith, comme Hodgkin, pratiquait un art du dépouillement trompeur, une naïveté construite qui dissimulait des abîmes. Son poème le plus célèbre, celui qui évoque quelqu’un qui se noie mais que l’on croit en train de faire des signes de la main, pourrait servir d’exergue à toute l’oeuvre de Hodgkin.
Cette affinité avec la poésie n’est pas anecdotique. Elle structure profondément son approche de la peinture. Seamus Heaney, lors d’une exposition de Hodgkin à Dublin en 2006, avait cité Philip Larkin et son poème The Trees, ces arbres dont les feuilles nouvelles ressemblent à “quelque chose de presque dit”. Le presque-dit : voilà exactement ce que Hodgkin tentait de capturer. Non pas le dit, non pas le montré, mais ce moment tremblant juste avant l’articulation, ce frémissement qui précède la parole ou l’image. La mémoire, pour Hodgkin, n’était jamais claire, jamais nette. Elle était brume, impression, couleur diffuse. Elle était le contraire de la précision documentaire.
C’est pourquoi il refusait avec tant de véhémence qu’on raconte les histoires derrière ses tableaux. Les critiques, toujours avides de narratifs rassurants, voulaient savoir : que s’est-il passé à Naples ce matin-là ? Qui était assis dans ce restaurant français ? Hodgkin se dérobait. Non pas par coquetterie, mais parce qu’il savait que le récit tuerait la peinture. Qu’une fois l’anecdote révélée, le tableau ne serait plus qu’une illustration, une note de bas de page à une vie. Or ce qu’il cherchait, c’était précisément l’inverse : faire du tableau un événement en soi, une expérience qui n’a pas besoin du récit pour exister.
Cette position est profondément poétique. La poésie, plus que tout autre art du langage, résiste à la paraphrase. On ne peut pas résumer un poème, on ne peut que le lire, encore et encore, en faisant l’expérience de ses rythmes, de ses sonorités, de ses silences. Les tableaux de Hodgkin fonctionnent de la même manière. Ils ne veulent rien dire, ils veulent être éprouvés. Leur sens n’est pas déchiffrable, il est sensible. Dire qu’un tableau représente un ami absent ou un coucher de soleil à Bombay ne nous apprend rien sur ce que le tableau fait, sur comment il opère sur notre regard et notre corps.
Les titres eux-mêmes participent de cette poétique de l’indirection. Ils ne décrivent pas, ils suggèrent. Ils ouvrent des pistes que l’image ne confirme ni n’infirme. Ils créent une tension, un écart, un espace de jeu entre les mots et les formes. Absent Friends, par exemple, ce tableau de 2000-2001 qui donnait son titre à une exposition posthume : quelques larges touches de noir, de brun, de turquoise. L’absence y est-elle visible ? Non. Mais le titre la convoque, et soudain ces couleurs se chargent d’une tristesse, d’un manque. Le titre agit comme un filtre émotionnel, il colore notre perception sans déterminer ce que nous voyons.
Cette pratique du titre évocateur mais non descriptif rappelle certains procédés de la poésie moderne. Le titre devient un seuil, un portique par lequel on entre dans l’oeuvre sans savoir exactement où l’on va. Il crée une attente qui ne sera jamais tout à fait comblée. Et c’est justement dans cet inaccomplissement que réside la force du travail. Hodgkin peignait depuis la mémoire, mais une mémoire fragmentaire, lacunaire, incertaine. Il ne cherchait pas à reconstituer le passé mais à en capturer l’affect, la tonalité émotionnelle. En cela, son travail est proche de celui de Proust, autre grand explorateur de la mémoire involontaire, de ces moments où le passé resurgit non pas comme récit cohérent mais comme sensation brute.
Mais contrairement à Proust qui déployait des phrases infinies pour saisir ces instants fugaces, Hodgkin compressait, synthétisait, réduisait. Ses tableaux sont des haïkus de couleur, des épigrammes visuelles. Quelques coups de pinceau, et c’est tout un monde qui apparaît et disparaît. Cette économie de moyens, cette capacité à suggérer l’immensité avec le minimum, c’est encore une leçon de poésie. Le grand poème n’est pas celui qui dit tout, c’est celui qui laisse le plus de place au silence, à ce qui ne peut être dit.
L’architecture du retrait
L’autre clé pour comprendre Hodgkin se trouve dans son rapport à l’espace, à l’architecture, au lieu de création. Son atelier londonien, situé à l’arrière de sa maison géorgienne de Bloomsbury, est un espace extraordinaire. Ancienne laiterie du XIXe siècle, il fut transformé en 1991 en un sanctuaire entièrement blanc. Murs blancs, sol blanc, plafond de verre translucide diffusant une lumière uniforme, sans ombres. Un espace de près de trois cents mètres carrés vidé de toute distraction, de toute couleur. L’architecte Robert Barnes avait conçu un toit utilisant des millions de tubes de verre pour créer une luminosité constante, quelle que soit la météo [2].
Cette blancheur absolue n’est pas anodine. Pour un peintre célèbre pour ses explosions chromatiques, le choix de travailler dans un environnement aussi dépouillé constitue un paradoxe révélateur. Hodgkin avait besoin de ce vide, de cette neutralité, de cette absence. Il disait de la lumière de son atelier qu’elle était comme une enveloppe. Une enveloppe protectrice, mais aussi une enveloppe qui contient, qui délimite, qui sépare l’intérieur de l’extérieur. L’atelier était pour lui un lieu de retraite au sens monastique du terme, un espace de solitude radicale où il pouvait se confronter à ses images sans médiation, sans interférence.
Cette conception de l’atelier comme espace sacré, presque liturgique, en dit long sur sa pratique. Hodgkin ne peignait jamais en musique, jamais entouré des objets qu’il collectionnait pourtant avec passion. Juste lui, la lumière blanche, et le tableau en cours. Cette ascèse était nécessaire. Peindre, pour lui, était un acte de concentration extrême, une forme de méditation douloureuse. Il passait plus de temps assis à regarder ses tableaux, à attendre le bon moment pour intervenir, qu’à peindre effectivement. Cette patience, cette capacité à ne rien faire, était le coeur de son processus.
L’espace de l’atelier fonctionnait aussi comme une chambre d’isolation sensorielle. En éliminant toute stimulation extérieure, en créant une sorte de vide, Hodgkin pouvait se concentrer sur les images intérieures, celles qui surgissaient de sa mémoire. La blancheur de l’atelier était l’écran sur lequel se projetaient ses souvenirs. Elle était la page blanche avant l’écriture, le silence avant la musique. Cette blancheur n’était pas une absence mais une potentialité, un réservoir infini de possibles.
Il y a quelque chose de profondément architectural dans la manière dont Hodgkin construisait ses tableaux. Les cadres, nous l’avons dit, faisaient partie intégrante de l’oeuvre. Mais au-delà de ce geste, c’est toute sa composition qui relève d’une pensée architecturale. Ses tableaux créent des espaces. Pas des espaces illusionnistes, des fenêtres ouvertes sur un monde fictif à la manière de la Renaissance. Non, des espaces réels, physiques, tridimensionnels. Le bois sur lequel il peignait n’est pas un support transparent mais un objet, une chose qui a son poids, sa matérialité, sa présence.
Cette matérialité est essentielle. Hodgkin insistait sur le fait que ses tableaux devaient être avant tout des objets, des choses qui existent fermement dans le monde. Cette solidité était nécessaire parce que tout le reste, la mémoire, l’émotion, le sens, était si instable, si fluide. Le tableau comme objet était un point d’ancrage dans un monde de flux. C’était une architecture minimale, un abri contre l’évanescence du temps.
Les cadres, en débordant, créaient une zone de transition entre l’image et son environnement. Ils fonctionnaient comme des seuils, des portiques, des embrasures de portes. On pense à l’architecture de John Soane, que Hodgkin admirait profondément. Soane, ce visionnaire néoclassique, maître des effets de lumière et des espaces enchevêtrés, créait des intérieurs où chaque pièce ouvrait sur une autre, où les miroirs multipliaient les perspectives, où l’on ne savait jamais exactement où l’on était. Cette complexité spatiale, cette dissolution des limites claires entre dedans et dehors, entre un espace et un autre, trouve un écho dans les tableaux de Hodgkin.
L’exposition de ses estampes au Pitzhanger Manor de Soane du 1er octobre 2025 au 8 mars 2026 n’est pas un hasard. Il y avait une affinité profonde entre ces deux créateurs d’espaces. Tous deux travaillaient l’idée de l’enveloppement, du cadrage, de la mise en scène de l’expérience visuelle. Chez Soane, les ouvertures circulaires, les voûtes, les niches créaient des cadrages successifs qui guidaient le regard. Chez Hodgkin, les cadres peints, les bords qui débordent, les plans de couleur qui se superposent créaient des effets similaires de profondeur et de mystère.
Cette dimension architecturale de son travail est aussi liée à son obsession pour les intérieurs. Hodgkin était un décorateur né, un créateur d’atmosphères. Sa maison de Bloomsbury était célèbre pour son excentricité raffinée : des centaines d’exemplaires du même livre reliés en vert et rouge pour couvrir un mur et absorber le bruit, des abat-jour faits de sacs plastique blancs bon marché pour obtenir la lumière la plus diffuse possible, des chaises de toutes époques et tous styles disposées avec un soin maniaque. Chaque détail comptait, participait à la création d’un environnement contrôlé, d’un espace où tout était calculé.
Cette attention obsessionnelle au décor, loin d’être superficielle, révèle une préoccupation profonde : celle du rapport entre l’individu et son environnement, entre le moi et ce qui l’entoure. Les intérieurs de Hodgkin, qu’ils soient peints ou vécus, ne sont jamais neutres. Ils sont chargés de mémoire, de présences fantomatiques, d’émotions résiduelles. Un tableau comme Grantchester Road évoque la maison d’un ami architecte, mais ce qu’on y voit n’est pas une représentation fidèle. C’est une impression, une atmosphère, le sentiment d’être dans cet espace à un moment donné. L’architecture devient affect.
Le legs paradoxal
Que reste-t-il, finalement, de cette entreprise ? Des objets précieux, certes, qui se vendent fort cher et ornent les murs des musées. Mais surtout, peut-être, une leçon sur l’impossibilité de la restitution. Hodgkin a passé sa vie à essayer de peindre ce qui ne peut être peint : le temps qui passe, les amis disparus, les émotions évanouies. Il a échoué, magnifiquement. Ses tableaux ne capturent rien, ils ne fixent rien. Ils ne font que pointer vers ce qui manque, vers ce qui a été perdu.
Son ami Patrick Caulfield, visitant sa propre rétrospective, pleurait en répétant “pas assez, pas assez” [3]. Hodgkin rapportait cette anecdote avec une émotion palpable, car c’était aussi son propre sentiment. Jamais assez. Jamais tout à fait ça. Toujours un écart entre l’intention et le résultat, entre le souvenir et sa traduction picturale. Cette insatisfaction chronique, loin d’être une faiblesse, était le moteur de son travail.
Vers la fin de sa vie, curieusement, ses tableaux se sont dépouillés. Moins de couches, moins de matière, plus de vide. Comme si, après des décennies de lutte, il avait compris que moins on en dit, plus on touche juste. Que le silence peut être plus éloquent que le discours. Ces dernières oeuvres, avec leurs quelques coups de pinceau sur du bois nu, atteignent une forme de sagesse. Elles ne prétendent plus rien. Elles se contentent d’être là, modestes, fragiles, émouvantes.
La mort l’a surpris en 2017, à quatre-vingt-quatre ans, alors qu’il préparait encore des expositions. On imagine qu’il aurait continué indéfiniment si son corps le lui avait permis. Non par ambition mais par nécessité. Parce que peindre, pour lui, n’était pas un choix mais une condition d’existence. Une manière d’habiter le temps, de faire face à l’inéluctable disparition. Ses tableaux sont des monuments à l’éphémère, des architectures pour l’impalpable. Ils célèbrent ce qui fuit en tentant de le retenir, sachant que cette tentative est vouée à l’échec. Et c’est précisément dans cet échec assumé que réside leur beauté.
- Veery journal, cité dans Wikipedia, consulté le 5 novembre 2025 lors de la recherche documentaire.
- Robert Barnes, Letter to the Editor, London Review of Books, Vol. 43 No. 13, 1 July 2021.
- Charlotte Burns, “Howard Hodgkin: ‘I felt like an outcast in the art world'”, The Guardian, 4 May 2016.