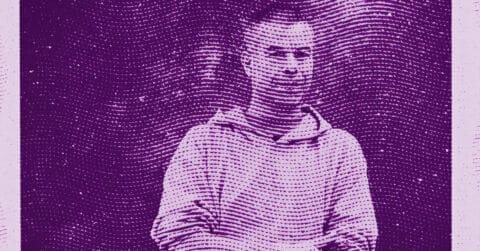Écoutez-moi bien, bande de snobs : si vous croyez encore que l’art contemporain se résume à quelques coups de pinceau audacieux sur une toile blanche ou à des installations narcissiques dans des galeries aseptisées, préparez-vous à ce que Julio César Morales bouleverse vos certitudes douillettes. Cet artiste né à Tijuana n’a que faire de vos conventions esthétiques étriquées. Son travail, véritable chronique visuelle de la condition migrante, s’impose comme l’une des propositions les plus incisives de l’art américain contemporain. Mais attention : ce n’est pas un militant armé de slogans simplistes, c’est un poète armé d’aquarelles, un compositeur dont l’instrument serait la mémoire collective d’un peuple en mouvement perpétuel.
Morales opère à la frontière, géographique, certes, mais surtout conceptuelle, entre deux nations, deux langues, deux imaginaires. Cette position liminaire n’est pas une posture intellectuelle choisie pour faire joli dans un dossier de presse. L’artiste a littéralement grandi dans la Zona Norte de Tijuana avant que sa famille ne déménage, à ses dix ans, d’un seul bloc vers San Ysidro, en Californie. Un bloc. Cette distance dérisoire contient pourtant toute la violence d’une séparation géopolitique dont les conséquences se mesurent en vies brisées. “J’ai grandi en traversant la frontière tous les jours jusqu’à mes vingt ans”, confie-t-il [1]. Ce n’est pas une anecdote biographique, c’est le matériau brut de son art.
Le cinéma comme grammaire du regard
Lorsque Morales déclare qu’il est “un musicien, mais [que son] instrument est l’art visuel” [2], il ne s’agit pas d’une métaphore commode. Sa pratique emprunte effectivement au montage cinématographique, à la construction narrative du film documentaire, à l’économie visuelle du néoréalisme italien. Pensez à Vittorio De Sica filmant les rues romaines dans Le Voleur de bicyclette : même attention portée aux anonymes, même refus du pathos facile, même dignité accordée aux figures marginales. Morales n’illustre pas la souffrance, il la cadre. Il ne dénonce pas, il montre. Nuance capitale dans un paysage artistique saturé de bonnes intentions moralisatrices.
Son travail sur The Border, film hollywoodien de 1982 avec Jack Nicholson, constitue à ce titre un exercice remarquable de détournement. Dans ses vidéos “The Border (Los Pollos vs. La Migra)” et “We Don’t See” (toutes deux de 2025), Morales opère un travail de réécriture cinématographique qui ne relève ni du simple commentaire critique ni de la parodie. En découpant la silhouette de l’acteur principal sur les affiches originales du film, en filtrant les images pour effacer les protagonistes au profit des figurants, l’artiste réalise une opération de justice poétique : il rend visible ce que Hollywood avait choisi d’ignorer. Les migrants, dans son montage, ne sont plus des ombres au service d’un récit héroïque centré sur un agent frontalier blanc. Ils deviennent les véritables sujets de l’histoire.
Cette approche quasi-documentaire traverse l’ensemble de sa production. Les aquarelles de la série Undocumented Interventions, commencée en 2010, fonctionnent comme des arrêts sur image d’un film d’horreur dont la réalité surpasse la fiction. Des corps humains cachés dans des tableaux de bord de voiture, dissimulés dans des enceintes audio, repliés dans des piñatas en forme de personnages de dessins animés, SpongeBob, Barney. L’absurde côtoie le tragique avec une immédiateté qui évoque le meilleur cinéma d’auteur latino-américain, celui qui refuse le pittoresque pour embrasser le réel dans toute sa brutalité prosaïque.
Morales construit ses images comme un réalisateur compose ses plans : par accumulation de détails signifiants, par juxtaposition de temporalités, par superposition de points de vue. Ses installations multimédias ne se contentent pas de montrer, elles créent des dispositifs d’immersion. L’installation sonore My America Is Not Your America, réalisée en collaboration avec le Mexican Institute of Sound, transforme l’espace d’exposition en chambre d’écoute, en cabine de méditation politique. Le visiteur y entre à deux, contrainte délibérée qui mime l’intimité forcée des corps dans les séries Gemelos. Le néon rouge qui accompagne cette installation trace littéralement la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais à l’envers, comme si le monde avait basculé. Exactement comme lorsqu’on traverse.
Sociologie de la blessure ouverte
Si Morales opère en cinéaste, il pense en sociologue. Son travail s’inscrit dans une lignée intellectuelle qui va bien au-delà du témoignage artistique pour constituer une véritable analyse des mécanismes frontaliers. Gloria Anzaldúa, théoricienne chicana majeure, écrivait en 1987 que “la frontière entre les États-Unis et le Mexique est une blessure ouverte là où le Tiers-Monde frotte contre le premier et saigne” [3]. Cette formulation, d’une violence poétique saisissante, pourrait servir de sous-titre à l’ensemble du corpus de Morales.
Mais là où Anzaldúa théorisait la “conscience mestiza”, cette identité fragmentée et recomposée des sujets frontaliers, Morales en propose une incarnation visuelle. Ses aquarelles ne sont pas des illustrations d’une théorie préexistante, elles sont la théorie elle-même, traduite en langage plastique. Chaque image de la série Gemelos constitue une thèse en miniature sur l’espace liminal, ce non-lieu où les individus cessent d’appartenir à leur pays d’origine sans avoir encore rejoint celui de destination. Dans ces interstices périlleux, la sociologie rejoint l’ontologie : qu’est-ce qu’être humain lorsque toutes les structures sociales qui vous définissaient se sont effondrées ?
L’artiste utilise l’aquarelle, medium délicat s’il en est, pour représenter ces passages clandestins. “Sa délicatesse me permet d’ajouter un sentiment de tendresse aux expériences douloureuses et souvent violentes endurées par les personnes tentant de traverser la frontière”, explique-t-il [4]. Choix technique qui est aussi choix éthique : refuser le sensationnalisme, préférer la douceur chromatique à la représentation gore. C’est précisément cette retenue formelle qui rend l’oeuvre si dévastatrice. Les corps entrelacés dans les espaces confinés évoquent autant la matrice que le cercueil, la renaissance que la mort. Cette dualité structurelle renvoie d’ailleurs au mythe maya des jumeaux héros du Popol Vuh, qui traversent eux aussi des portails entre les mondes, meurent et renaissent, se sacrifient pour accéder à une existence nouvelle.
Le vocabulaire sociologique de l’économie informelle traverse également son travail. Morales documente méthodiquement les stratégies de survie déployées par les migrants : trafic humain, passages clandestins, économies parallèles. Mais il refuse obstinément toute hiérarchie morale. Les “coyotes”, passeurs, font partie de sa famille, au même titre que des juges et des policiers. Cette complexité familiale reflète la complexité sociologique de la zone frontalière elle-même, espace où les catégories habituelles du légal et de l’illégal, du bien et du mal, perdent leur pertinence. Il ne s’agit pas de relativisme moral mais de réalisme sociologique : dans ces territoires de l’entre-deux, la survie impose des règles que les bureaucraties étatiques ne peuvent ni comprendre ni réglementer.
Les néons que Morales utilise fréquemment constituent une signature visuelle mais aussi un marqueur sociologique. Cette lumière rouge qui évoque les enseignes de Tijuana, les bars de l’Avenida Revolución, inscrit l’oeuvre dans une géographie spécifique tout en lui conférant une dimension universelle. Le néon, technologie de la visibilité commerciale, devient ici instrument de révélation sociale. L’installation Las Líneas 2028/2022/1845/1640 trace quatre frontières historiques successives, rappelant que ces lignes supposées immuables n’ont cessé de se déplacer au gré des conquêtes, des traités, des guerres. La frontière n’est pas une donnée naturelle, c’est une construction historique, et donc réversible, modifiable et contestable.
La poétique du portail
Les huit aquarelles de la série Gemelos, présentées récemment chez Gallery Wendi Norris à San Francisco (du 19 septembre au 1er novembre 2025), méritent qu’on s’y attarde. Morales y représente des paires de corps, d’où le titre “jumeaux”, comprimés dans des espaces impossibles. Ces espaces, l’artiste les conçoit explicitement comme des portails : seuils entre deux états d’existence, passages entre deux mondes. L’imagerie renvoie au mythe précolombien tout en documentant une réalité contemporaine vérifiable : des photographies circulent effectivement, montrant des enfants dissimulés dans le rembourrage de sièges automobiles pour traverser clandestinement la frontière.
L’ambiguïté visuelle de ces corps entrelacés – sont-ils en train de naître ou de mourir ? – n’est pas un effet esthétique gratuit. Elle traduit l’ambivalence fondamentale de l’expérience migratoire : tout départ est une petite mort, toute arrivée une renaissance incertaine. Les migrants que Morales représente occupent une position existentielle paradoxale, comparable à celle des jumeaux héros mayas qui devaient mourir pour renaître transformés. Sauf que pour les migrants contemporains, la résurrection n’est jamais garantie. Certains meurent dans ces passages étroits, asphyxiés, écrasés. D’autres survivent mais portent à jamais les stigmates psychiques de cette traversée.
Le blanc de l’aquarelle qui entoure ces corps fonctionne comme un vide ontologique, un espace de suspension où les coordonnées habituelles de l’existence se dissolvent. Pas encore là-bas, déjà plus ici, “ni de aquí ni de allá”, comme dit l’expression espagnole. Cette zone intermédiaire, ce “troisième espace” dont parle Morales dans ses entretiens, constitue le véritable sujet de son art. Non pas la frontière comme ligne de démarcation, mais la frontière comme condition existentielle, comme mode d’être au monde.
Sa récente installation tomorrow is for those who can hear it coming, citation détournée d’un slogan publicitaire de David Bowie, pose une question aussi simple que terrible : dans le climat politique actuel, qui a le privilège d’avoir un avenir ? Les raids de l’ICE, la rhétorique xénophobe, les politiques d’expulsion massive créent une situation où certains êtres humains se voient littéralement dénier le droit d’imaginer leur lendemain. Le néon de Morales, avec son écriture gothique empruntée à la culture lowrider chicano, affirme pourtant une forme de résistance : entendre venir demain, c’est refuser d’être réduit au présent immédiat de la survie.
Vers une éthique du regard
Une évidence s’impose : nous sommes face à un artiste qui a compris que la représentation n’est jamais neutre, que montrer c’est déjà prendre position. Mais contrairement à tant de ses contemporains qui transforment l’art en tribune militante, Morales opère avec une subtilité qui respecte l’intelligence du spectateur. Il ne dicte pas ce qu’il faut penser, il crée les conditions d’une pensée possible.
Son usage systématique de matériaux trouvés, de documents réels, d’images préexistantes, s’apparente à une méthodologie d’archiviste autant que d’artiste. Chaque oeuvre fonctionne comme une pièce à conviction dans un procès qui n’aura jamais lieu, celui qui jugerait les politiques migratoires pour ce qu’elles sont : des machines à broyer l’humain. Les aquarelles délicates, les néons lumineux, les installations sonores composent ensemble une forme de mémorial pour les disparus de la frontière, ces milliers d’anonymes dont la mort ne fera jamais la une des journaux.
Ce qui rend le travail de Morales si nécessaire aujourd’hui, c’est précisément son refus du pathos facile. Pas de larmoiement, pas d’indignation performative, pas de culpabilisation du spectateur. Juste une présentation factuelle de situations insoutenables, accompagnée d’une douceur formelle qui rend le tout encore plus insupportable. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : rendre visible l’insoutenable, donner forme à l’inacceptable, sans jamais verser dans l’obscénité de la sur-représentation.
L’artiste a récemment déclaré : “Je veux donner de la valeur et rendre hommage au travail des immigrants et à leurs vies, pas seulement d’Amérique latine, mais du monde entier”. Cette ambition pourrait sembler naïve dans sa simplicité. Elle ne l’est pas. Elle est au contraire d’une radicalité absolue dans un contexte où l’existence même de ces personnes est niée, où leur humanité est systématiquement déniée par les discours politiques dominants. Rendre visible, c’est résister. Témoigner, c’est combattre.
Morales construit patiemment, oeuvre après oeuvre, une contre-archive de la frontière. Là où les médias ne voient que des chiffres, arrestations, expulsions, morts en mer ou dans le désert, lui voit des individus. Là où le discours politique ne perçoit qu’une “crise migratoire”, il identifie des stratégies de survie, des réseaux de solidarité, des économies parallèles, des cultures hybrides. Son art est politique non pas malgré sa dimension poétique, mais précisément à cause d’elle. La poésie, ici, devient un outil de connaissance, un mode d’accès à des réalités que les discours rationnels échouent à saisir.
La rétrospective actuelle au Jan Shrem and Maria Manetti Shrem Museum of Art de l’Université de Californie à Davis, du 7 août au 29 novembre 2025, arrive à point nommé. Elle permet de mesurer la cohérence d’un parcours qui s’étend sur plus de trente ans, depuis les premières interventions performatives jusqu’aux installations multimédias récentes. Cette cohérence n’est pas celle d’un style figé mais celle d’une préoccupation obsessionnelle : comment représenter dignement ceux que le monde contemporain a décidé de rendre invisibles ?
À l’heure où l’art contemporain se complaît trop souvent dans des jeux formels autoréférentiels ou dans un activisme de posture, Morales nous rappelle qu’un artiste peut être à la fois rigoureusement formel et profondément engagé. Que la beauté plastique n’est pas incompatible avec l’urgence politique. Que la délicatesse d’une aquarelle peut porter plus de charge critique qu’un millier de manifestes vengeurs. Son oeuvre démontre qu’on peut parler du réel le plus brutal avec les moyens les plus raffinés, qu’on peut documenter l’horreur sans renoncer à la grâce formelle.
En fin de compte, et c’est peut-être là son apport le plus précieux, Julio César Morales nous offre une leçon d’humanisme radical. Non pas cet humanisme abstrait et confortable qui célèbre l’Homme avec un grand H depuis le confort d’un fauteuil académique, mais un humanisme concret, ancré dans des corps en souffrance, des trajectoires brisées, des espoirs mutilés. Un humanisme qui sait que la dignité ne se proclame pas, elle se construit dans le regard qu’on porte sur autrui. Et le regard que Morales pose sur les migrants n’est jamais condescendant, jamais misérabiliste. C’est un regard d’égal à égal, celui d’un homme qui a lui-même traversé la ligne et qui sait ce que cela signifie.
Son art nous rappelle que derrière chaque statistique migratoire se cache une vie singulière, un réseau familial, une histoire personnelle. Que réduire ces existences à leur statut administratif, légal, illégal, documenté, sans-papiers, constitue une forme de violence symbolique aussi dévastatrice que les violences physiques endurées lors de la traversée. Morales restitue à ces anonymes leur pleine humanité, non par un discours moralisateur, mais par la simple force de la représentation artistique. Il leur offre ce que la société leur refuse : une visibilité, une présence, une inscription dans l’histoire collective.
Voilà pourquoi son oeuvre comptera encore longtemps après que les débats politiques actuels se seront épuisés. Parce qu’elle touche à quelque chose d’universel et d’intemporel : la condition de l’exilé, la douleur de l’arrachement, la complexité de l’identité métisse. Parce qu’elle pose les bonnes questions sans prétendre détenir les réponses. Parce qu’elle nous oblige à regarder ce que nous préférerions ignorer, tout en nous offrant suffisamment de beauté formelle pour que ce regard reste supportable. Entre la violence du réel et la douceur de l’aquarelle, Julio César Morales a trouvé l’exact équilibre qui définit le grand art : celui qui éclaire sans aveugler, qui blesse sans détruire et qui témoigne sans s’épuiser dans le témoignage.
- Natasha Boas, “Julio César Morales Looks at Life on the Edge-Lands”, Hyperallergic, 3 novembre 2025
- Mary Corbin, “Julio César Morales’ tender work renders the pain of migration”, 48 Hills, 7 octobre 2025
- Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, Aunt Lute Books, 1987
- Mary Corbin, “Julio César Morales’ tender work renders the pain of migration”, 48 Hills, 7 octobre 2025