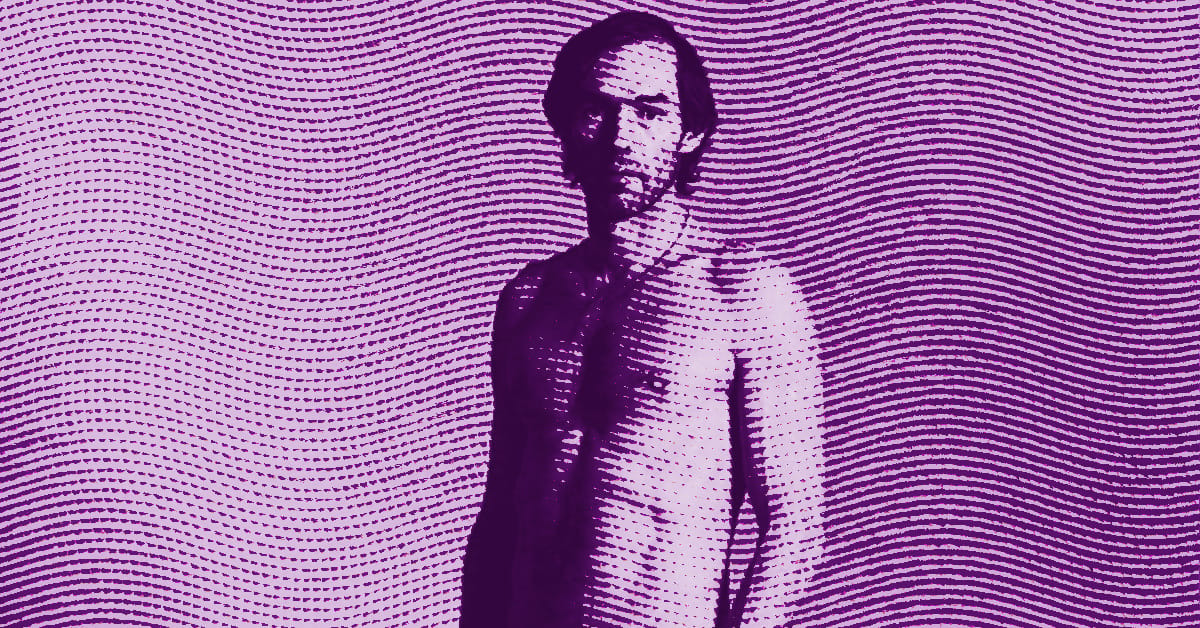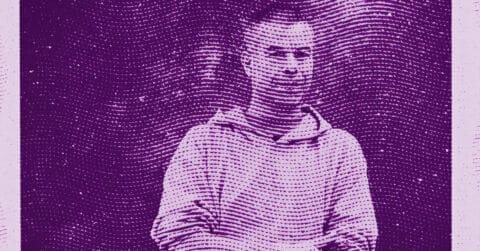Écoutez-moi bien, bande de snobs : pendant que vous vous extasiez devant vos Avedon et vos Mapplethorpe, vous avez raté l’essentiel. Peter Hujar, photographe américain mort du sida en 1987, a capturé quelque chose que vos chouchous du marché de l’art n’ont jamais su saisir. Là où Mapplethorpe sculptait des corps en marbre conceptuel, réduisant ses sujets à des formes abstraites et leurs visages à des masques, Hujar embrassait l’irréductible humanité de chaque être. Sa photographie n’était pas un acte de possession mais de révélation mutuelle, un pacte silencieux noué entre l’objectif et le regard.
Ce photographe américain d’origine ukrainienne, élevé par ses grands-parents dans une ferme du New Jersey avant d’être arraché à treize ans à cette relative tranquillité pour rejoindre l’enfer d’un appartement new-yorkais d’une seule pièce avec une mère violente, n’a jamais cherché la reconnaissance facile. Il vivait dans un loft au-dessus de l’Eden Theater dans l’East Village, transformant cet espace délabré en sanctuaire créatif où tout le monde passait. Son travail est resté marginal durant sa vie, mais depuis, l’histoire lui rend justice. Les institutions majeures acquièrent désormais ses oeuvres par centaines : la Morgan Library, le Metropolitan Museum, la Tate Modern. Mais cet engouement tardif soulève une question dérangeante : pourquoi avons-nous mis quarante ans à comprendre?
Le corps comme texte littéraire
La relation entre Hujar et la littérature ne relève pas du simple hasard biographique. Susan Sontag, cette intellectuelle redoutable qui terrorisait le milieu culturel new-yorkais avec son intelligence acérée, lui confia l’introduction de son unique livre publié de son vivant, “Portraits in Life and Death” en 1976 [1]. Cette alliance n’était pas anodine. Sontag cherchait dans la photographie ce qu’elle explorait dans ses essais : la tension entre surface et profondeur, entre représentation et vérité. Ses théories sur la photographie, développées dans “On Photography”, trouvaient chez Hujar une incarnation paradoxale. Là où Sontag proclamait que la photographie “convertit le monde entier en cimetière” [1], Hujar démontrait que chaque image pouvait être simultanément une célébration de la vie et une méditation sur la mort.
Les écrivains peuplent son oeuvre comme les figures d’un roman choral. William S. Burroughs, ce junkie littéraire qui réinventa la narration avec ses découpages, pose pour Hujar avec la même présence troublante qu’il insufflait à ses textes. Fran Lebowitz, chroniqueuse caustique du New York des années 1970, apparaît dans son lit, enveloppée de draps à pois, capturée dans cette intimité qui caractérise l’écriture autobiographique. Vince Aletti, critique culturel, passait chez Hujar non seulement pour bavarder mais pour utiliser sa douche [2], détail prosaïque qui dit tout de la porosité entre vie et création artistique. Ces portraits ne sont pas de simples documents. Ils fonctionnent comme des nouvelles visuelles, chacun racontant une histoire complète en une seule image.
La construction narrative chez Hujar emprunte aux techniques littéraires du XXe siècle. Ses séquences photographiques, notamment celles exposées à la Gracie Mansion Gallery en 1986, opéraient comme des montages à la Eisenstein ou des collages modernistes [3]. Une vache ruminant sa paille fait face à l’acteur britannique David Warrilow photographié nu. Le portrait de Jackie Curtis mort dans son cercueil jouxte un paysage du New Jersey et une drag queen exhibant sa cuisse tatouée. Diana Vreeland, icône de la mode, côtoie un gros plan sur les pieds de l’artiste australienne Vali Myers et une décharge du Queens. Cette juxtaposition refuse la hiérarchie culturelle traditionnelle, proposant une démocratie visuelle où chaque sujet mérite la même attention formelle.
L’influence de la Beat Generation traverse son travail. Allen Ginsberg, photographié par Hujar en 1974, refuse de se livrer à la caméra, râlant et résistant [2]. Cette tension entre photographe et sujet évoque la relation complexe entre l’écrivain et son matériau brut. Hujar cherchait ce que Ginsberg cherchait dans “Howl” : une vérité brute, non filtrée, parfois inconfortable. Comme le rapporte un de ses modèles, Hujar exigeait “une honnêteté brûlante, aveuglante, dirigée vers l’objectif. Pas de comédie. Pas de pose. Pas de faux-semblant”. Cette exigence éthique rappelle l’impératif littéraire du témoignage sincère.
L’écrivain et activiste David Wojnarowicz, qui devint son amant puis son protégé en 1981, incarne cette fusion entre littérature et photographie. Wojnarowicz écrivait avec la même urgence désespérée que Hujar photographiait. Ses textes, bruts et politiques, trouvaient leur équivalent visuel dans les images que Hujar faisait de lui. Le portrait “David Wojnarowicz with a Snake” de 1981 capture quelque chose d’indescriptible : une vulnérabilité sauvage, une tendresse menaçante. Après la mort de Hujar, Wojnarowicz photographia son visage, ses mains et ses pieds dans la chambre d’hôpital, créant un triptyque qui fonctionne comme un poème élégiaque. Cette réciprocité, cet échange constant entre voir et être vu, entre écrire et être écrit, définit la pratique de Hujar.
Le concept de révélation, central dans son approche, possède une dimension littéraire. Révéler, en photographie, c’est le processus chimique qui fait apparaître l’image latente. Révéler, en littérature, c’est dévoiler ce qui était caché. Hujar opérait aux deux niveaux simultanément. Ses sujets devaient se révéler psychologiquement tandis qu’il révélait techniquement l’image dans sa chambre noire. Cette double signification n’était pas métaphorique mais littérale. Il passait des heures dans son laboratoire à manipuler contrastes et gradations, créant des tirages d’une beauté formelle stupéfiante, ces tonalités noir et blanc exquises qui devinrent sa signature.
Son livre “Portraits in Life and Death” fonctionne comme un recueil de nouvelles où chaque image dialogue avec les autres. Les portraits de ses amis, Sontag, Lebowitz, Aletti, John Waters et la drag queen Divine, alternent avec les photographies des cadavres des catacombes de Palerme qu’il avait prises en 1963. Cette structure narrative crée un memento mori contemporain, rappelant la tradition littéraire des méditations sur la mortalité. Mais là où la vanitas baroque utilisait des crânes et des sabliers, Hujar juxtapose la vitalité de ses amis vivants avec l’élégance macabre des morts siciliens.
La chorégraphie du corps immobile
La danse innerve toute l’oeuvre de Hujar, même quand ses sujets restent parfaitement immobiles. Cette apparente contradiction révèle sa compréhension profonde du mouvement comme potentialité plutôt que comme action. Bruce de Sainte Croix, danseur qu’il photographia nu en 1976, incarne cette tension. Les trois portraits de Sainte Croix constituent une séquence chorégraphique condensée : tension, relâchement, extase. Dans le plus célèbre, le danseur est assis, les yeux baissés, sa main droite saisissant son sexe en érection. Cette image, souvent qualifiée d’orgasmique, transcende la pornographie par sa composition rigoureuse et son honnêteté bouleversante.
Contrairement à Mapplethorpe qui ne montra jamais l’orgasme ou l’éjaculation dans ses photographies éditées, Hujar n’évitait pas ces moments de vulnérabilité absolue. La série “Orgasmic Man” marque une différence structurelle majeure entre les deux photographes. Là où Mapplethorpe recherchait la perfection statuaire, Hujar capturait l’instant où le corps échappe à tout contrôle. Cette perte de contrôle, cette soumission au plaisir ou à la douleur, constitue l’essence même de la danse moderne. Les danseurs avec lesquels Hujar travaillait appartenaient à cette génération post-Cunningham qui refusait la virtuosité gratuite au profit d’une authenticité corporelle.
Ses portraits de danseurs en coulisse révèlent ce moment liminal entre l’être ordinaire et l’être performatif. Charles Ludlam en Camille, avec son décolleté révélant une toison pectorale sous les paillettes, synthétise les genres comme la danse contemporaine synthétise les techniques. Cette fluidité, cette capacité à glisser entre identités, reflète la philosophie de la Judson Dance Theater et des chorégraphes qui révolutionnèrent la danse new-yorkaise dans les années 1960. Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton exploraient le mouvement quotidien comme matériau chorégraphique. Hujar photographiait ce quotidien avec la même attention qu’un chorégraphe décompose un geste banal.
La série photographique “Angels of Light” montre des danseurs-performeurs drag après leurs spectacles psychédéliques, paillettes encore accrochées dans leurs barbes. Cette troupe, fondée par des membres dissidents du Cockettes, créait des performances totales où danse, théâtre et happening fusionnaient. Hujar capturait non le spectacle lui-même mais son après, ce moment de retour au réel qui paradoxalement révèle la vérité de la performance. Les corps fatigués, le maquillage qui coule, l’épuisement post-show : voilà la vraie danse, celle qui coûte au corps.
Vali Myers, artiste et danseuse australienne dont Hujar photographia les pieds tatoués en gros plan, incarnait cette vision de la danse comme inscription corporelle. Ses tatouages, ses scarifications, transformaient son corps en partition vivante. Chaque marque racontait un mouvement, une histoire, une douleur surmontée. Hujar comprenait que la danse ne se limite pas au mouvement visible. Elle persiste dans la mémoire musculaire, dans les cicatrices, dans la façon dont un danseur habite son corps même au repos.
Ses nus masculins, souvent contorsionnés, fonctionnent comme des études chorégraphiques. Gary Schneider, le tireur qui devint ami et qui aujourd’hui imprime ses oeuvres, se plie en deux, une jambe tirée par-dessus sa tête baissée. Daniel Schock se penche pour sucer son orteil. Ces positions anguleuses et inconfortables ne sont ni sensuelles ni gracieuses au sens conventionnel. Elles explorent les limites de la flexibilité corporelle, testant ce que peut un corps. Cette investigation systématique des possibilités corporelles appartient à la tradition de la danse expérimentale.
La récurrence de la position allongée dans ses portraits évoque le repos du danseur, ce moment où le corps horizontal récupère de l’effort vertical. Cookie Mueller, immortalisée par Nan Goldin et Hujar, nous fixe défiante depuis son lit. Ce regard direct contredit la passivité de la posture. C’est le regard d’un corps qui connaît sa puissance et choisit temporairement le repos. La danse n’existe pas seulement dans le mouvement mais dans l’alternance entre tension et relâchement, entre activité et repos.
Les paysages urbains de Hujar possèdent leur propre chorégraphie. Les escaliers délabrés du Canal Street Pier, les quais où draguaient les hommes, les ruines d’immeubles abandonnés : ces espaces vides portent la trace de mouvements passés. Comme une scène après la représentation, ils gardent l’empreinte des corps qui les ont traversés. Cette attention aux espaces post-performance, aux lieux hantés par l’absence, rappelle les installations de danse contemporaine qui utilisent la vidéo et la photographie pour capturer l’éphémère.
Sa fascination pour les animaux s’inscrit également dans une réflexion sur le mouvement naturel. La vache derrière les barbelés, qu’il qualifiait d’autoportrait, possède une grâce contemplative. Les chevaux qu’il photographia dégagent une puissance retenue. Le goéland mort, posé par Wojnarowicz pour l’objectif de Hujar en 1985, garde même dans la mort une élégance aérienne. Ces animaux enseignent une leçon chorégraphique : le mouvement authentique ne peut être simulé, il émane d’une nécessité intérieure.
Persistances
L’oeuvre de Hujar résiste aux catégories confortables que le marché de l’art et l’institution muséale voudraient lui imposer. On veut en faire le chroniqueur d’une époque révolue, le documentariste d’un New York englouti par la gentrification et décimé par le sida. Ce serait trop simple. Ses photographies ne documentent pas, elles interrogent. Elles posent des questions sur ce que signifie voir et être vu, sur la distance minimale nécessaire entre soi et l’autre pour qu’une rencontre authentique advienne.
La reconnaissance tardive dont il bénéficie aujourd’hui révèle nos propres aveuglement et transformation. Pendant quarante ans, le monde de l’art considérait Hujar comme marginal, difficile, trop peu commercial. Sa personnalité intransigeante, son refus de flatter le marché garantissaient son obscurité [4]. Mais cette marginalité était précisément sa force. Libre des compromis qu’impose la célébrité, il développa une vision singulière, irréductible aux tendances du moment. Ses photographies ne ressemblent à rien d’autre parce qu’elles n’ont jamais cherché à ressembler à quoi que ce soit.
Le triptyque que Wojnarowicz réalisa au chevet de Hujar mourant referme une boucle : le photographe devient photographié, le voyant devient vu. Cette réversibilité finale suggère que toute l’entreprise photographique de Hujar consistait moins à capturer les autres qu’à créer les conditions d’une réciprocité. Ses sujets le regardaient autant qu’il les regardait. Cette double attention, ce pacte silencieux, explique l’intensité particulière de ses portraits. On ne se contente pas de regarder un portrait de Hujar, on est regardé en retour.
L’exposition l’hiver dernier au Raven Row à Londres, et les nombreuses rétrospectives des dernières années à la fondation MAPFRE à Barcelone [3], à la Morgan Library à New York et au musée du Jeu de Paume à Paris, témoignent d’un changement dans notre façon de voir. Nous apprenons lentement ce que Hujar savait d’instinct : que la dignité ne se confère pas par le statut social mais par l’attention formelle qu’on porte à chaque existence singulière. Ses drag queens possèdent la noblesse des princes de la Renaissance. Ses chiens ont la prestance des lions héraldiques. Ses paysages urbains délabrés rivalisent avec les ruines romantiques.
Regarder Hujar aujourd’hui, c’est mesurer ce que nous avons perdu et ce qui persiste malgré tout. Le New York qu’il photographiait n’existe plus. La majorité des personnes qu’il portraitura sont mortes. Mais quelque chose demeure dans ces images, une qualité d’attention et de présence qui défie le temps. Ses photographies nous enseignent qu’il est possible de regarder sans dominer, de révéler sans trahir, d’aimer sans posséder. Dans notre époque saturée d’images jetables, cette leçon éthique et esthétique devient plus urgente que jamais.
- Susan Sontag, introduction à Peter Hujar, Portraits in Life and Death, Da Capo Press, New York, 1976
- Linda Rosenkrantz, Peter Hujar’s Day, Magic Hour Press, 2022
- Joel Smith, Peter Hujar, Speed of Life, Fundación Mapfre et Aperture, 2017
- Vince Aletti, texte du catalogue Peter Hujar: Lost Downtown, Pace/MacGill Gallery et Steidl, 2016