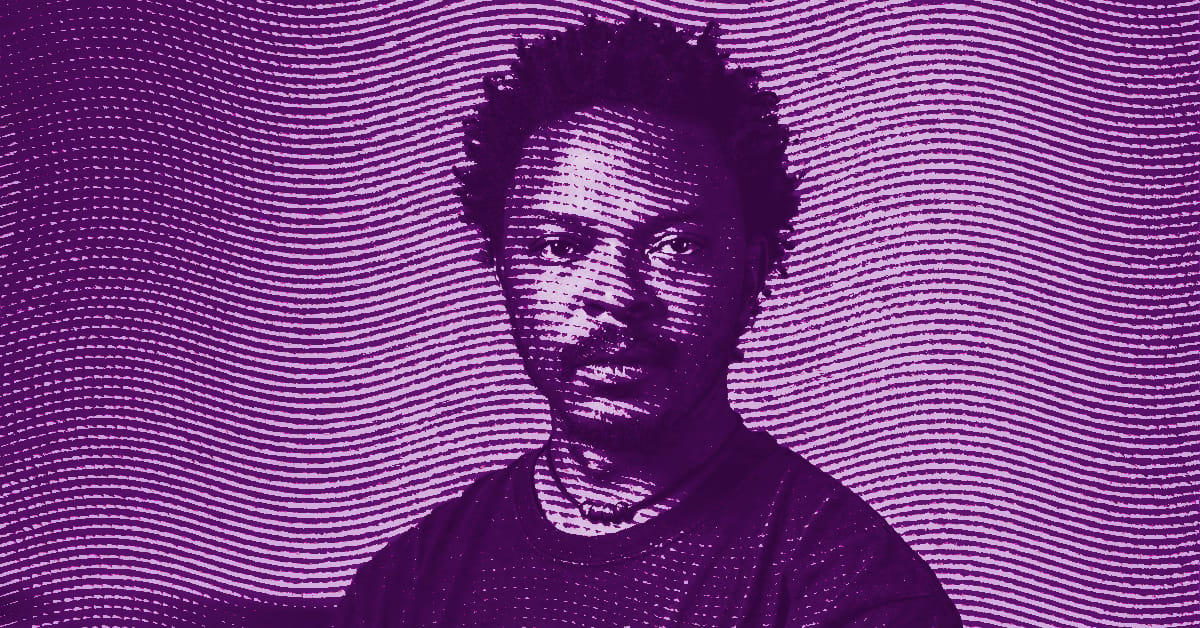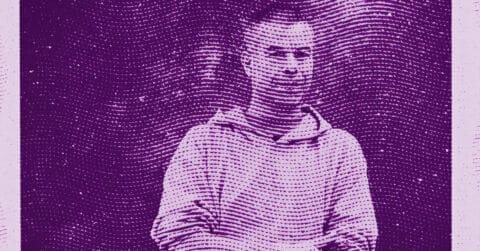Écoutez-moi bien, bande de snobs : pendant que vous vous extasiez devant les dernières installations d’art contemporain, un homme né à Lubumbashi accomplit depuis deux décennies un travail d’une intelligence féroce qui devrait vous clouer le bec. Sammy Baloji n’est pas de ces artistes qui caressent l’oeil dans le sens du poil. Il est de ceux qui dérangent, qui exhument, qui obligent à regarder ce que l’on préférerait oublier. Photographe de formation, diplômé en lettres et sciences humaines avant de se spécialiser en vidéo et photographie à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, cet homme a fait de l’archive coloniale son terrain de bataille et de la mémoire du Katanga son obsession salutaire.
Son travail ne se contente pas d’esthétiser la ruine ou de documenter la désolation. Il opère un geste bien plus violent : il superpose les temps, confronte les images, met face à face le présent congolais et son passé colonial, comme on forcerait deux adversaires à se regarder dans le blanc des yeux. Sa série Mémoire (2004-2006) inaugure cette méthode radicale : des photographies d’archives coloniales viennent hanter ses propres clichés des sites industriels abandonnés du Katanga. Le résultat est d’une brutalité poétique qui laisse pantois. Mais ne nous y trompons… ou plutôt si, trompons-nous ensemble sur la nature de son geste, car il ne s’agit ni de nostalgie ni de simple dénonciation. Il s’agit d’une archéologie visuelle qui met au jour les strates de violence inscrites dans le paysage même.
L’architecture comme instrument de domination
Commençons par ce qui crève les yeux mais que personne ne veut voir : l’architecture. Chez Baloji, l’architecture coloniale n’est jamais un simple décor pittoresque ou un vestige à contempler avec cette distance condescendante que l’on réserve aux ruines exotiques. Elle est l’outil premier de la domination, le langage de pierre et de béton par lequel s’est écrit le projet colonial belge. Lorsque Baloji filme les bâtiments décrépits de Yangambi dans Aequare. The Future that Never Was (2023), il ne se contente pas de montrer des murs qui s’effritent. Il montre comment ces structures continuent de conditionner la vie des Congolais, comment les travailleurs contemporains occupent encore les mêmes espaces que leurs prédécesseurs de l’époque coloniale, accomplissant les mêmes gestes dans les mêmes lieux, prisonniers d’une géométrie spatiale héritée de la violence.
L’urbanisme colonial belge au Congo, et particulièrement à Lubumbashi où Baloji a grandi, suivait une logique d’apartheid spatial que les historiens de l’architecture ont bien documentée [1]. La ville fut créée ex nihilo en 1910, organisée autour du principe de la ségrégation raciale avec son fameux “cordon sanitaire” de 500 mètres séparant les quartiers européens des cités africaines. Cette distance, prétendument justifiée par des considérations sanitaires liées au paludisme, dessinait en réalité une carte de la hiérarchie coloniale inscrite dans le sol même. Baloji a déclaré avoir vécu son “enfance dans une ville entièrement organisée autour de la réalité industrielle et de l’exploitation des ressources minières”. Cette ville, c’est Lubumbashi, anciennement Élisabethville, cathédrale du cuivre et monument à la gloire de l’Union Minière du Haut-Katanga.
Dans Still Kongo I-V (2024), Baloji déploie une stratégie d’une subtilité remarquable. Il encadre des photographies aériennes d’archives montrant la forêt congolaise en 1958-1959 dans des cadres en bois d’afzélia ornés de motifs inspirés de l’Art nouveau belge. Ce geste apparemment décoratif recèle une violence conceptuelle considérable. L’Art nouveau, ce style qui fit la gloire de Bruxelles, portait initialement le nom de “Style Congo” en référence aux matériaux et aux motifs congolais qui l’inspirèrent. Voilà donc le circuit complet de l’extraction : les ressources quittent le Congo, enrichissent l’Europe, y génèrent des mouvements esthétiques célébrés comme le summum du raffinement occidental, avant de revenir sous forme de cadres qui enserrent les images mêmes de la destruction qu’elles ont causée.
Les bâtiments coloniaux que Baloji photographie et filme ne sont pas de simples témoins passifs de l’histoire. Ils sont des agents actifs de la perpétuation des structures coloniales. La cathédrale de Lubumbashi en style néo-roman, construite en 1921, bloquait volontairement la vue sur le parc et la résidence du gouverneur depuis le centre-ville, marquant physiquement le pouvoir colonial dans l’espace urbain. Les cités ouvrières construites par l’Union Minière du Haut-Katanga formaient des entités autonomes avec logements, écoles et dispensaires, des micro-univers totalitaires où la compagnie contrôlait chaque aspect de la vie des travailleurs. Cette architecture paternaliste, qui se voulait bienfaisante, n’était qu’une forme raffinée de contrôle social.
Baloji comprend que l’architecture coloniale n’est jamais neutre. Elle incarne une philosophie de la domination qui se perpétue bien au-delà de l’indépendance formelle. Les plans urbains, les tracés des rues, la disposition des bâtiments publics, tout cela continue de structurer l’existence quotidienne des Congolais selon des logiques héritées de l’oppression. Lorsqu’il juxtapose dans ses installations des plantes congolaises et des douilles de munitions en cuivre transformées en pots de fleurs par des ménages belges, il révèle comment même la domesticité européenne participe de la chaîne extractiviste. Le cuivre arraché au Katanga, forgé en obus lors de la Première Guerre mondiale, puis recyclé en objets décoratifs chez des bourgeois belges : voilà le cycle de vie obscène d’un matériau qui porte en lui la mémoire de multiples violences.
La philosophie de l’invention et de la destruction
Si l’architecture est chez Baloji le langage visible de la domination, c’est vers la philosophie qu’il faut se tourner pour comprendre les mécanismes épistémologiques qui ont rendu cette domination possible. L’artiste ne cite pas la philosophie par hasard dans ses oeuvres. Dans Tales of the Copper Cross Garden, Episode I (2017), il entrelace les images d’une fonderie de cuivre avec des extraits des écrits autobiographiques de Valentin-Yves Mudimbe, philosophe et poète congolais dont l’oeuvre monumentale L’Invention de l’Afrique (1988) a révolutionné la compréhension des savoirs sur l’Afrique [2].
Mudimbe a montré que l’Afrique telle qu’elle existe dans l’imaginaire occidental est une construction, une invention produite par un appareil discursif colonial qui incluait l’anthropologie, la cartographie, la mission civilisatrice et les sciences naturelles. Ce que Mudimbe appelle la “bibliothèque coloniale”, cet ensemble de textes, de classifications, de cartographies qui ont défini l’Afrique de l’extérieur, trouve son équivalent visuel dans le travail de Baloji. Les archives photographiques que l’artiste exhume et réactive sont précisément les instruments de cette “invention” : elles ont servi à cataloguer, à classer, à essentialiser les Congolais, à les réduire à des spécimens ethnographiques.
Le geste artistique de Baloji est profondément dans l’esprit de Mudimbe dans son approche. Il ne cherche pas à opposer une “vraie” Afrique à une Afrique inventée, mais à dévoiler les mécanismes mêmes de cette invention, à montrer comment les outils de la connaissance coloniale, la photographie, la cartographie géologique et les plans d’urbanisme, ont participé à la construction d’une Afrique disponible pour l’exploitation. Les cartes géologiques colorées qu’il présente dans Extractive Landscapes (2019) ne sont pas de simples documents techniques. Elles sont des outils de pouvoir qui découpent le territoire congolais en zones d’extraction, qui le réduisent à ses ressources minières, qui effacent toute épaisseur historique et culturelle pour ne retenir que la valeur marchande du sous-sol.
Mudimbe a également insisté sur le rôle de l’Église catholique dans l’entreprise coloniale. Les missionnaires ne venaient pas seulement “sauver les âmes” ; ils participaient activement au projet de remodelage des subjectivités africaines. Baloji saisit cette dimension avec une acuité remarquable. Dans Tales of the Copper Cross Garden, les chants choraux qui ponctuent les images de la fonderie ne sont pas un simple contrepoint musical. Ils évoquent les petits chanteurs congolais tenant des croix de cuivre devant leur poitrine, symbole d’une double extraction : celle du métal et celle de l’âme. Comme Baloji l’a formulé avec une clarté tranchante : “Rien de moins que les croix de cuivre tenues devant le coeur des enfants de choeur ne suggère comment les missionnaires ont tenté de voler leurs âmes tout en exploitant les ressources locales de cuivre au profit des Européens”.
Le philosophe congolais avait grandi dans un séminaire colonial, expérience qui nourrit toute son oeuvre. Baloji, quant à lui, a grandi dans une ville-usine entièrement dédiée à l’extraction minière. Tous deux comprennent viscéralement comment le colonialisme ne se contentait pas d’exploiter les ressources : il cherchait à remodeler les consciences, à imposer de nouvelles catégories de pensée, à détruire les systèmes de savoir locaux pour les remplacer par les taxonomies occidentales. Les croix de cuivre du Katanga que Baloji expose, ces objets qui servaient de monnaie entre le XIIIe et le XXe siècle, témoignent d’un système économique et symbolique sophistiqué antérieur à la colonisation. L’arrivée de l’Union Minière du Haut-Katanga a rendu ces croix obsolètes, les réduisant à de simples curiosités ethnographiques.
Cette destruction des systèmes de valeur locaux au profit des logiques marchandes occidentales est au coeur du travail de Baloji. Quand il présente des tissus précieux du Royaume Kongo transformés en “négatifs” de bronze et de cuivre dans sa série Copper Negative of Luxury Cloth Kongo Peoples (2017), il accomplit un geste de réappropriation symbolique. Ces textiles en fibres de palmier raphia, d’une finesse comparable au velours, circulaient dans les cabinets de curiosités européens avant d’être relégués au statut d’artefacts ethnographiques. Baloji les refond littéralement dans le métal congolais, comme pour inverser le processus de décontextualisation et de réification qu’ils ont subi.
La dimension philosophique du travail de Baloji réside aussi dans son refus de toute nostalgie. Il ne cherche pas à restaurer un passé précolonial mythique, ce qui serait tomber dans le piège de l’essentialisme dénoncé par Mudimbe. Au contraire, il travaille dans les interstices, dans les zones grises où se mêlent passé et présent, archives et création contemporaine. Son installation Gnosis (2022), présentée au Palazzo Pitti de Florence, comportait un globe géant en fibre de verre noire entouré de reproductions de cartes historiques de l’Afrique. Le titre même, “Gnosis”, renvoie directement au sous-titre de l’ouvrage de Mudimbe : Gnose, philosophie et ordre de la connaissance. Baloji sait que la question n’est pas de produire une “vraie” représentation de l’Afrique qui viendrait corriger les fausses représentations coloniales. La question est de comprendre comment se produisent les régimes de vérité, comment s’établissent les ordres de la connaissance qui rendent certains savoirs légitimes et d’autres inaudibles.
Vers une éthique de la mémoire
Que fait donc Sammy Baloji, au fond ? Il pratique ce que l’on pourrait appeler une archéologie critique du présent. Chacune de ses oeuvres est une excavation qui met au jour les strates de violence, d’extraction et de destruction qui constituent le sol même de la modernité congolaise. Mais contrairement à l’archéologue classique qui exhume pour mieux muséifier, Baloji exhume pour réactiver, pour rendre ces histoires enfouies actives dans le présent. Ses images ne sont pas des documents inertes : elles sont des dispositifs qui forcent le regard, qui obligent à reconnaître la continuité entre le passé colonial et les formes contemporaines d’exploitation néocoloniale.
Le cobalt et le lithium qui alimentent aujourd’hui nos téléphones portables et nos voitures électriques sortent des mêmes mines du Katanga qui produisaient hier le cuivre pour l’électrification de l’Europe et l’uranium pour les bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Cette continuité obscène, Baloji la rend visible dans Shinkolobwe’s Abstraction (2022), série de sérigraphies qui superposent des échantillons d’uranium congolais et des images d’explosions nucléaires. Le message est d’une clarté brutale : l’atome qui a rasé Hiroshima venait du Katanga. L’énergie qui alimente la “transition écologique” occidentale repose sur la même logique extractiviste qui a détruit le Congo pendant plus d’un siècle.
Baloji n’offre aucun réconfort, aucune solution facile. Son travail est inconfortable parce qu’il refuse les narrations rédemptrice. Il ne célèbre pas la “résilience” africaine, ce concept fourre-tout que les Occidentaux affectionnent tant pour éviter de parler de responsabilité historique. Il montre au contraire comment les structures coloniales se perpétuent, comment l’architecture continue de contraindre, comment les logiques extractivistes se renouvellent sous de nouveaux habillages. Les travailleurs de Yangambi occupent toujours les mêmes bâtiments, accomplissent les mêmes tâches de classification botanique selon les mêmes protocoles qu’à l’époque coloniale. Le Congo dit indépendant reste pris dans les filets d’une dépendance structurelle qui ne dit plus son nom.
Pourtant, il serait faux de voir dans ce travail un simple exercice de dénonciation. Ce que Baloji construit, oeuvre après oeuvre, c’est une éthique de la mémoire qui refuse autant l’oubli que la fossilisation mémorielle. Ses archives ne sont pas là pour nourrir le ressentiment ou pour alimenter une victimisation complaisante. Elles sont là pour éclairer le présent, pour permettre une compréhension sans concession des mécanismes qui continuent d’opérer. Comme il l’a affirmé lui-même : “Ce qui m’intéresse en tant qu’artiste, c’est comment nous créons un discours alternatif, comment nous nous attaquons à ces modes de pensée établis de l’époque coloniale et identifions leurs limites, leurs faiblesses.”
Voilà peut-être le geste le plus radical de Baloji : ne pas se contenter de dénoncer les discours coloniaux, mais chercher leurs failles, leurs points de fragilité, les interstices par lesquels d’autres récits, d’autres ordres de connaissance peuvent émerger. Son travail de cofondateur de la Biennale de Lubumbashi depuis 2008 participe de cette même logique. Il ne s’agit pas simplement d’exposer des artistes congolais, mais de créer les infrastructures intellectuelles et institutionnelles qui permettront à ces artistes de produire et de diffuser leurs oeuvres selon leurs propres termes, sans passer par les filtres et les validations du marché de l’art occidental.
La radicalité de Sammy Baloji réside dans cette patience méthodique, cette rigueur de chercheur mise au service d’une vision artistique qui ne transige jamais sur la complexité. Il ne simplifie pas, il ne spectacularise pas, il ne fait pas de l’horreur coloniale un produit de consommation esthétique. Ses oeuvres exigent du temps, de l’attention, un effort intellectuel que beaucoup de spectateurs ne sont pas disposés à fournir. Tant pis pour eux. Baloji ne travaille pas pour le confort du public occidental. Il travaille pour exhumer une mémoire, pour donner corps à une histoire que l’on voudrait voir rester enterrée sous les décombres des bâtiments coloniaux. Et dans ce travail d’exhumation, il accomplit peut-être l’une des tâches les plus nécessaires de l’art contemporain : nous forcer à regarder en face ce que notre modernité doit à la barbarie, et ce que notre prospérité continue de coûter à d’autres.
- Lagae, Johan, “Rewriting Congo’s Colonial Past: History, Memory, and Colonial Built Heritage in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo”, in Repenser les limites : l’architecture à travers l’espace, le temps et les disciplines, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2017
- Mudimbe, Valentin-Yves, L’Invention de l’Afrique : Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, Présence africaine, 2021 (édition originale en anglais : Indiana University Press, 1988)