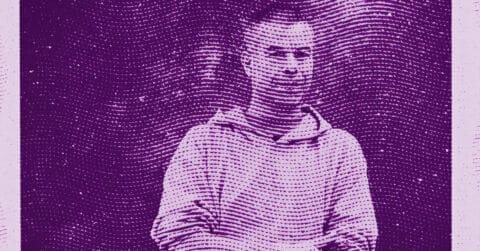Écoutez-moi bien, bande de snobs : Sharon Lockhart ne fait pas dans la dentelle. Cette Américaine née en 1964, installée à Los Angeles, a passé près de trois décennies à nous forcer à regarder ce que nous préférons ignorer : des ouvrières, des enfants anonymes, des adolescentes qualifiées d'”inadaptées”. Armée d’une caméra fixe et d’une patience qui confine à l’obstination, elle impose une durée qui met mal à l’aise nos cerveaux habitués au zapping incessant. Ses films s’étirent, se répètent, se refusent au spectaculaire. Et pourtant, quelque chose opère. Dans cette lenteur programmatique, dans ces gestes répétés jusqu’à l’hypnose, surgit une forme de résistance contre l’accélération générale de nos vies.
Le travail de Lockhart s’inscrit dans une filiation revendiquée avec le cinéma d’auteur, particulièrement celui de François Truffaut et de Jean Rouch. Lorsqu’elle filme Milena Słowińska, cette jeune Polonaise rencontrée dans les cours délabrées de Łódź en 2009, rejouant la scène finale des Quatre Cents Coups dans Antoine/Milena (2015), elle ne se contente pas d’un hommage nostalgique. Le visage de Milena face caméra, ce regard qui nous transperce avec un mélange de défi et de vulnérabilité, réactive la puissance subversive du film de Truffaut [1]. Là où Antoine Doinel courait vers la mer pour échapper à l’enfermement de la société française des années cinquante, Milena incarne l’inadaptation contemporaine, celle des jeunes filles placées en institution, étiquetées comme “difficiles” ou “ingérables”.
Cette référence au cinéma de la Nouvelle Vague n’est pas fortuite. Truffaut avait compris que filmer l’enfance impliquait de renoncer aux hiérarchies établies, de prendre au sérieux les désirs et les révoltes des plus jeunes. Lockhart pousse cette logique plus loin encore. Dans Rudzienko (2016), tourné au Centre de sociothérapie pour jeunes filles de Rudzienko en Pologne, elle organise des ateliers de philosophie, de théâtre et de thérapie par le mouvement avec une quinzaine d’adolescentes. Le film qui en résulte alterne plans fixes de paysages ruraux et textes de conversations philosophiques. Les jeunes filles parlent de Dieu sans parler de Dieu, ce serait contraire aux consignes, du libre arbitre et des erreurs qui révèlent des choses. Lockhart filme des corps en mouvement dans la nature, des courses joyeuses dans l’obscurité, des actes de liberté fugace. Comme Truffaut, elle refuse la condescendance habituelle envers les mineurs. Comme Rouch dans ses ethnofictions, elle brouille délibérément les frontières entre documentaire et mise en scène.
Jean Rouch, ce cinéaste-anthropologue français qui filmait en Afrique avec une caméra participante, constitue l’autre référence majeure de Lockhart. Elle cite explicitement son influence, notamment sa manière de faire jouer aux gens leur propre rôle tout en introduisant des éléments chorégraphiés. Dans Goshogaoka (1997), son premier long métrage, Lockhart filme pendant une heure une équipe de basketball féminine d’une école secondaire de la banlieue de Tokyo exécutant des exercices d’entraînement élaborés. Ce qui semble spontané est en réalité minutieusement chorégraphié. La caméra reste immobile, mais les joueuses créent le mouvement visuel. Cette approche hybride, entre observation ethnographique et performance arrangée, doit tout à Rouch. Lockhart pratique ce que l’on pourrait appeler une ethnofiction de la vie ordinaire : elle s’immerge dans des communautés, apprend leurs codes, gagne leur confiance, puis construit avec elles des images qui disent quelque chose de leur réalité tout en étant ouvertement construites.
Le parallèle avec Rouch va plus loin. Dans Teatro Amazonas (1999), Lockhart filme pendant vingt-quatre minutes un public assis dans l’opéra néoclassique de Manaus, au Brésil, qui regarde directement la caméra, et donc nous, spectateurs. Le choeur amazonien, hors champ, interprète une composition originale de Becky Allen qui part d’un accord massif pour progressivement s’éteindre. À mesure que la musique diminue, le bruit de la salle augmente. Ce renversement du regard, où l’observé devient observateur, rappelle les expérimentations de Rouch avec la “caméra participante” et les questions qu’il posait sur l’éthique de la représentation. Qui regarde qui ? Qui détient le pouvoir dans l’acte de filmer ? Lockhart transforme ces interrogations en dispositif formel.
L’autre territoire d’exploration de Lockhart, celui qui la relie intimement au monde de la danse et du mouvement, s’incarne dans sa collaboration posthume avec Noa Eshkol, chorégraphe, théoricienne de la danse et artiste textile israélienne décédée en 2007. Lockhart découvre le travail d’Eshkol peu après sa mort, lors d’un voyage de recherche en Israël sponsorisé par la Fédération juive de Los Angeles. Cette rencontre avec l’oeuvre d’une artiste disparue donnera lieu à l’une des collaborations les plus singulières de l’art contemporain : un dialogue entre une cinéaste américaine et le legs d’une chorégraphe israélienne, transmis par les danseurs du Noa Eshkol Chamber Dance Group [2].
Le système de notation du mouvement Eshkol-Wachman, développé par Eshkol avec l’architecte Avraham Wachman dans les années cinquante, utilise des chiffres et des symboles pour cartographier les relations spatiales entre les parties du corps. C’est une tentative de créer un langage universel du mouvement, à mi-chemin entre la géométrie et la chorégraphie. Lockhart filme les danseurs d’Eshkol exécutant méticuleusement ces compositions dans Five Dances and Nine Wall Carpets by Noa Eshkol et Four Exercises in Eshkol-Wachman Movement Notation (tous deux de 2011). L’installation vidéo, sur cinq canaux, présente les danseurs en taille réelle au niveau du sol, se mouvant au rythme d’un métronome retentissant, comme s’ils se mélangeaient aux visiteurs du musée. Cette mise en scène crée une cohabitation troublante entre les vivants et les fantômes d’une pratique artistique menacée de disparition.
Ce qui intéresse Lockhart chez Eshkol, c’est la rencontre entre formalisme géométrique et humanisme profond. Eshkol était une puriste qui cherchait dans ses danses à “renoncer à l’usage de tous les outils qui ne sont pas intrinsèquement liés au mouvement”, y compris les costumes, la musique et l’éclairage dramatique. Ses tapisseries murales, réalisées avec des chutes de tissus colorés récupérés, existaient comme oeuvres séparées, sans lien avec les danses. Pourtant, Lockhart choisit d’inclure ces tapisseries comme éléments de décor dans ses films, épinglées sur des blocs verticaux autoportants, un choix qu’Eshkol n’aurait probablement pas approuvé. C’est là tout le paradoxe de Lockhart : elle respecte profondément les artistes qu’elle étudie, mais elle ne les fétichise pas. Elle s’autorise à réinterpréter leur travail selon sa propre logique visuelle.
La fascination de Lockhart pour le système de notation d’Eshkol-Wachman révèle son obsession plus large pour les systèmes de codification du mouvement humain. Dans Lunch Break (2008), elle filme en un seul plan-séquence ralenti un couloir de casiers où des ouvriers d’un chantier naval du Maine mangent leur déjeuner. Le mouvement de la caméra, d’une lenteur hypnotique, étire onze minutes d’événement réel en quatre-vingt-trois minutes de film. Chaque geste, déballer un sandwich, lire un journal, discuter avec un collègue, acquiert une dimension chorégraphique. Les boîtes à lunch photographiées séparément deviennent des portraits par procuration de leurs propriétaires. Lockhart applique ici à la classe ouvrière américaine la même attention méticuleuse qu’Eshkol portait à la décomposition géométrique du mouvement. Elle crée une notation visuelle du travail et de la pause, documentant des rituels que personne ne juge dignes d’être filmés.
Cette double filiation, avec le cinéma d’auteur engagé et avec la danse conceptuelle, permet à Lockhart de développer un langage formel unique. Ses films ne racontent pas d’histoires. Ils créent des durées. Ils imposent un temps de regard qui est aussi un temps de pensée. Quand elle filme pendant quatre-vingt-trois minutes des ouvriers mangeant en silence, quand elle filme pendant une heure une équipe de basketball japonaise s’entraînant, quand elle filme pendant quarante minutes des adolescentes polonaises conversant sur l’herbe, elle nous force à abandonner nos attentes narratives pour entrer dans un rapport différent au temps et à l’image.
Le projet Little Review présenté au Pavillon polonais de la Biennale de Venise en 2017 synthétise toutes ces préoccupations. Lockhart y rend hommage à Janusz Korczak, pédagogue et militant polonais des droits de l’enfant qui créa de 1926 à 1939 un journal entièrement écrit et édité par des enfants. Avec les jeunes filles de Rudzienko, elle traduit pour la première fois en anglais des numéros sélectionnés du Mały Przegląd, tisse un dialogue entre passé et présent, donne à voir des corps adolescents en mouvement, filmés sur fond noir dans des saynètes qui évoquent aussi bien le théâtre que la danse. Les bâtons que les jeunes filles brandissent dans les dernières minutes du film, ramassés dans les forêts californiennes, deviennent des totems féministes, des symboles de puissance retrouvée [3].
Lockhart travaille lentement, revient sans cesse aux mêmes lieux, aux mêmes personnes. Elle a filmé la communauté de Pine Flat en Californie pendant quatre ans, est retournée plus de quinze fois en Pologne voir Milena et ses camarades, a passé plus d’un an avec les ouvriers de Bath dans le Maine. Cette méthode d’immersion prolongée, héritée de l’anthropologie visuelle, lui permet de dépasser le regard touristique pour accéder à quelque chose comme l’intimité. Mais ce n’est jamais une intimité confortable. Ses images gardent toujours une distance, un cadre, une composition qui rappelle qu’il s’agit de construction. “L’art existe pour nous faire penser et voir différemment”, affirme-t-elle [4].
Son dernier film, Windward (2025), tourné sur l’île de Fogo à Terre-Neuve, revient à l’enfance mais dans un registre presque pastoral. Douze tableaux montrent des enfants jouant dans des paysages naturels grandioses. Pas de téléphones, pas d’écrans, pas de crise climatique apparente, une vision presque édénique qui contraste violemment avec notre présent. Certains y verront une nostalgie. D’autres, une provocation : et si ralentir, observer, laisser du temps aux enfants et à la nature constituait déjà un geste politique ?
Le travail de Lockhart n’offre pas de réponses faciles. Il ne flatte pas le spectateur. Il exige. Il teste notre capacité d’attention, notre tolérance à l’ennui, notre désir de narration. Mais pour ceux qui acceptent de se soumettre à sa temporalité particulière, quelque chose se produit. Les gestes se chargent de sens. Les silences deviennent éloquents. Les corps ordinaires acquièrent une dignité monumentale. Dans un monde saturé d’images instantanées et jetables, Lockhart fabrique des durées qui résistent, des présences qui perdurent. Elle nous rappelle, avec une obstination qui peut sembler anachronique, que regarder vraiment prend du temps. Que comprendre l’autre exige de la patience. Que la justice sociale commence peut-être par ce simple geste : accorder de l’attention aux vies que notre société préfère ne pas voir.
Son oeuvre constitue ainsi une forme de résistance silencieuse mais tenace contre l’économie de l’attention qui régit notre époque. Chaque plan fixe, chaque minute supplémentaire, chaque refus du montage rapide affirme la valeur du temps long, de l’observation soutenue, de la présence maintenue. En choisissant de filmer des communautés marginalisées, enfants de villages reculés, ouvrières de chantiers navals, adolescentes en difficulté, danseurs perpétuant une tradition menacée, Lockhart ne verse jamais dans le misérabilisme ni dans l’exotisme. Elle leur offre ce que notre société leur refuse : du temps. Du temps pour exister à l’écran, du temps pour que leurs gestes se déploient, du temps pour que nous, spectateurs, apprenions à vraiment les voir. C’est peut-être cela, finalement, son geste le plus radical : transformer le temps en geste de valorisation. Dans ses films, personne n’est pressé. Rien n’est édité au nom de l’efficacité narrative. L’ennui devient méthode, la durée devient politique, et la lenteur devient acte de soin.
- François Truffaut, Les Quatre Cents Coups, film, 1959
- Exposition Sharon Lockhart | Noa Eshkol, co-commissionnée par le Los Angeles County Museum of Art et le Israel Museum de Jérusalem, 2011
- Sharon Lockhart, Little Review, installation présentée au Pavillon polonais, 57ème Biennale de Venise, 2017
- Sharon Lockhart, interview dans Frieze, juin 2005